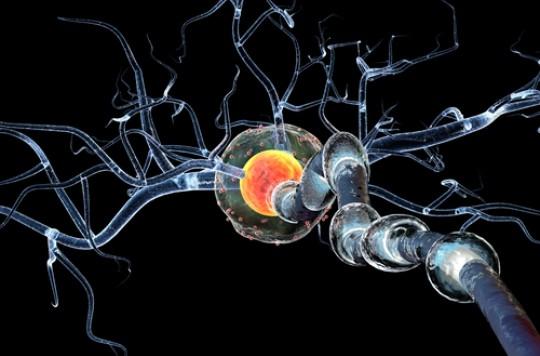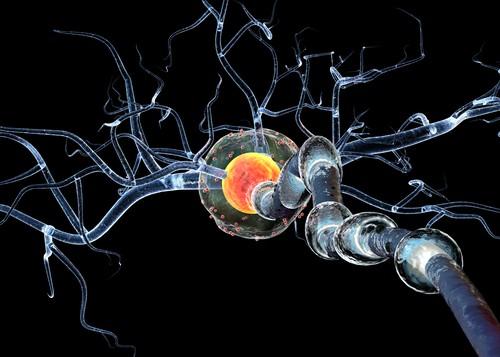Neurologie
Sclérose en plaques : une nouvelle piste pour régénérer la myéline
Chez certains malades souffrant d'une SEP, le processus de réparation géré par le système immunitaire fait défaut, ce qui explique pourquoi leur pathologie évolue plus vite.

- minervastock/epictura
Chez les patients atteints de sclérose en plaques, le système immunitaire est à la fois la cause mais aussi le remède, à en croire une étude publiée dans la revue Brain. Ces travaux menés par des chercheurs de l’Inserm permettent de mieux comprendre pourquoi cette pathologie évolue plus lentement chez certains malades.
La sclérose en plaque est une maladie auto-immune. Les lymphocytes T s’attaquent au cerveau et à la moelle épinière en détruisant les gaines de myéline qui entourent et protègent les neurones. Paradoxalement, ces cellules immunitaires sont aussi responsables de la réparation de ces dégâts. Ils activent d’autres leucocytes, les macrophages de la microglie, chargés d’attirer des cellules souches sur le site de la lésion afin de reconstruire la gaine de myéline. Ainsi, « la capacité à réparer la myéline efficacement est un facteur clé pour contrer la progression de la maladie », note l’Inserm.
Or des études ont montré que ce phénomène de régénération de la myéline pouvait faire défaut. Alors que les lésions peuvent être totalement réparées chez certains malades, elles peuvent perdurer chez d’autres. Une différence qui suggère que l’action du système immunitaire est un phénomène hautement régulé.
Les cellules souches ne se différencient pas
Pour mieux comprendre ces mécanismes, les chercheurs ont injecté chez des souris présentant des lésions de la moelle épinière des lymphocytes de personnes en bonne santé et de patients souffrant de sclérose en plaque. Ils ont alors pu trouver où se situait le problème.
Selon leurs observations, les lymphocytes arrivent à recruter les macrophages de la microglie au niveau des neurones endommagés. En revanche c’est à l’étape suivante que cela coince : les cellules de la microglie n’arrivent pas induire la différenciation des cellules souches chez les patients ayant « une faible capacité de remyélinisation ». Tandis que chez les malades ayant une forte capacité de régénération, la transformation des cellules souches va jusqu’au bout.
En comparant les molécules sécrétées par les lymphocytes T, les scientifiques ont découvert trois substances associées à une bonne remyélinisation et trois autres protéines liées à un mauvais processus de réparation. Inhiber ces dernières molécules pourrait permettre d’activer les macrophages et ainsi ralentir la progression de la maladie, estiment les auteurs.
Piste thérapeutique
« L’étude des lymphocytes issus de patients présentant de fortes capacités de remyélinisation est une piste prometteuse pour développer de nouvelles stratégies de régénération de la myéline, explique Violetta Zujovic, chercheuse à l'Inserm et principale auteure de ces travaux. De plus, l’étude systématique de leurs lymphocytes permettrait de proposer une aide au diagnostic et au traitement, et de développer une médecine de précision adaptée à chaque patient. »
Les auteurs indiquent également que ces résultats pourraient apporter des réponses, voire ouvrir la voie à de nouvelles pistes thérapeutiques, pour la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson.