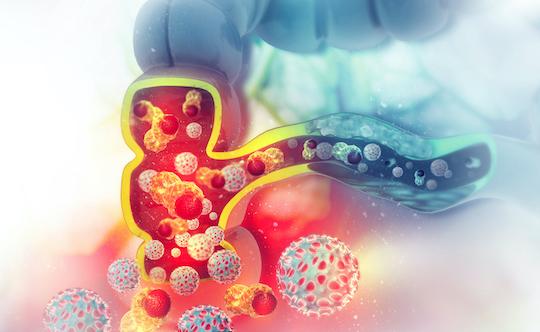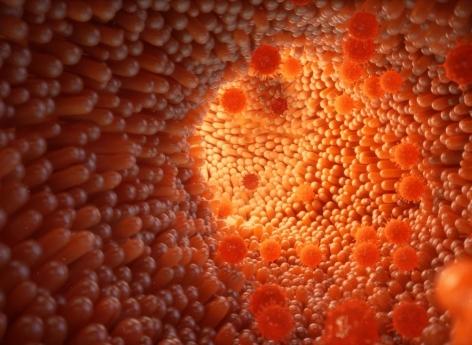Oncologie digestive
Cancer colorectal MSS : l’efficacité de l’immunothérapie dépend de la charge mutationnelle
De nombreux facteurs peuvent influencer l’efficacité d’une immunothérapie ainsi que la charge mutationnelle plasmatique (Tumor Mutational Burden ou TMB). Cette charge mutationnelle plasmatique pourrait servir à monitorer l’efficacité de l’immunothérapie dans les CCR.

- Istock/Mohammed Haneefa Nizamudeen
Les inhibiteurs des immune checkpoints (ICKi), que sont les anti-PD1 et les anti-CTLA4, constituent une avancée thérapeutique majeure dans le traitement des cancers colorectaux métastatiques (mCCR) de phénotype MMR déficient (dMMR)/MicroSatellite Instable (MSI). En effet, les CCR de phénotype dMMR/MSI sont classiquement fortement infiltrées par les cellules immunitaires, en particulier les lymphocytes T cytotoxiques. Ces tumeurs sont caractérisées par une forte charge tumorale mutationnelle (TMB pour Tumor Mutational Burden), avec des néo-antigènes issus de mutations frameshift. De plus, ces tumeurs sont associées à une surexpression des ICK, qui sont responsables d’un épuisement des lymphocytes T cytotoxiques, expliquant ainsi le rationnel de l’utilisation d’inhibiteurs des ICK dans le cas particulier des tumeurs de phénotype dMMR/MSI.
A l’inverse, les résultats de l’utilisation des ICKi se sont montrés jusqu’alors plutôt décevants dans les CCR métastatiques de phénotype MMR proficients (pMMR)/MicroSatellite Satble (MSS). L’existence de mutations sous-clonales pose le problème de la prise en charge thérapeutique des malades. L’existence de mutations sous-clonales est évidemment à corréler à la cellularité de l’échantillons, les échantillons faiblement cellulaires devant être interprétés avec précaution.
La TMB : une mesure aux effets multiples
Le génotypage de l'ADN tumoral circulant (ADNtc) permet une quantification et une caractérisation non invasives du profil moléculaire des tumeurs et peut être un indicateur de l'hétérogénéité tumorale et des changements de la TMB en temps réel. Une TMB plasmatique élevée a récemment été décrite comme associée à une augmentation de la réponse et de la survie dans plusieurs types tumoraux traités par ICKi. Cependant, la TMB plasmatique présente un nombre plus élevé de mutations par mégabase par rapport à la TMB classique évaluée à partir d’un tissu, ce qui donne des données de concordance variables entre les tissus et des échantillons liquides. Par ailleurs, l'évaluation de la TMB reste relativement coûteuse, sans seuil clairement défini, avec, par conséquent, un certain nombre d’écueils à la fois techniques et bio-informatiques.
La TMB est une mesure génomique exonique des mutations non-synonymes (i.e des mutations liées à un changement d’acide aminé) dans les cellules tumorales. En utilisant des algorithmes comparant l'ADN des séquences de tissus témoins aux échantillons de tumeurs, la TMB aide à prédire le nombre de mutations somatiques au sein des tumeurs. Il s'agit donc d'une mesure indirecte de la prédiction des néoantigènes tumoraux. L'utilité de la TMB repose sur le concept selon lequel, lorsqu'elle est élevée, la probabilité d'observer une réponse des cellules T effectrices dirigée contre un antigène tumoral spécifique est augmentée. Ce concept semble être vérifié dans les tumeurs de phénotype dMMR/MSI.
Les CCR de phénotype pMMR/MSS peuvent également présenter une TMB élevée, mais dans un petit nombre de cas. C’est le cas en particulier des CCR présentant des mutations des gènes POLD et POLE, qui sont caractérisés par un phénotype hypermutateur, avec une TMB trois fois supérieure à celle observée dans les CCR de phénotype dMMR/MSI. Ces mutations sont observées dans 1% des CCR de stades II et III et dans moins de 1% des mCCR.
Impact du caractère clonal ou sous-clonal des mutations
Les auteurs de ce travail ont précédemment montré dans un essai clinique randomisé 2 :1 de phase II (essai CCTG CO.26) évaluant la combinaison du trémélimumab, un anti-CTLA-4, et du durvalumab, un anti-PD-L1, contre des soins de support chez 180 malades atteints de mCRC chimiorésistants, qu’une TMB plasmatique (évaluée à partir d’un panel NGS de 500 gènes) ≥28 (observée chez 21% des malades) était associée à un mauvais pronostic chez les patients recevant des soins de support et semblait prédictive du bénéfice de la combinaison d’ICKi [survie globale médiane de 3 mois chez les malades ayant reçu des soins de support versus 5,5 mois chez ceux ayant reçu la combinaison d’ICKi, P = .004, HR=0,34, intervalle de confiance (IC) à 90 % 0,18-0,63].
Il est important de noter que les auteurs ont utilisé un niveau de risque alpha à 10%, et non de 5%, comme c’est classiquement le cas. De manière intéressante, un grand nombre de mutations sous-clonales (définies comme des mutations dont la fréquence allélique était inférieure à 10% de la fréquence maximale des allèles détectés d'une mutation dans l’échantillon) ont été observées dans l'ADN tumoral circulant plasmatique de ces malades (67,2% de l’ensemble des mutations observées). Ainsi, les auteurs ont voulu savoir si (i) le caractère clonal ou sous-clonal des mutations avait potentiellement un impact sur la TMB plasmatique et sur la réponse au traitement et si (ii) les mutations des principales protéines de réparation de l'ADN (BRCA1, BRCA2, ATM, Polymérases E/D1/Q/H, TP53 et MMR) avaient un impact sur la TMB plasmatique et l'efficacité de l'immunothérapie.
Déterminer le seuil optimal de TMB plasmatique
Les mutations plasmatiques des gènes-clés de réparation de l’ADN n'ont pas été associées à l'efficacité de l'immunothérapie et la plupart des autres altérations des gènes de réparation n'ont montré qu'une faible utilité à sélectionner des malades, à l’exception de BRCA1.
Le plasma avant traitement de 166 patients atteints de mCRC de phénotype pMMR/MSS a été séquencé à l'aide du test GuardantOMNITM (2,1 Mb) et la TMB a été calculée pour les mutations somatiques. L'association des principales mutations des protéines de réparation de l'ADN avec la TMB plasmatique a été comparée à l'aide de tests de Mann-Whitney entre des échantillons de type mutant et sauvage.
En utilisant une approche de valeur p minimale, le seuil optimal de TMB plasmatique pour sélectionner les patients ayant la plus grande survie globale a été déterminée pour toutes les mutations, i.e les mutations subclonales et les mutations clonales.
La TMB, un facteur prédictif de bonne réponse clinique ?
Une TMB sous-clonale élevée, ainsi qu’une TMB clonale élevée ont permis d’identifier des groupes de malades ayant un bénéfice maximal de l'immunothérapie, permettant ainsi de sélectionner au mieux des groupes de patients ; en effet, la survie globale médiane était de 3,55 mois [90% IC (2,92-6,47)] chez les malades ayant une TMB clonale >10,6 et ayant reçu des soins de support versus 8,71 mois [90% IC (6,83-14,4)] [HR : 0,19 ; 90% IC (0,08-0,45) ; p=0,002)] chez les malades ayant reçu l’association trémélimumab et durvalumab, et de 3,15 mois [90% IC (2,66-3,98) chez les malades ayant une TMB sous-clonales>26 versus 5,47 mois [90% IC (3,09-10.0)] [HR = 0,32 ; 90% IC (0,16-0,67) ; p=0,011]. La prise préalable d’un traitement par anti-EGFR était associée à une augmentation de la proportion de mutations sous-clonales (78,3% dans le bras des malades ayant reçu des anti-EGFR versus 53,7%, dans le bras des malades n’en ayant pas reçu ; p<0.0001), ainsi qu’à une augmentation de la TMB plasmatique (TMB plasmatique médiane de 24,9 ; 95% IC (18,2-31,6) versus 13,4 ; 95% IC (11,5-16,3) ; p<0.0001).
Impact des mutations sur la TMB
La plupart des mutations au niveau des gènes-clés de réparation de l'ADN avait un impact sur la TMB plasmatique et sur la TMB sous-clonale, mais pas sur la TMB clonale, et survenait à de faibles fréquences relatives de mutations alléliques. Un traitement préalable par anti-EGFR pourrait augmenter la TMB plasmatique et avoir un impact sur la clonalité des mutations détectées. La plupart (99/101) des patients n’ayant pas reçu d'anti-EGFR avaient des mutations RAS/BRAF. Ces mutations driver pourraient également avoir un impact sur l'architecture clonale et le séquençage des tissus est actuellement en cours pour confirmer si les anti-EGFR conduisent à une augmentation de la TMB
Bien que de nombreux gènes soient associés à la TMB, seules les mutations de BRCA1 semblaient prédictives de l'effet du traitement [HR=0,20 ; 90% IC (0,07-0,58) ; p-interaction=0,035)]. Dans cette étude, les mutations clonales et subclonales semblent importantes pour sélectionner les patients qui pourraient tirer profit de l’association durvalumab-trémélimumab. Il est toutefois important de noter que des seuils différents ont été utilisés pour définir une TMB sous-clonale élevée (>26) et une TMB clonale élevée (>10.6).
Une TMB élevée semble donc être un biomarqueur intéressant prédictif de la réponse aux ICI chez les malades atteints de mCCR de phénotype pMMR/MSS, les premiers résultats semblant indiquer un bénéfice limité sur la survie globale. On peut toutefois s’interroger sur le fait que les auteurs n’aient pas mentionné de résultats quant à la PFS.
Conclusion
En conclusion, une grande partie des mutations contribuant à la TMB plasmatique dans le CO.26 étaient dues à des altérations sous-clonales. Les mutations clonales et subclonales semblent importantes pour sélectionner les patients qui pourraient tirer profit de l’association durvalumab-trémélimumab.
Un traitement préalable, tel qu’une thérapie anti-EGFR, pourrait être un déterminant important de l'architecture clonale et de la TMB plasmatique. Cela pourrait expliquer pourquoi le CO.26 a démontré un bénéfice de l'immunothérapie, alors que d'autres études sur le mCRC de phénotype pMMR/MSS et des lignes de thérapie antérieures ne l'ont pas fait.
Cette étude ne précise pas clairement si les altérations sous-clonales identifiées dans les gènes de réparation de l’ADN sont ou non des variants d’intérêt, i.e pathogènes, ou s’il s’agit simplement de polymorphismes, fréquemment observés lorsqu’il s’agit de longs gènes (comme c’est notamment le cas ici). Par ailleurs, il aurait été intéressant de préciser quels gènes du système MMR ont été étudiés.
La classification CMS (Consensus Molecular Subtype), qui permet une meilleure compréhension de l’hétérogénéité moléculaire des CCR, pourrait être un outil d’intérêt pour le développement de nouvelles stratégies d’immunothérapie dans les CCR de phénotype pMMR/MSS.