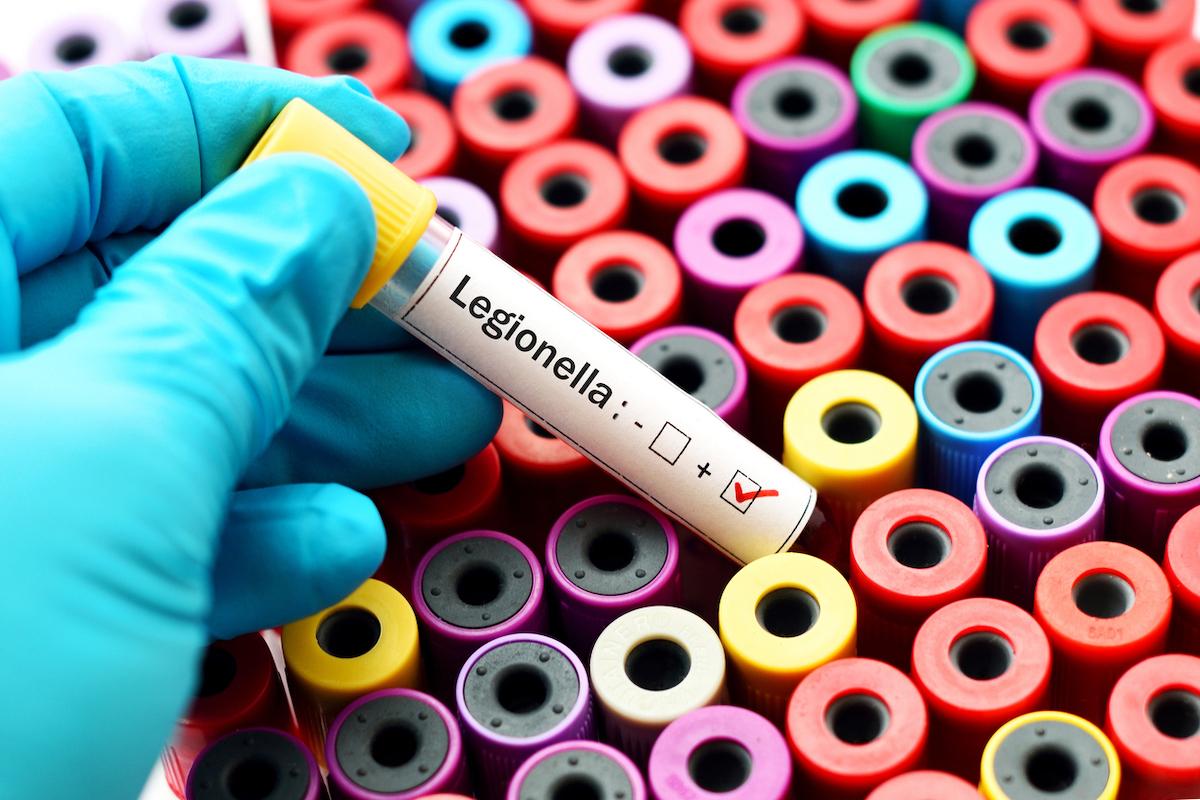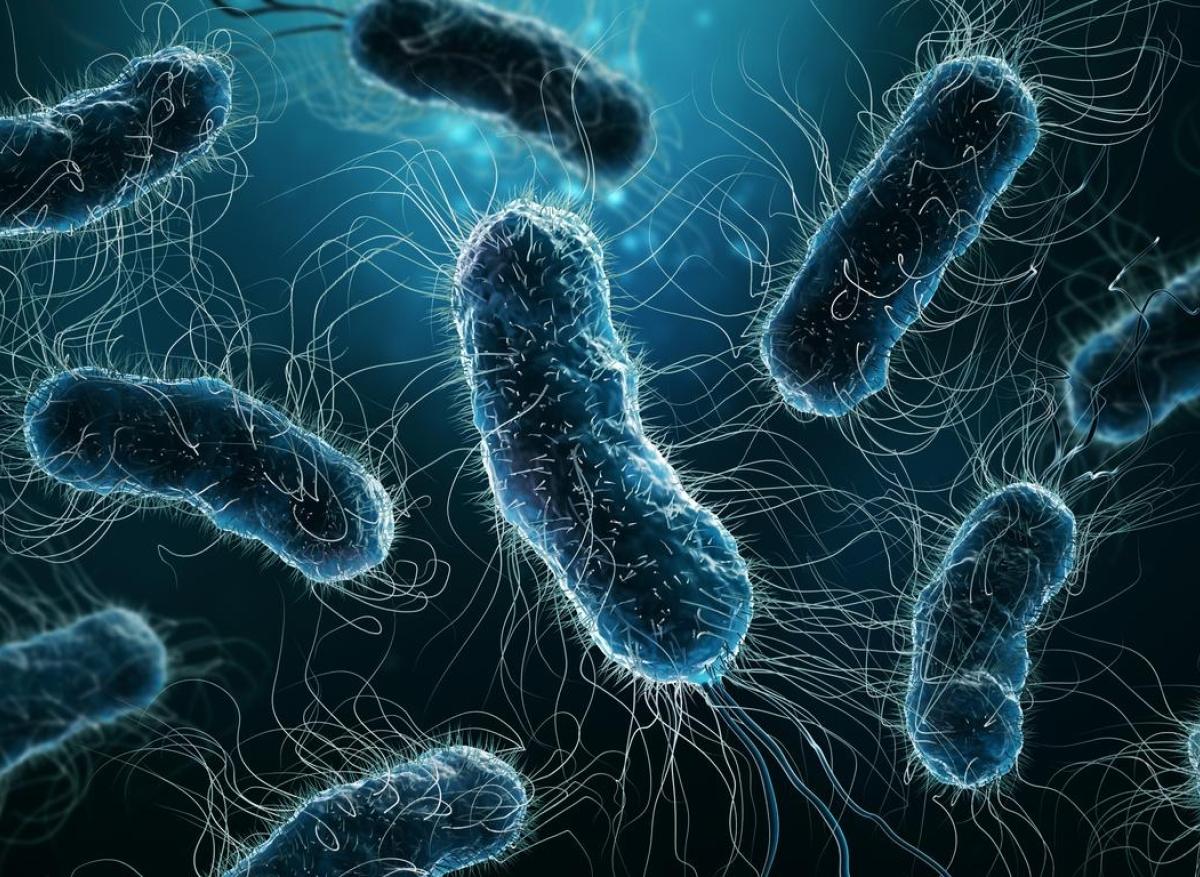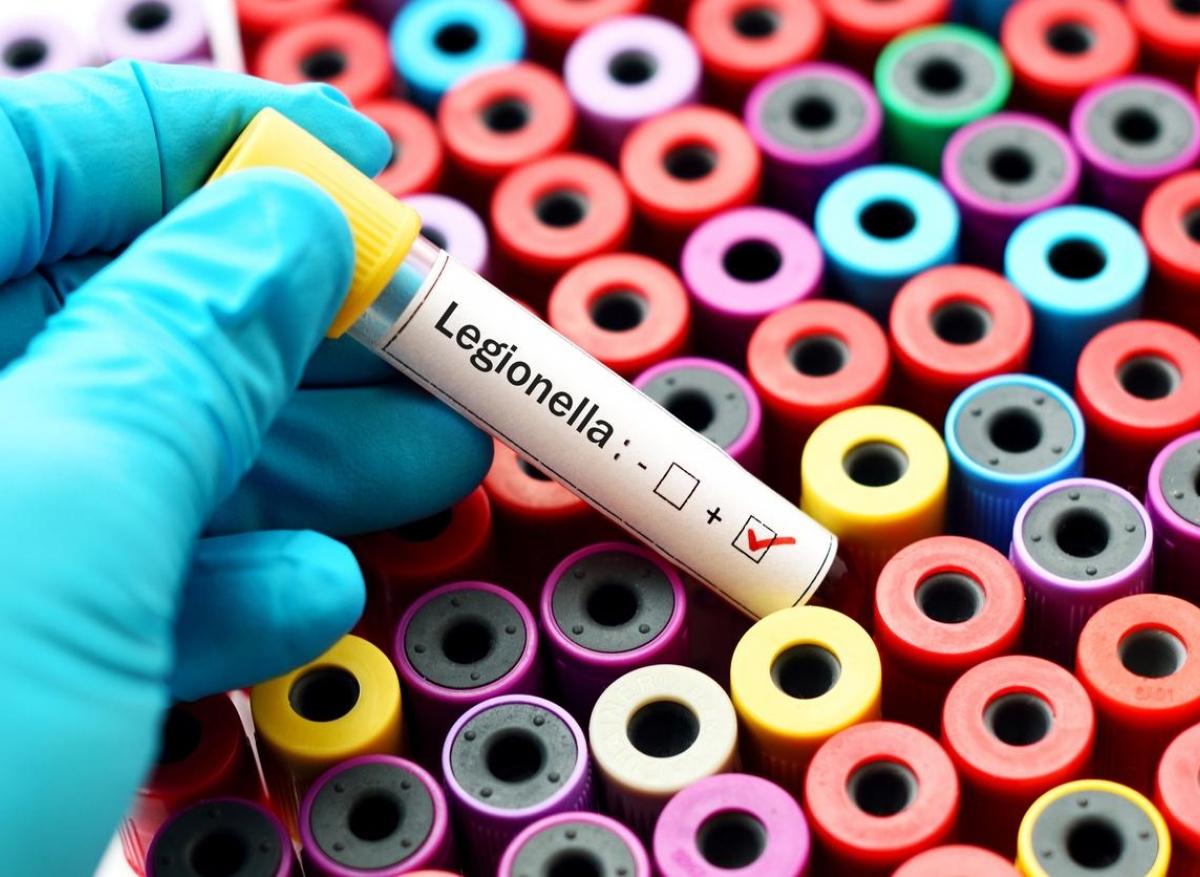Infectiologie
Légionellose : un risque environnemental qui évolue avec le climat
Une idée fausse très répandue veut que la légionelle ne se trouve que dans les climatiseurs et les chauffe-eaux. Cependant, avec le changement climatique, les gens sont susceptibles d'être exposés à cette bactérie via d'autres sources, notamment le sol.

- wildpixel/istock
La légionellose, qu’elle se présente sous forme de la bénigne fièvre de Pontiac ou de pneumonie sévère (maladie des légionnaires), représente 5 à 15 % des pneumonies communautaires et reste associée à une mortalité de 10 %. Traditionnellement liée à la contamination des systèmes de climatisation ou des réseaux d’eau par Legionella pneumophila, elle a récemment été marquée par une progression des cas imputables à L. longbeachae, espèce présente dans les sols et les terreaux. En Australie, une augmentation des notifications entre 2021 et 2022, parallèlement à de fortes inondations, a conduit à examiner l’évolution de l’exposition sérologique.
Publiée dans The Journal of Infectious Diseases, une étude de séroprévalence menée sur 1001 donneurs de sang dans le Queensland, comparant deux périodes (2016 et 2023), montre une stabilité globale du portage d’anticorps anti-Legionella (32 %), mais une diminution significative de la séropositivité pour L. pneumophila (19 % à 13 % pour SG1-6 ; p=0,018) et une augmentation pour L. longbeachae (1 % à 3 % ; p=0,036). Ces résultats traduisent une recomposition des expositions environnementales et confirment l’émergence de la voie « terreau » comme source d’infection.
Un agent infectieux ancien et de nouvelles sources
L’analyse fine montre que les sérogroupes de L. pneumophila sont associés à des zones urbanisées et agricoles, avec une corrélation significative à la pluviométrie médiane annuelle. L’impact des inondations sur la dispersion hydrique des légionelles est ainsi conforté par la survenue concomitante d’épidémies locales. Pour L. longbeachae, la séropositivité reste faible mais en hausse, en cohérence avec la multiplication des cas cliniques rapportés, notamment chez les jardiniers.
L’examen des sous-groupes de malades n’a pas montré de différence selon l’âge ou le sexe, contrairement à la distribution clinique habituellement plus masculine. La tolérance rapportée est celle du diagnostic sérologique. Les données de l’étude confirment la morbidité potentielle en cas d’infection, surtout chez les sujets âgés, immunodéprimés ou porteurs de comorbidités.
Méthodologie et implications pour la pratique
Ces résultats proviennent d’une étude transversale reposant sur le dépistage d’IgG anti-Legionella par immunofluorescence indirecte dans des plasmas de donneurs de sang. Si l’approche permet une large couverture géographique et temporelle, elle comporte des limites : représentativité partielle de la population adulte, absence de données pédiatriques, co-expositions multiples rendant difficile l’attribution à une espèce, et exclusion de cas bénins comme la fièvre de Pontiac. Malgré ces biais, l’étude illustre le rôle des facteurs climatiques et des usages du sol dans l’épidémiologie des légionelles.
Selon les auteurs, le diagnostic de pneumonie communautaire doit intégrer l’exposition à l’eau mais aussi au sol et aux terreaux. La prévention repose sur la surveillance des réseaux hydriques, mais également sur l’information du grand public, port de gants et de masque lors du jardinage, et la vigilance accrue envers les populations fragiles. Les perspectives de recherche incluent le suivi à long terme de l’incidence de L. longbeachae, l’étude de son réservoir environnemental, et l’adaptation des politiques de santé publique aux risques liés au changement climatique.