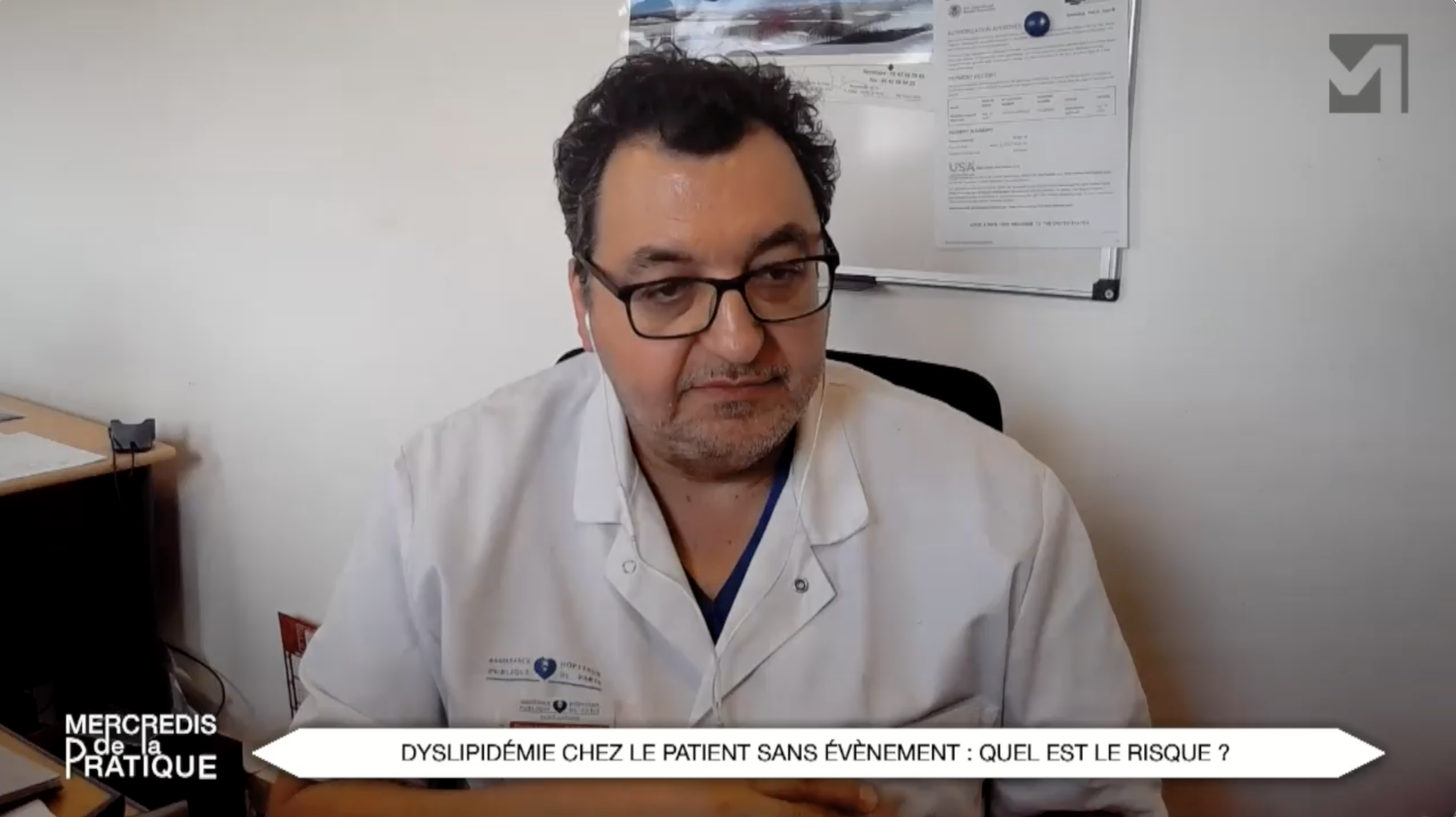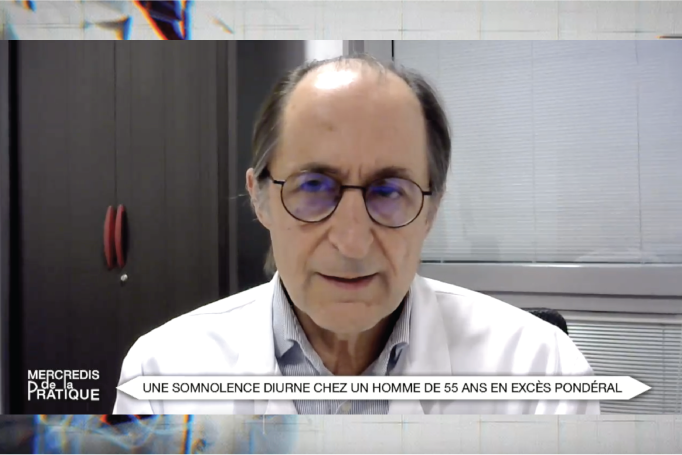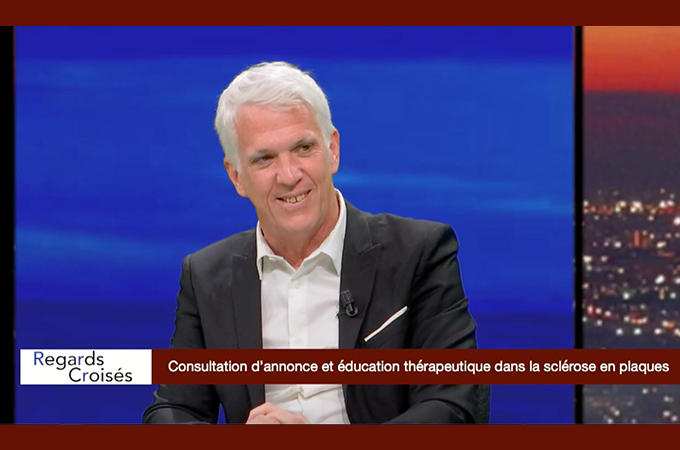Onco-Sein
Contraception hormonale et cancer du sein : le risque dépend du progestatif
Une large étude suédoise montre que les contraceptifs hormonaux seraient associés à une augmentation modérée du risque de cancer du sein, avec des différences importantes selon le type de progestatif. Le désogestrel apparaît ainsi plus à risque que le lévonorgestrel.

- Liudmila Chernetska/istock
L’incidence du cancer du sein continue d’augmenter dans le monde, y compris chez les femmes préménopausées. Dans ce contexte, les contraceptifs hormonaux, bien que conférant un risque individuel modeste, ont un impact de santé publique potentiellement important du fait de leur large utilisation. Les rôles des œstrogènes et des progestatifs dans la prolifération des cellules mammaires et la promotion tumorale sont connus, mais la contribution spécifique des différents types de progestatifs restait à clarifier.
Cette étude de cohorte suédoise a inclus plus de deux millions de femmes âgées de 13 à 49 ans suivies entre 2006 et 2019. Selon les résultats publiés dans le JAMA Oncology, 16 385 cas de cancer du sein (in situ et invasif) ont été recensés sur plus de 21 millions de personnes-années. L’utilisation d’un contraceptif hormonal, qu’il soit combiné ou progestatif seul, est associée à une augmentation significative du risque de cancer du sein (HR global : 1,24 ; IC à 95 % : 1,20–1,28), soit 1 cas supplémentaire pour 7752 utilisatrices. Le risque serait légèrement plus élevé pour les formulations à progestatif seul (HR : 1,21 ; IC à 95 % : 1,17–1,25) par rapport aux combinés (HR : 1,12 ; IC à 95 % : 1,07–1,17).
Un surrisque lié à certains progestatifs, notamment le désogestrel
L’analyse détaillée selon le type de progestatif révèle des disparités notables. Le désogestrel, utilisé seul par voie orale, en association, ou sous forme d’implant (métabolisé en étonogestrel), serait associé à un surrisque significatif, avec des HR allant de 1,18 à 1,22 selon la formulation. À l’inverse, le lévonorgestrel, utilisé dans les pilules combinées ou dans les systèmes intra-utérins (SIU) à 52 mg, serait associé à des risques moindres (HR : 1,09 et 1,13, respectivement). Aucune augmentation significative du risque n’a été observée pour les injections de médroxyprogestérone, les anneaux vaginaux à étonogestrel ou les pilules combinées à drospirénone.
L’étude suggère aussi que l’œstrogène pourrait moduler l’effet délétère des progestatifs : les formulations combinées entraîneraient un risque moindre par milligramme de progestatif que les formulations progestatives seules. Par ailleurs, le désogestrel semble biologiquement plus prolifératif, en raison de sa faible affinité pour les récepteurs androgéniques (à effet antiprolifératif) par rapport au lévonorgestrel. En termes absolus, les contraceptifs à base de désogestrel induiraient entre 10 et 13 cas supplémentaires de cancer du sein pour 100 000 personnes-années, contre 5 à 8 cas pour ceux à base de lévonorgestrel.
Une cohorte unique pour des données à interpréter avec nuance
Les données proviennent des registres nationaux suédois, incluant prescriptions, diagnostics et caractéristiques sociodémographiques, offrant une couverture quasi exhaustive de la population féminine en âge de procréer. Cette large base permet d’analyser des produits rarement étudiés ailleurs, comme l’implant à étonogestrel ou le SIU au lévonorgestrel, avec une puissance statistique inédite. L’exposition contraceptive était définie par les ordonnances délivrées, et le suivi s’étendait jusqu’à 13 ans. Les analyses ont été ajustées sur l’âge, la parité, le statut socio-économique et le mode de contraception. Des biais potentiels (arrêt prématuré, mauvaise observance, facteurs de risque non mesurés) sont discutés, mais n’altèrent pas les résultats principaux.
Selon les auteurs, cette étude confirme que le risque absolu reste faible, mais souligne l’importance d’une prescription personnalisée. En pratique, ces données renforcent la pertinence d’une discussion éclairée sur les bénéfices et risques des différentes options contraceptives, en tenant compte des antécédents familiaux, de l’âge et des préférences individuelles. Des recherches complémentaires intégrant des méthodologies d’inférence causale et des comparaisons internationales pourraient affiner ces résultats et guider les recommandations futures.