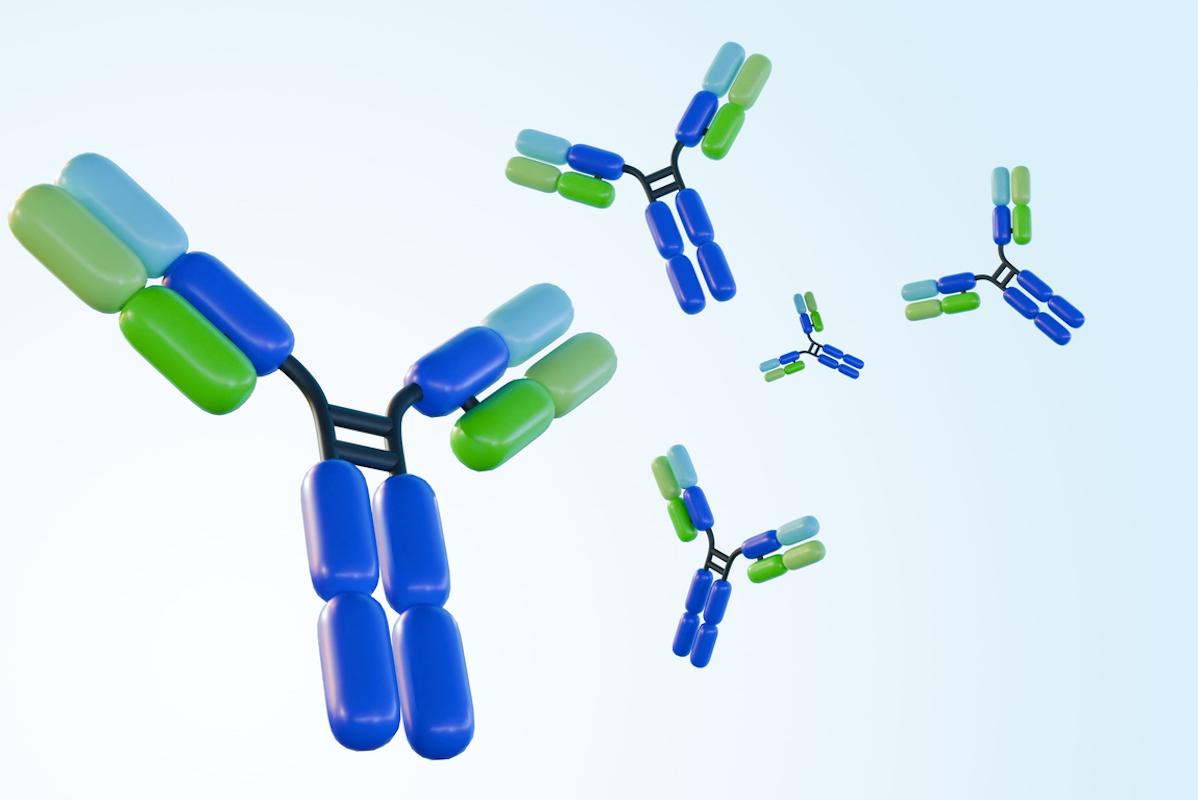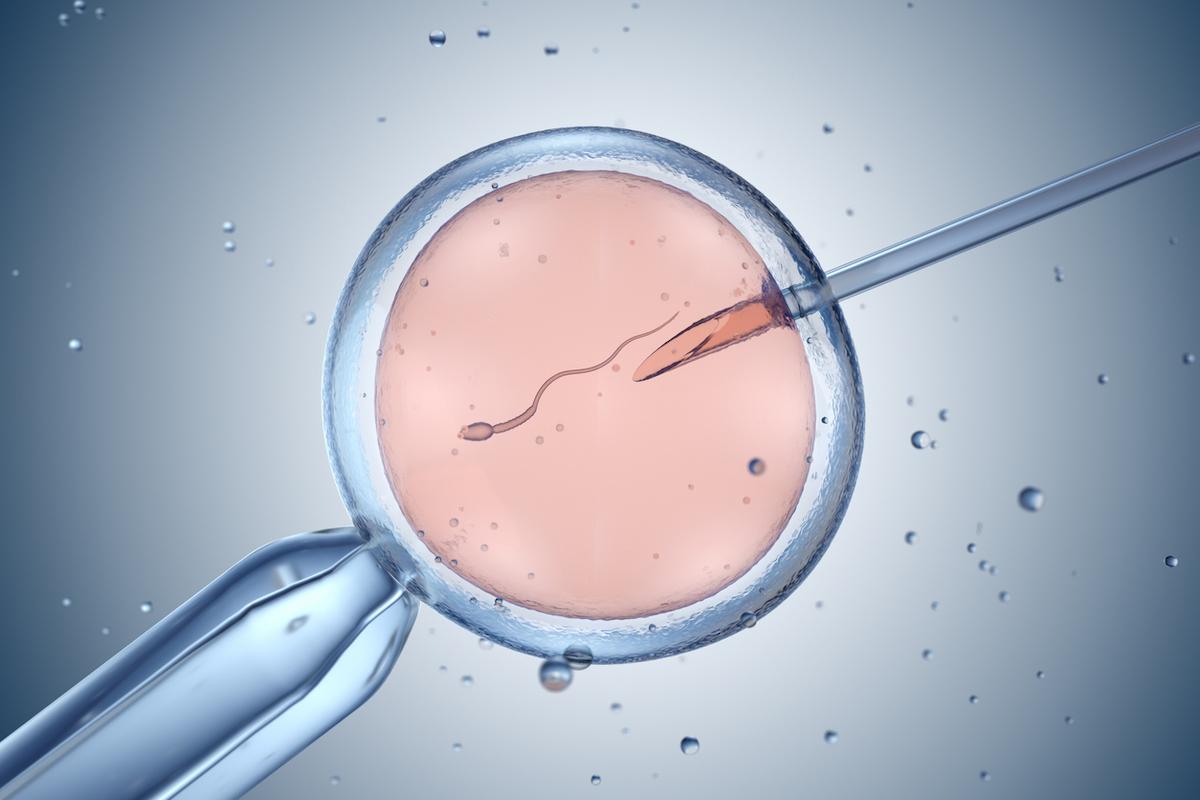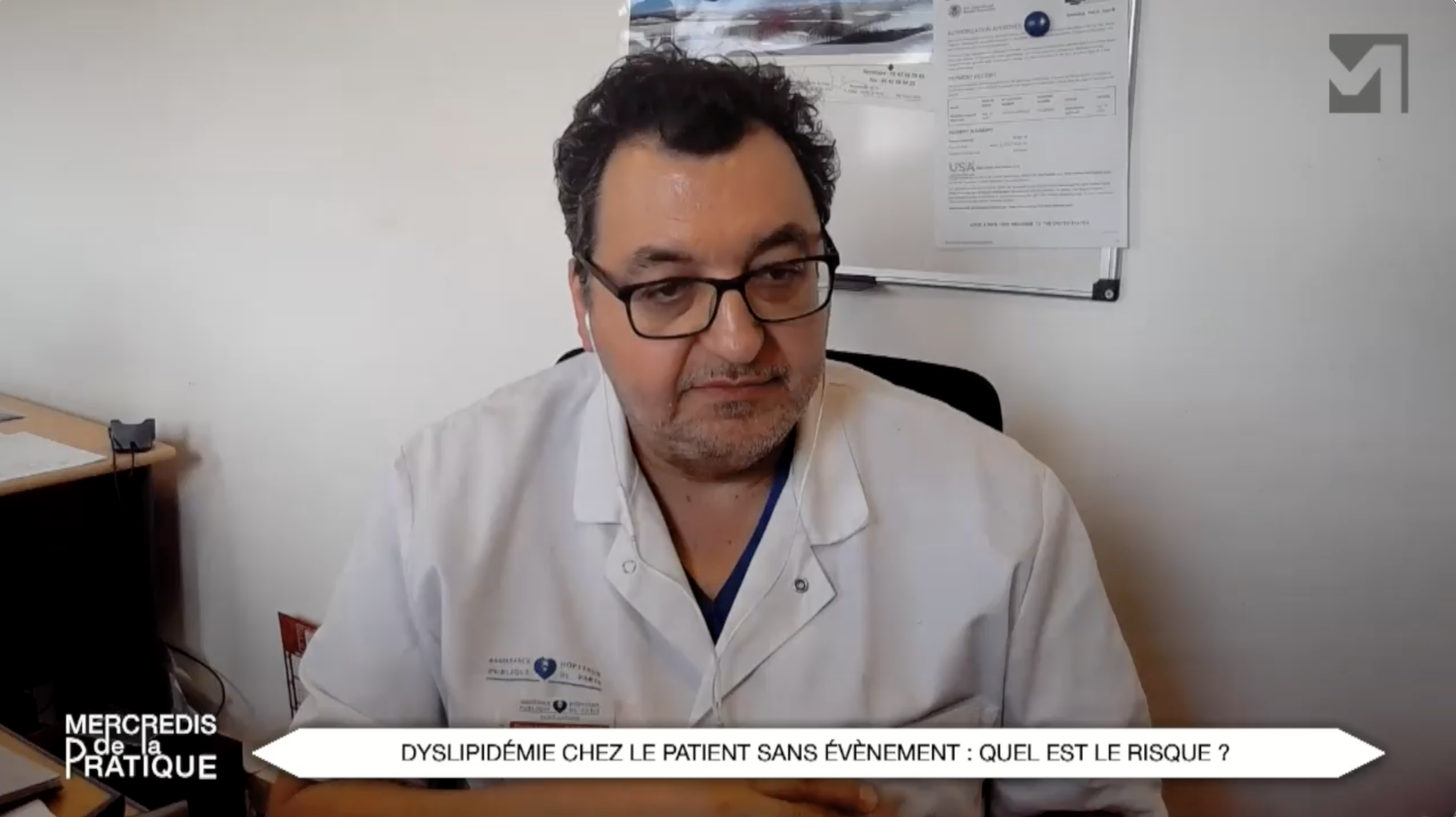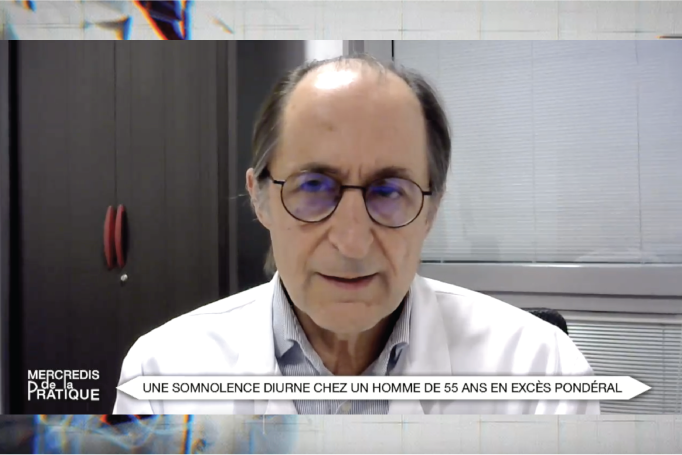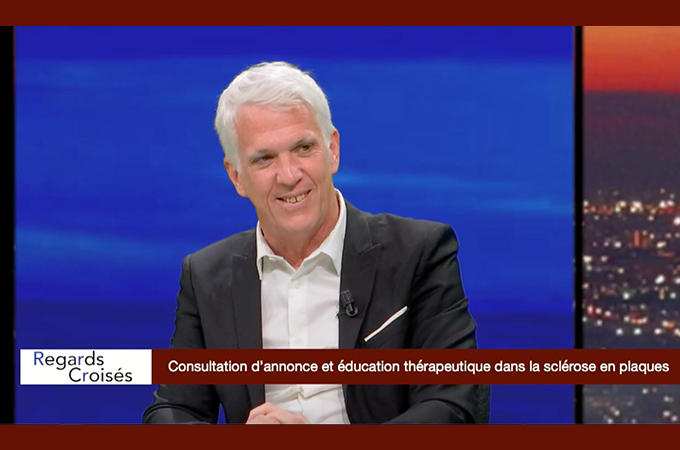Neurologie
Sclérose en plaques : la ménopause n’accélère pas la progression du handicap
Dans une cohorte australienne, la ménopause n’augmente ni le risque de progression confirmée du handicap (CDP) ni le passage en forme secondairement progressive (SPMS) chez les femmes atteintes de SEP à début rémittent. L’âge, la durée de la maladie et l’exposition aux traitements de haute efficacité pèsent davantage sur la trajectoire du handicap que le statut ménopausique lui-même.
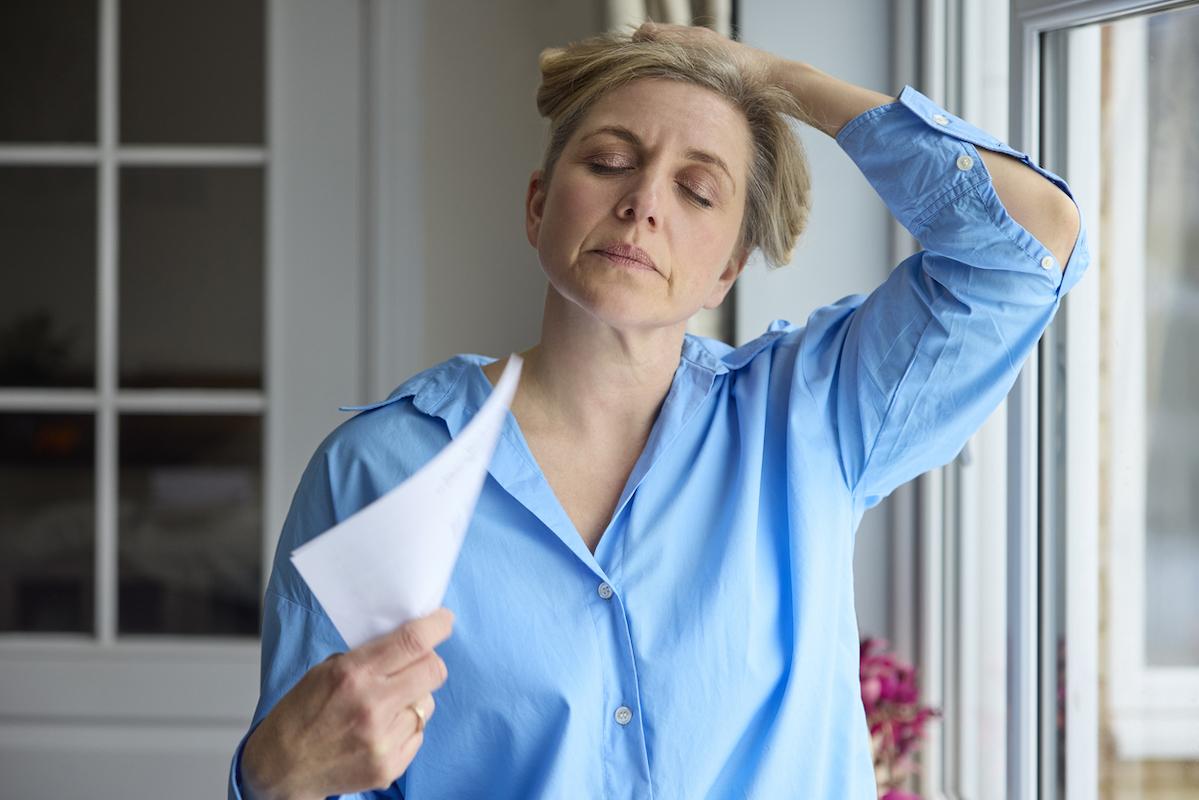
- Highwaystarz-Photography/istock
La sclérose en plaques (SEP) a un dimorphisme sexuel marqué et son âge d’apparition (entre 20 et 40 ans) expose la majorité des femmes à traverser la ménopause au cours de l’évolution de la maladie. Les fluctuations hormonales et la chute estrogéno-progestative pourraient théoriquement infléchir la balance neuro-inflammation/neurodégénérescence. Dans cette étude rétrospective fondée sur des données prospectives du registre MSBase australien, 987 femmes avec SEP à début rémittent, statut ménopausique renseigné et ≥3 mesures EDSS, ont été analysées (583 préménopausées, 404 postménopausées ; âge médian de la ménopause 48,5 ans).
Selon les résultats publiés dans le JAMA Neurology, après ajustements multivariés (âge au début de la SEP, durée de maladie, EDSS de base, poussées de base et exposition aux traitements de haute efficacité modélisée dans le temps), la ménopause ne serat pas associée à un risque accru de risque de progression confirmée du handicap (CDP) (HR 0,95 ; IC à 95 % 0,70–1,29 ; p = 0,70) ni de passage en forme secondairement progressive (SPMS) (HR 1,00 ; 0,60–1,67 ; p = 1,00). Une analyse d’« inflexion » de la pente EDSS, menée chez 209 femmes suivies avant et après la ménopause, ne retrouve pas de changement de trajectoire imputable à celle-ci.
L’âge compte plus que l’ovaire
Au-delà du critère principal, l’exposition cumulative aux traitements de haute efficacité et l’âge/durée de maladie modifiaient substantiellement le risque de progression, alors que la ménopause ne constituait pas un facteur indépendant. L’analyse confirme une relation non linéaire entre âge au début de la SEP et CDP, sans effet propre de la ménopause. Le risque n’était pas majoré chez les femmes avec ménopause précoce (<45 ans) par rapport aux autres, même si les causes d’une ménopause non naturelle peuvent constituer des facteurs confondants.
Le recueil transversal de symptômes suggère que les troubles vasomoteurs, cognitifs, de l’humeur ou urinaires de la ménopause peuvent majorer la charge symptomatique sans traduire une aggravation EDSS. Aucun signal de tolérance médicamenteuse spécifique lié au statut ménopausique n’a été observé ; les trajectoires défavorables rapportées dans certaines séries antérieures pourraient refléter des différences de modèles statistiques, de fenêtres temporelles ou d’issues privilégiées (atrophie corticale, cognition).
Ménopause et SEP : rassurer sans relâcher l’intensification thérapeutique
L’étude exploite MSBase (extraction 01/07/2023), incluant des femmes recrutées dans huit centres neuro-immunologiques australiens (2018–2021), avec modèles de Cox à covariables dépendantes du temps et analyses longitudinales EDSS autour de la ménopause. La taille d’échantillon, la phasage pré/post-ménopause et l’ajustement sur l’exposition aux traitements renforcent la validité interne. Des limites persistent : statut ménopausique auto-rapporté sans distinction robuste entre ménopause naturelle, médicale ou chirurgicale ; absence de données longitudinales hormonales, d’IMC et d’usage de THM ; issue centrée sur l’EDSS, moins sensible aux domaines cognitifs ; généralisation surtout aux populations comparables à l’Australie.
Selon les auteurs, ces résultats sont rassurants : ils ne justifient ni une escalade thérapeutique motivée par la seule ménopause, ni une réduction a priori de l’ambition de contrôle de la maladie. Ils confortent une stratégie axée sur l’optimisation et la persistance des traitements de haute efficacité lorsque indiqués, la surveillance attentive des comorbidités liées à l’âge et une prise en charge multidimensionnelle des symptômes ménopausiques (mesures de mode de vie, THS et alternatives non hormonales selon les profils de risque). En pratique, la ménopause apparaît comme un facteur d’âge reproductif additif mais non déterminant dans la progression du handicap de la SEP, laissant la main aux déterminants classiques et modifiables de la maladie.