Infectiologie
Covid-19 : pas d’effet préventif de l’hydroxychloroquine à dose forte
Après exposition potentiellement contaminante, la prise dans les 4 jours d’hydroxychloroquine à forte dose n’est pas associée à une réduction cliniquement significative du risque de maladie Covid-19.
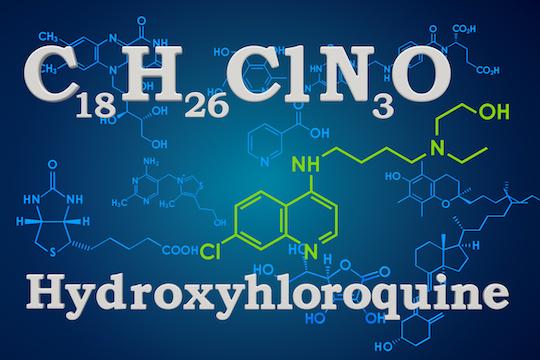
- AlexLMX/istock
Chez des personnes qui ont eu des contacts potentiellement infectants avec des malades Covid-19 contagieux, l’hydoxychloroquine à forte dose ne semble pas conférer de protection contre une maladie pulmonaire à SARS-Cov-2. Ces résultats sont issus d’une étude randomisée publiée dans le New England Journal of Medicine.
Certains chercheurs pensent que la chloroquine et l'hydroxychloroquine est intéressante pour réduire le portage viral et empêcher une évolution défavorable de la maladie à SARS-CoV-2. In vitro en effet, l'hydroxychloroquine peut inhiber la réplication du SARS-CoV-2.
Si des études observationnelles ont suggéré un bénéfice à un stade précoce de l'hydroxychloroquine pour le traitement de la Covid-19, d'autres études, randomisées celles-là, ont eu des résultats mitigés.
Un essai randomisé
Cet essai randomisé teste l'hydroxychloroquine comme prophylaxie post-exposition de le Covid-19. Il s’agit d’un essai dit « pragmatique » de méthodologie originale, dans lequel les participants ont été recrutés par le biais des médias sociaux et où presque toutes les données ont été rapportées par les participants : c’est donc du déclaratif presque pur.
Les adultes qui ont décrit une exposition à haut risque ou à risque modéré avec une personne atteinte de Covid-19 (contact avec une personne positive au coronavirus pendant plus de 10 minutes à une distance de deux mètres ou moins), au domicile ou en milieu professionnel, ont reçu soit de l'hydroxychloroquine, soit un placebo (par courrier) dans les 4 jours suivant l'exposition déclarée, et avant que les symptômes ne se développent.
Une étude sur plus de 800 personnes
L’étude a donc recruté 821 participants exposés au virus et une maladie (considérée comme compatible avec une Covid-19) s'est développée chez 107 participants (13,0%). Un test PCR de confirmation a été réalisé chez moins de 3% des participants.
L’apparition d'une maladie compatible avec une Covid-19 n’a pas été observée de manière significativement différente entre les personnes recevant de l'hydroxychloroquine (49 sur 414, soit 11,8 %) et celles recevant un placebo (58 sur 407, soit 14,3 %) soit une différence de -2.4 points de pourcentage (IC 95%, −7.0 to 2.2; p=0.35).
Bien que les effets secondaires signalés par les participants aient été significativement plus fréquents chez ceux qui recevaient l'hydroxychloroquine (40,1 %) que chez ceux qui recevaient le placebo (16,8 %), aucun effet indésirable grave n'a été signalé, en particulier cardiovasculaire, mais c’est bien sûr du déclaratif.
Des « études de guerre »
Les points positifs de cette « étude de guerre » sont qu’il s’agit d’une étude randomisée qui teste l’hydroxychloroquine à un stade précoce (avant la maladie), comme recommandé par les promoteurs de ce traitement, et à dose forte (800 mg une fois, suivi de 600 mg en 6 à 8 heures, puis 600 mg par jour pendant 4 jours supplémentaires). A ces doses, et sans association à l’azithromycine (qui majore également l’allongement du QT et le risque de troubles du rythme ventriculaire), l’hydroxychloroquine ne donne pas d’effet cardiovasculaire significatifs (c’est du déclaratif mais si c’était une hécatombe, on le saurait).
Les points négatifs sont qu’il s’agit d’une étude qui est basée sur le seul déclaratif des personnes inclues, tant sur le mode de recrutement par les réseaux sociaux, que sur la prise du médicament (le médicament leur a été envoyé par la poste et on n’a aucun contrôle sur sa prise) et que sur la déclaration de la maladie (seulement 3% des malades ont été testés par PCR). Or, dans cette nouvelle maladie, on sait désormais qu’il n’y a pas toujours de parallélisme strict entre les lésions pulmonaires éventuelles et la dyspnée. On a également pu reprocher à cette étude ses effectifs limité, mais clairement, si un effet important avait été produit par l’hydroxychloroquine, cela se verrait, et un effet minime n’intéresse pas vraiment en infectiologie.
Un pas de plus vers l’inefficacité
Au final, on a un nouvel argument contre l’efficacité éventuelle d’un traitement qui est promu par un chercheur de dimension internationale et son équipe, malheureusement sur des preuves qui d’emblée ne permettaient pas de répondre de façon nette à la.
Encore une fois, cette étude ne clora pas la polémique. Elle démontre simplement que dans un modèle expérimental clinique, de taille limitée, l’activité potentiellement antivirale in vitro ne s’exprime pas in vivo, en tout cas pas de façon cliniquement significative.
Concernant la tolérance, l’hydroxychloroquine seule, même à forte dose, ne semble pas être toxique ce qui est compatible avec son utilisation dans les essais cliniques (plus de 200 dont 60 à visée prophylactique selon un éditorial du New England Journal of Medicine). Mais, cela ne remet pas absolument pas en cause une éventuelle toxicité de l’association des 2 molécules, hydroxychloroquine-azithromycine, qui toutes deux allongent le QT, surtout à forte dose. Il faut relever que l’étude du Lancet qui témoignait d’une magnitude importante de cette toxicité vient d’être rétractée par 3 de ses auteurs en l’absence de possibilité de pouvoir vérifier les données.
Il faudra s’habituer quelques temps encore à avoir dans les grandes revues des études dont on ne sera pas totalement sûr de la fiabilité absolue des paramètres, c’est le prix pour obtenir des données rapidement.
































