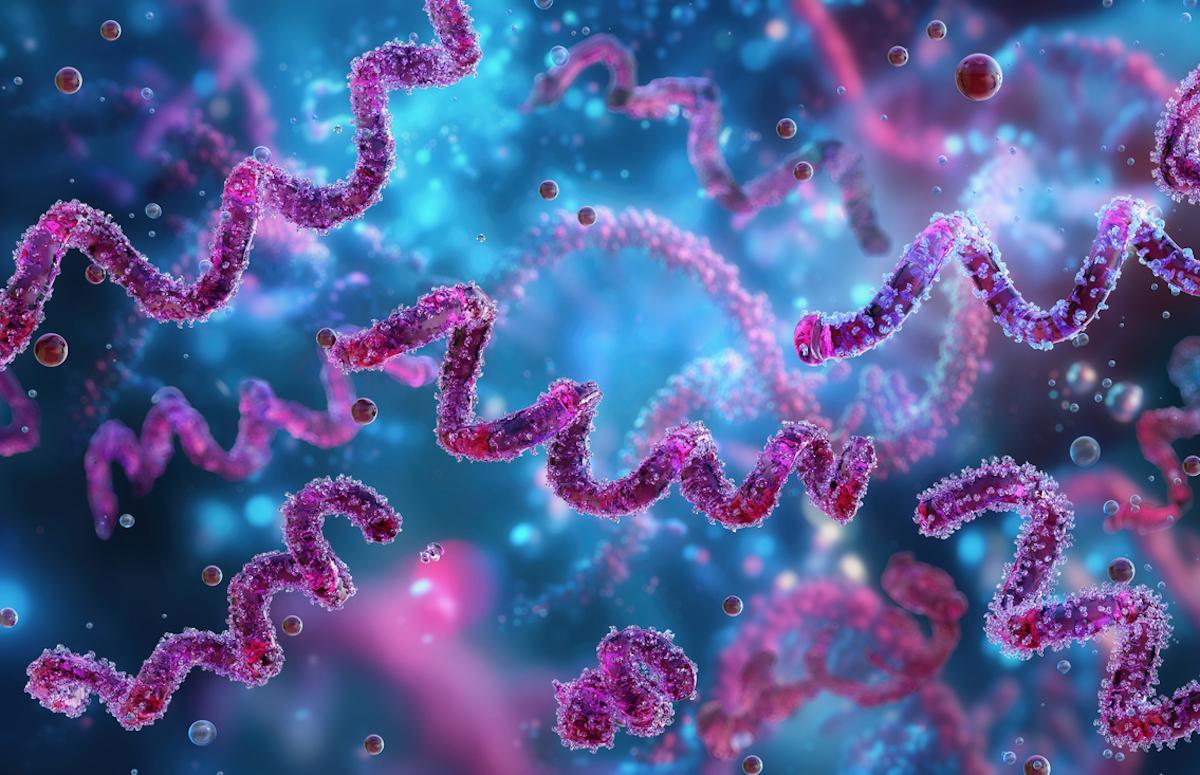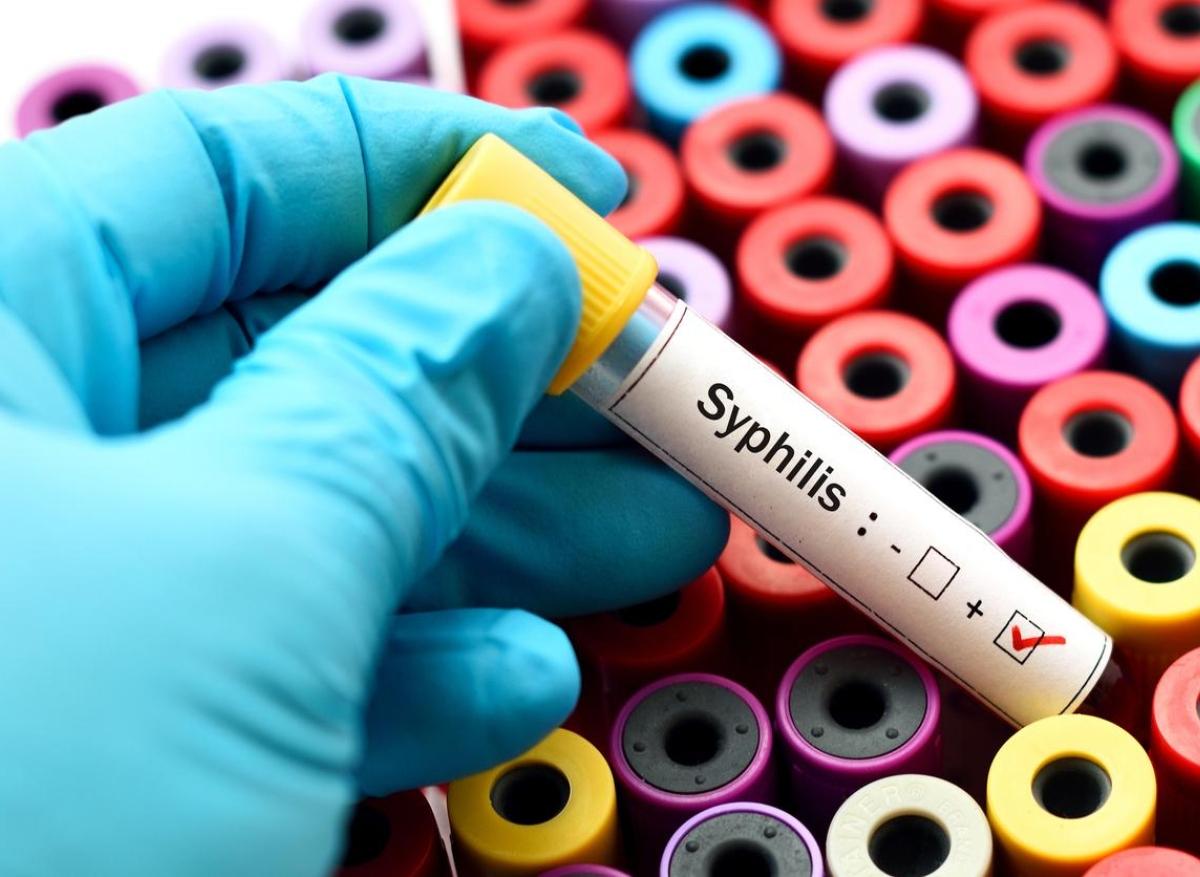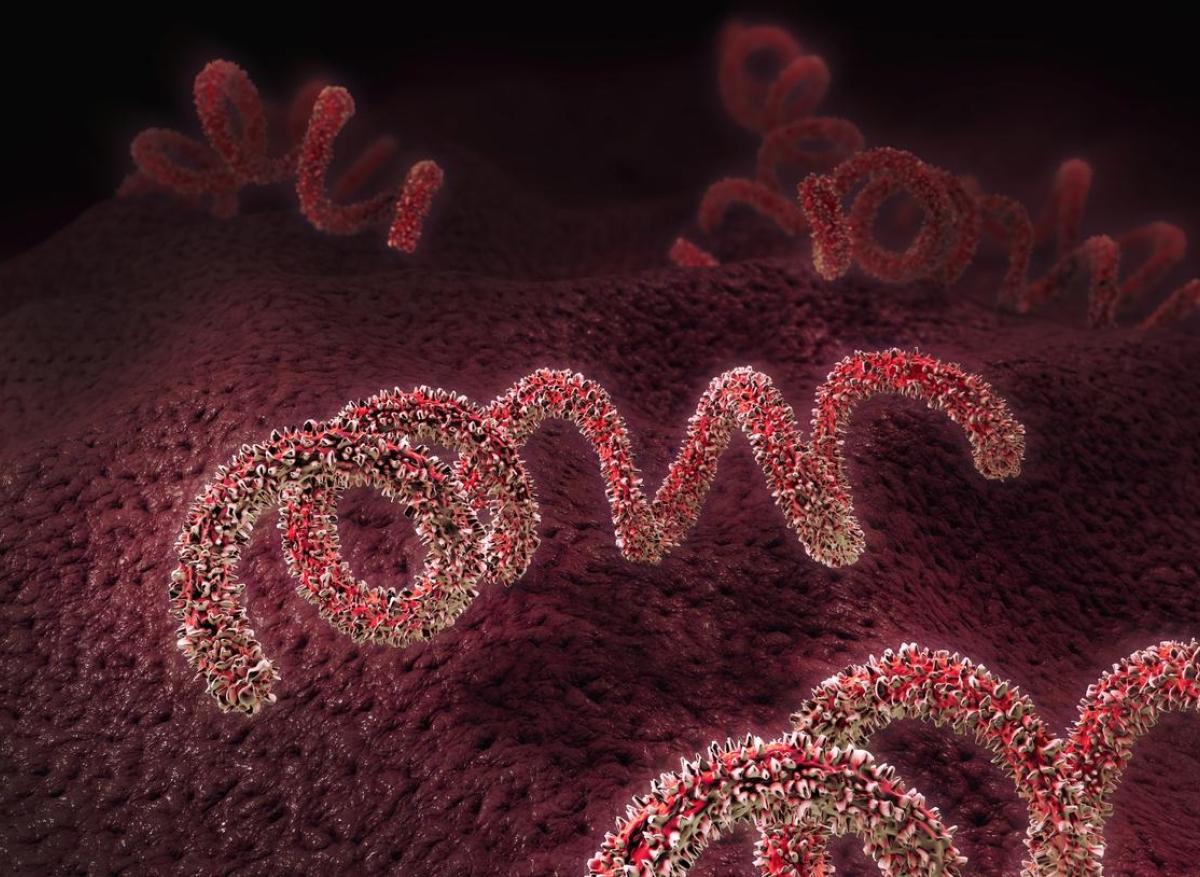Pédiatrie
Syphilis congénitale : une pathologie d’actualité en France
On l’imaginait reléguée dans les chapitres d’une histoire de la médecine. La syphilis congénitale (SC) en fait n’a pas disparu en France.
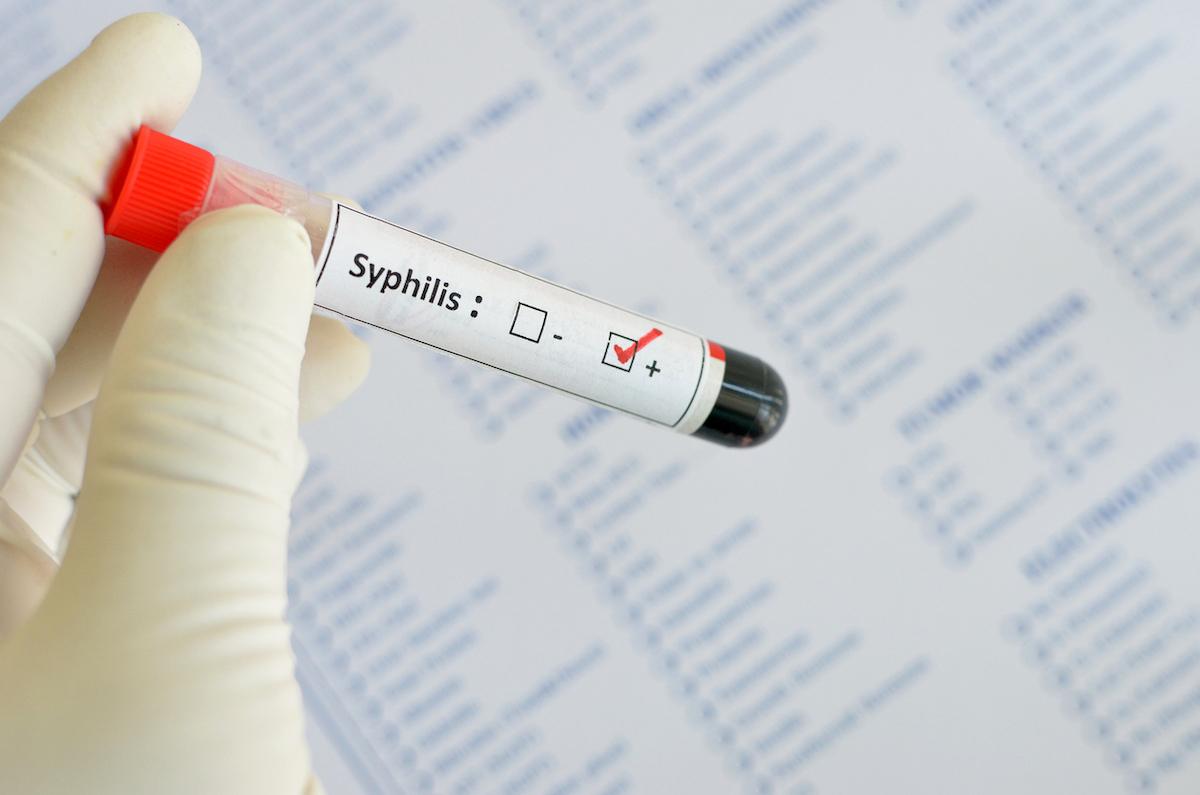
- jarun011/istock
Santé Publique France (LA SYPHILIS CONGÉNITALE EN FRANCE DE 2012 À 2019 Cheick Habilla Kounta et al) note même une augmentation de l’incidence entre 2012 et 2019 de 1,6 à 2,4 pour 100 000 naissances vivantes entre 2012 et 2019 même si le nombre de cas demeure limité. Autre frein à une cartographie précise, les données disponibles actuellement en France ne permettent pas de préciser la fréquence exacte de la syphilis congénitale.
Certains résultats apparaissent toutefois fiables. Par exemple, les régions d'outre-mer (DROM) affichent des taux d'incidence nettement plus élevés (de 13 à 16,7 pour 100 000 naissances vivantes). Ce qui traduit des disparités géographiques importantes, avec une situation particulière en Guyane. En réponse, les autorités ont adopté des mesures spécifiques dans ce territoire comme la mise en place d’un TROD (test rapide d’orientation diagnostique) combiné VIH/syphilis. Cette franche recrudescence est en partie liée à la hausse des cas de syphilis chez les femmes enceintes, dans un contexte de propagation accrue de la maladie parmi les populations hétérosexuelles.
L’étude précise les caractéristiques des cas recensés.
La majorité des enfants atteints de SC (82%) ont été diagnostiqués avant l'âge d'un mois. Près de la moitié des enfants étaient symptomatiques, et 35% étaient nés prématurés. Les mères étaient souvent jeunes (58% avaient moins de 25 ans), précaires (30% sans couverture maladie) et parfois non dépistées pendant leur grossesse (12%). Tous les enfants concernés sont nés en France.
Un cas sur cinq a été recensé dans les DROM et en Ile de France. Environ un tiers des enfants sont nés prématurés. Quant au traitement, il a été initié le jour du diagnostic avec une durée médiane de dix jours. Pour autant, la gravité potentielle de la SC doit être rappelé. La mortalité in utero peut atteindre 40% des cas et la mortalité néonatale 20% en l’absence de dépistage. Dans cette étude, 4% des enfants sont décédés.
12% des mères n’ont pas bénéficié de suivi prénatal
Comment expliquer ces diagnostics de SC alors que le dépistage de la syphilis est obligatoire au cours du premier trimestre de la grossesse ? En fait 12% des mères n'ont pas bénéficié de suivi prénatal. 30% des mères ne disposaient d’aucune couverture maladie. Plus de 30% des mères n’ont pas respectées le nombre de visites prénatales recommandées. Quant au recours à une assurance complémentaire santé, il s’est avéré très limité avec un recours à 19% seulement par les mères concernées. Parmi les mères dépistées, 44% l'ont été tardivement (au troisième trimestre ou au moment de l'accouchement).
Autre facteur limitant, 15% des mères étaient déjà enceintes avant leur arrivée en France. Ce qui limite les possibilités de prévention de la transmission mère-enfant. Un pas doit être franchi afin d’atteindre l’objectif fixé par l’OMS pour la région Europe, à savoir moins d’un cas pour 100 00 en 2030.
Des résultats préoccupants
Alors que les données sont loin d’être exhaustives, « les résultats de cette étude sont préoccupants », écrivent les auteurs si l’objectif d’élimination de la transmission mère-enfant est maintenu. D’autant que certains cas échappent encore aux mailles du filet. Santé Publique France envisage pour y répondre la mise en place d’une déclaration obligatoire des cas de SC. Sont pointés « les opportunités manquées du dépistage prénatal et la nécessité d’adapter le dispositif de prévention ».
Au-delà des professionnels de santé qui sont invités à vérifier que la sérologie syphilis figure dans le dossier médical des femmes enceintes à plusieurs moments : pendant la grossesse, à l’accouchement, avant la sortie de la maternité, la société civile doit être également être mobilisée. Des actions comme le dépistage dans les communautés en dehors des établissements de soins, le recours aux tests de diagnostics rapides se révèlent performantes. Elles renforceront les actions ciblées en direction des populations vulnérables comme les femmes jeunes, migrantes et en situation de précarité. A condition de s’y engager.