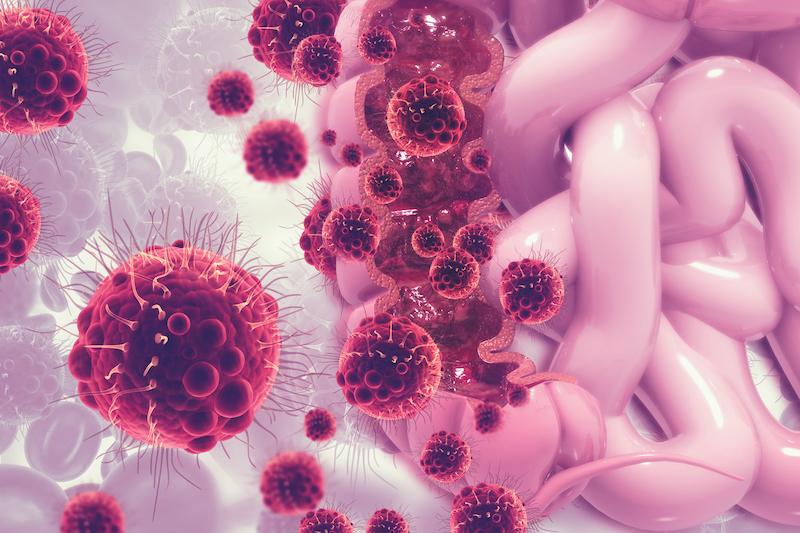Onco-digestif
Cancers coliques de stade III : valeur pronostique des dépôts tumoraux
La classification TNM est primordiale pour orienter les cliniciens dans leurs choix thérapeutiques. L’ajout régulier de nouveaux marqueurs à cette classification permet d’être de plus en plus performant. Les dépôts tumoraux sont aujourd’hui au cœur des discussions
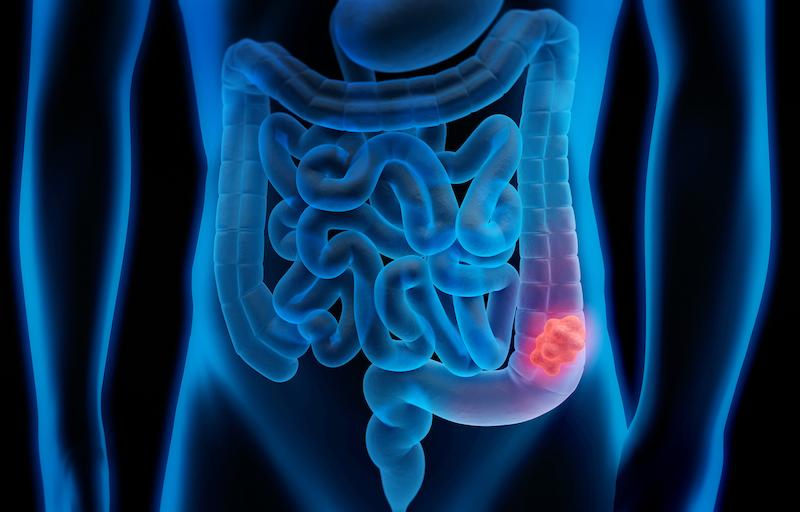
- Istock/peterschreiber.media
A l’ère de la modulation de la durée et du type de traitement adjuvant des cancers coliques de stade III en fonction de critères anatomo-pathologiques, la présence de dépôts tumoraux (amas de cellules tumorales dans la graisse péricolique, sans tissu ganglionnaire résiduel reconnaissable), ainsi que leur nombre, devraient être intégrés au compte des ganglions métastatiques dans le stade pN de la classification pTNM, afin d’évaluer au mieux leur pronostic.
De nouveaux marqueurs dans le CCR
La prise en charge du cancer colorectal (CCR) repose largement sur la stadification TNM, développée dans les années 1950, qui a subi de nombreuses évolutions au gré des avancées scientifiques. La dernière version de la classification TNM est la 8ème, mise en place en 2018. Afin de continuer à l’améliorer et à définir des sous-groupes plus pertinents de patients, il est essentiel d’identifier de nouveaux marqueurs histologiques.
Dans le CCR, plusieurs marqueurs d’intérêt sont considérés comme ayant un impact pronostique ; c’est notamment le cas des emboles vasculaires, en particulier veineux extra-muraux (i.e situés au-delà de la musculeuse, au sein de la sous-séreuse colique ou de la graisse péri-rectale), des engainements péri-nerveux et des dépôts tumoraux (DTs) (ou « tumor deposits » dans la littérature anglophone).
Les DTs : un rôle en constante évolution
Les dépôts tumoraux (DTs), qui sont définis comme des foyers tumoraux dans la graisse péri-colique ou péri-rectale, à distance du front d’invasion de la tumeur, dans le territoire de drainage lymphatique de cette dernière, sans tissu ganglionnaire résiduel reconnaissable et ont été décrits en 1935. Cependant, leur définition, ainsi que leur impact clinique ont évolué au cours du temps. Leur présence a été prise en compte pour la première fois dans la 5ème édition de la classification AJCC/TNM, en 1997. Dans les classifications TNM5, puis 6, les DT ont été classés en ganglions métastatiques, respectivement en fonction de leur taille (si >3 mm), puis de leurs contours (arrondis).
Les DTs, qui sont observés dans environ 20% des CCR, ont démontré leur association à un mauvais pronostic dans des études de cohorte. En cela, ils représentent un marqueur pronostique d’intérêt, raison pour laquelle ils ont fait l’objet, dans TNM7, d’une introduction dans le statut ganglionnaire des CCR, sous la forme de la sous-catégorie pN1c. Cette sous-catégorie a ceci de particulier qu’elle correspond à une prise en compte des DTs uniquement en l’absence de métastase ganglionnaire. Ainsi, en présence de métastases ganglionnaires concomitantes, les DTs n’ont pas d’impact sur la stadification de la tumeur.
Cette modalité spécifique d’intégration des DTs dans TNM7 n’a pas manqué de soulever un débat au sein de la communauté médicale : parmi les pathologistes tout d’abord, pour lesquels une telle prise en compte ne reflète pas précisément la réalité physiologique et pronostique de ce marqueur ; parmi les oncologues ensuite, pour lesquels il existe une implication thérapeutique concrète de cette modification, avec une indication potentielle à une chimiothérapie adjuvante. Par ailleurs, de nouvelles données sur les modalités de la chimiothérapie adjuvante dans les CCR sont venues compliquer encore davantage ce débat.
Personnaliser la chimiothérapie adjuvante
En effet, la collaboration internationale IDEA (International Duration Evaluation of Adjuvant Chemotherapy) a permis de personnaliser le type et la durée de la chimiothérapie adjuvante dans les cancers coliques de stade III (i.e avec métastases ganglionnaires) en fonction de critères histologiques, incluant en particulier le nombre de ganglions métastatiques. Le but de la collaboration internationale IDEA, était d’évaluer la non-infériorité de 3 mois de chimiothérapie adjuvante par fluoropyrimidine et oxaliplatine versus 6 mois du même traitement (standard thérapeutique depuis 2004) dans les cancers coliques de stade III dans une analyse commune de 6 essais de phase 3 randomisés.
Bien que la non-infériorité de 3 mois de traitement adjuvant par rapport à 6 mois n'ait pas été démontrée dans la population globale en terme de survie sans rechute et de survie globale, une analyse de sous-groupes a montré que chez les patients recevant le régime FOLFOX, une durée de traitement de 6 mois était supérieure en terme de survie globale à une durée de 3 mois (hazard ratio [HR], 0,80 ; P = 0,0061 pour la supériorité), en particulier chez les patients présentant un cancer colique de stade III à haut risque, correspondant aux tumeurs classées comme pT4 et/ou pN2. En revanche, pour les patients traités par CAPOX, 3 mois de traitement étaient non inférieurs à 6 mois en termes de survie globale (hazard ratio [HR], 0,98 ; P = 0,027 pour la non infériorité).
Le choix entre les schémas FOLFOX ou CAPOX est fait au cas par cas, en fonction de facteurs propres aux patients. Cette étude a montré, indépendamment du schéma et de la durée du traitement, que le pronostic des patients avec un cancer du côlon de stade III était très différent en fonction du groupe à risque auquel ils appartenaient : la survie sans maladie à 5 ans était de 78% versus 58% et la survie globale à 5 ans de 89% versus 73% dans les groupes à bas risque (T1-T3N1) et à haut risque (T4 ou N2), respectivement. Ainsi, il est désormais acquis que la durée de traitement adjuvant dans les cancers coliques de stade III doit reposer sur une prise en compte des critères pT et pN pour guider au mieux le choix thérapeutique.
Dans ce contexte, ne pas prendre en compte les DTs en l’absence de métastases ganglionnaires chez les patients atteint d’un cancer colique de stade III pourrait représenter une sous-évaluation pronostique importante. En outre, certaines études récentes, dont une méta-analyse, ont suggéré que les DTs devraient être ajoutés au compte des ganglions métastatiques (2). Se pose donc la question de la pertinence de l’intégration des DTs au compte des ganglions métastatiques dans le stade pN de la classification pTNM, afin d’évaluer au mieux le pronostic des malades et de définir de manière optimale la durée et le type de traitement adjuvant chez ces malades.
Quel est l’impact pronostic des DTs ?
C’est pourquoi notre groupe a récemment réalisé une analyse post hoc de l’essai clinique IDEA France, c’est-à-dire de 2 010 patients inclus en France dans la collaboration internationale IDEA afin de déterminer l’impact pronostique des DTs sur la survie sans récidive et l’effet de l’ajout des DTs au compte des ganglions métastatiques, sur la base d’un DT = un ganglion métastatique. 184 des 1942 malades inclus dans l’étude (soit 9,5%) avaient des DTs. Les groupes pN1a/b et pN1c présentent une survie sans récidive identique, validant l’intégration de la population pN1c dans les tumeurs de stade III. De plus, un impact pronostique négatif de la présence des DTs (DT comme variable qualitative) est observé, quel que soit le stade pN.
En analyse multivariée, les DTs sont associés à un risque plus élevé de récidive ou de décès (HR=1,36 ; P=0,0201). Les autres facteurs péjoratifs incluent un stade pT4 et/ou pN2 (HR=2,21 ; P<0,001), un traitement adjuvant de 3 mois (HR=1,29, P=0,0029), une tumeur obstructive (HR=1,28; P=0,0233), et le sexe masculin (HR=1,24; P=0,0151). Un total de 35 malades classés initialement pN1 (soit 2,4% de la population) a été reclassé en pN2 après ajout des DTs aux métastases ganglionnaires (DT comme variable quantitative). Ces 35 malades reclassés en pN2 ont une survie sans récidive identique à celle des malades classés initialement pN2.
Tous ces résultats ont été confirmés dans l’essai Nord-Américain CALGB/SWOG 80720, présenté ici, qui retrouvait un impact pronostique péjoratif de la présence de DTs (retrouvés dans 26% des 2 028 patients analysés) quel que soit le stade pN au sein de cette population de cancers coliques de stade III. De manière intéressante, chez les patients ayant des DTs, leur nombre a un effet négatif linéaire sur la survie sans maladie (SSM) et sur la survie globale (SG). Dans cette étude également, en ajoutant les DTs au nombre de métastases ganglionnaires, 104 des 1570 (6,6%) patients initialement considérés comme pN1 ont été reclassés en pN2. Les patients dont le statut pN2 a été modifié ont présenté une SSM (taux de SSM sur 3 ans : 80,3 % contre 65,5 %, P=0,0003) et une SG (taux de SG sur 5 ans : 87,9 % contre 69,1 %, P=0,0005) pires que les patients dont le statut pN1 a été confirmé. Par rapport aux patients initialement classés comme pN2, les patients pN2 reclassés présentaient une SSM similaire (taux de SSM sur 3 ans : 63,1 % contre 65,5 %, P=0,1992). Ainsi, l’ajout du nombre de DTs au nombre de métastases ganglionnaires améliore la précision du pronostic de la stadification du TNM.
Des avancées mais des questions restent en suspens
Toutefois, de nombreuses questions relatives aux DTs restent ouvertes. La première d’entre elles concerne la définition même des DTs dans la dernière classification TNM, i.e TNM8 : en effet, la classification TNM8 est plus restrictive que celle proposée dans TNM7 et on ne parle désormais de DTs que si les nodules tumoraux ne comportent aucune embole lymphatique ou veineux extra-mural ou engainements péri-nerveux sous-jacents.
Cette modification, entre TNM7 et TNM8, est à l’origine d’une controverse parmi les experts. En effet, les DTs peuvent avoir pour origine l’envahissement d’autres structures et notamment provenir d’emboles veineux extra-muraux (i.e situés dans la graisse péri-colique ou péri-rectale). Or, il semble licite de penser que le développement d’un embole veineux au-delà de la structure vasculaire représente une étape supplémentaire d’invasion, et s’accompagne probablement d’une aggravation du pronostic par rapport à un embole vasculaire simple. Le même raisonnement parait applicable aux autres types d’invasions (lymphatique et péri-nerveuse). Par ailleurs, lorsqu’il n’y a pas d’atteinte ganglionnaire associée, ces patients sont donc désormais classés en stade II avec « facteurs de risque pouvant influencer la prise en charge » et non plus en stade III.
Cette exclusion de la catégorie pN1c de ces nodules tumoraux pour lesquels une origine sous-jacente est identifiable se double potentiellement d’un impact thérapeutique non négligeable. En effet, au vu de l’importance cruciale du stade TNM de la maladie dans les choix thérapeutiques du clinicien, l’absence de retentissement sur la stadification TNM de ces DTs, requalifiés en emboles veineux, emboles lymphatiques extra-muraux ou engainements péri-nerveux, entraine le risque d’une désescalade thérapeutique injustifiée chez certains patients, notamment en ce qui concerne le traitement adjuvant, chez des patients dont le pronostic semble pourtant similaire à un stade III.
Quelle place pour les DTs ?
Par ailleurs, la place même des DTs dans la classification TNM fait l’objet de débats. Beaucoup de pathologistes estiment toutefois que la catégorie pN est finalement l’endroit le plus approprié pour prendre en compte les DTs, même si les origines des DTs sont diverses et ne dérivent d’ailleurs pas forcément d’un ganglion métastatique. Les principaux détracteurs de l’inclusion pure et simple des DTs dans le compte des ganglions métastatiques, comme préconisé par notre groupe, arguent du fait que le poids pronostique des DTs et des métastases ganglionnaires, à nombre égal, n’est pas équivalent, les DTs ayant un pronostic plus péjoratif que les métastases ganglionnaires. Dans une étude récente, les auteurs retrouvent un poids pronostique des DTs équivalent à 2 métastases ganglionnaires.
D’autres proposent de créer d’autres catégories dans la classification AJCC/TNM, qui tiendraient compte à la fois de la présence des DTs en plus des métastases ganglionnaires, mais aussi de leur nombre. Ainsi, Pricolo et al. ont montré que les patients atteints de CCR de stade III avec un nombre de DTs supérieur ou égal à 3 avaient une survie globale moins bonne que ceux avec 1 à 2 DTs (P<0,01), tout en étant classés dans la même catégorie TNM (pN1c). Ce pronostic est équivalent aux patients classés pN2. Ces auteurs proposent donc une nouvelle classification, dans laquelle les patients chez lesquels une addition des métastases ganglionnaires et des DTs supérieur à 3 seraient stadifiés « N2c ». Seuls les patients sans atteinte ganglionnaire et avec 1 à 2 DTs resteraient classés dans la catégorie pN1c. Quoi qu’il en soit, il apparaît désormais essentiel de mentionner dans un compte-rendu anatomo-pathologique pour CCR à la fois la présence, mais également le nombre de DTs.
Une approche qualitative plutôt que quantitative ?
Toutes ces études ont en commun une approche « quantitative » de la prise en compte des DTs et de leur inclusion dans une nouvelle stadification TNM. Une autre approche envisagée serait une approche de type « qualitative » Ainsi, dans un récent abstract présenté à l’ASCO 2020, une étude rétrospective a permis d’identifier un impact pronostique important des DTs, qui était présent chez 6% d’une population de près de 75 000 patients atteints de CCR. L'intégration des DTs et des emboles vasculaires dans le statut pN a permis une meilleure prédiction du risque de rechute. Ils proposent ainsi une nouvelle stadification TNM dans laquelle la présence d’emboles vasculaires et de DTs, indépendamment de leur nombre, seraient intégrés au stade N. Mais cette classification demeure d’un usage complexe pour la pratique quotidienne.
Conclusion
En conclusion, les DTs sont un facteur pronostique majeur dans les cancers coliques de stade III, à la fois d’un point de vue qualitatif et quantitatif. Ils représentent une source d’information décisive et ne peuvent plus être ignorés ni dans les comptes rendus anatomo-pathologiques ni dans la prise de décision thérapeutique. En ce sens, il semble essentiel que les pathologistes utilisent un compte-rendu standardisé incluant au minimum la présence et le nombre de DTs.
Néanmoins, de nombreuses questions restent en suspens sur leur définition même, leur origine, leur effet pronostique et leurs modalités de prise en compte dans la classification TNM. Des études prospectives incluant la présence et le nombre de DTs semblent essentielles pour répondre à ces questions et affiner notre compréhension.