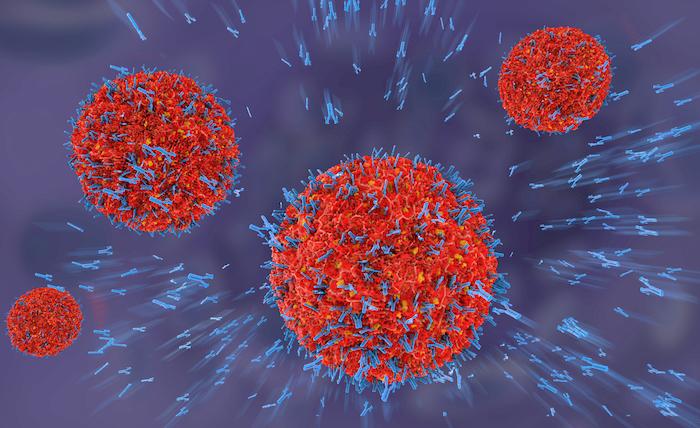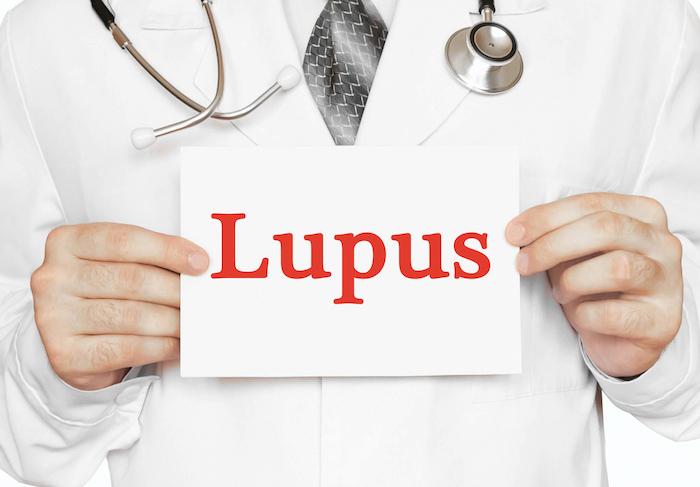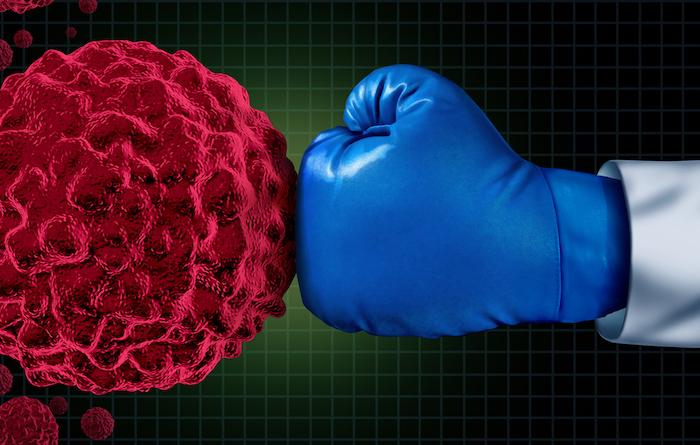Rhumatologie
Néphropathie lupique : une simple biopsie de peau pour ajuster le traitement
Une biopsie cutanée pourrait être un outil simple de suivi des lésions rénales causées par le lupus, afin de déterminer si les traitements fonctionnent réellement ou s'ils doivent être modifiés.
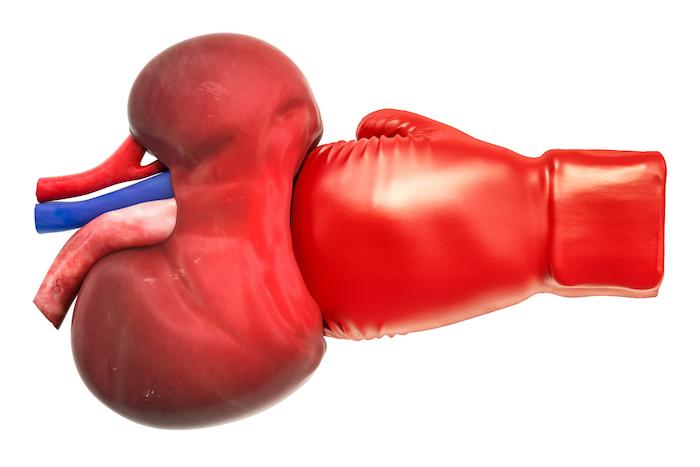
- AlexLMX/istock
Les reins des malades souffrant de lupus érythémateux disséminé (LED) sont souvent attaqués par la réaction auto-immune de la maladie et l’évaluation du traitement proposé est critique, à la fois pour le pronostic rénal et pour éviter les sur-traitements.
Un nouvelle étude, publiée dans la revue Nature Immunology, montre comment de simples biopsies de peau chez les patients lupiques pourraient prédire avec précision ceux qui sont plus susceptibles que d'autres de répondre au traitement.
Kératinocytes et cellules tubulaires
Plus précisément, l'étude a montré une activité similaire du système immunitaire au niveau de la signalisation et de la formation de cicatrices dans les cellules tubulaires rénales affectées par le lupus et les cellules kératinocytaires cutanées chez ces patients.
Dans cette étude, les chercheurs ont analysé le profil cellulaire et l'activité génétique des cellules à partir d'échantillons de tissus rénaux et cutanés chez 21 patients atteints de lupus. La plupart étaient des femmes âgées de 16 à 53 ans et de toutes les races, et souffraient d’un lupus érythémateux disséminé avec une néphropathie lupique.
Les chercheurs ont utilisé un outil de cartographie génétique appelé « scRNA-Seq » qui leur a permis de suivre l’activité de plus de 4 000 cellules de ces biopsies. On a ensuite comparé les profils de biopsies rénales et cutanées chez des patientes souffrant de poussées évolutives au niveau rénal.
Une application pour ajuster le traitement
Chez les patients atteints d’une poussée de néphropathie lupique, l'activité du gène résultant de l'exposition à une protéine de signalisation, l'interféron de type 1 (IFN), dans les deux types de cellules (cellules tubulaires rénales et kératinocytes) a augmenté de 3,8 et 2,5 fois, respectivement, par comparaison aux mêmes biopsies chez des femmes sans néphropathie lupique évolutive. De plus, l'augmentation de l'activité des gènes de la cicatrisation dans les cellules rénales des patients atteints de lupus a été observée chez ceux qui n'ont pas répondu au traitement.
Cette recherche de similitudes entre l'activation des cellules du rein et de celles de la peau est importante car la peau peut être biopsiée beaucoup plus facilement et plus souvent que le rein. Et comme les changements cellulaires observés dans la peau reflèteraient de près les changements dans les lésions rénales du lupus en poussée, la biopsie de la peau pourrait donner des indices sur les dysfonctionnements qui seraient en train ou sur le point de se produire dans le rein.
Néphropathie lupique : une maladie grave
Le lupus est une maladie auto-immune polymorphe qui touche principalement les femmes. Elle reste difficile à traiter parce que son apparition, ses symptômes et son évolution varient considérablement d'un patient à l'autre au cours du temps. L'origine de la maladie demeure inconnue, bien que des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux, comme l'exposition au soleil et les infections, soient impliqués. L'interféron, qui augmente normalement dans l’organisme pour se défendre contre une infection, est associé à l’évolution de la maladie sans que l’on en connaisse précisément le rôle.
De multiples organes, y compris le cerveau, le cœur les poumons et en particulier les reins, peuvent être touchés, ce qui rend plus difficile le traitement, traitement qui fait essentiellement appel à des immunosuppresseurs. Cependant, ces traitements ne font que mettre la maladie en rémission et ne la guérissent pas : une poussée est toujours possible.
Valider le concept
La prochaine étape de l’équipe de recherche est d'analyser de la même façon 160 biopsies rénales et cutanées supplémentaires chez des patients atteints de lupus avec ou sans néphropathie lupique. Si d'autres études confirment ces résultats, cela pourrait déboucher sur une meilleure individualisation du traitement du lupus sur le long terme.
De plus, cette étude devrait aider à mieux comprendre les voies biologiques sous-jacentes aux lésions d'organes dans le lupus et comment l'interféron de type 1 intervient précisément dans ces processus.