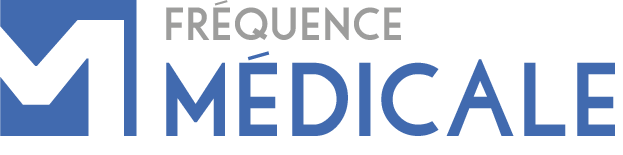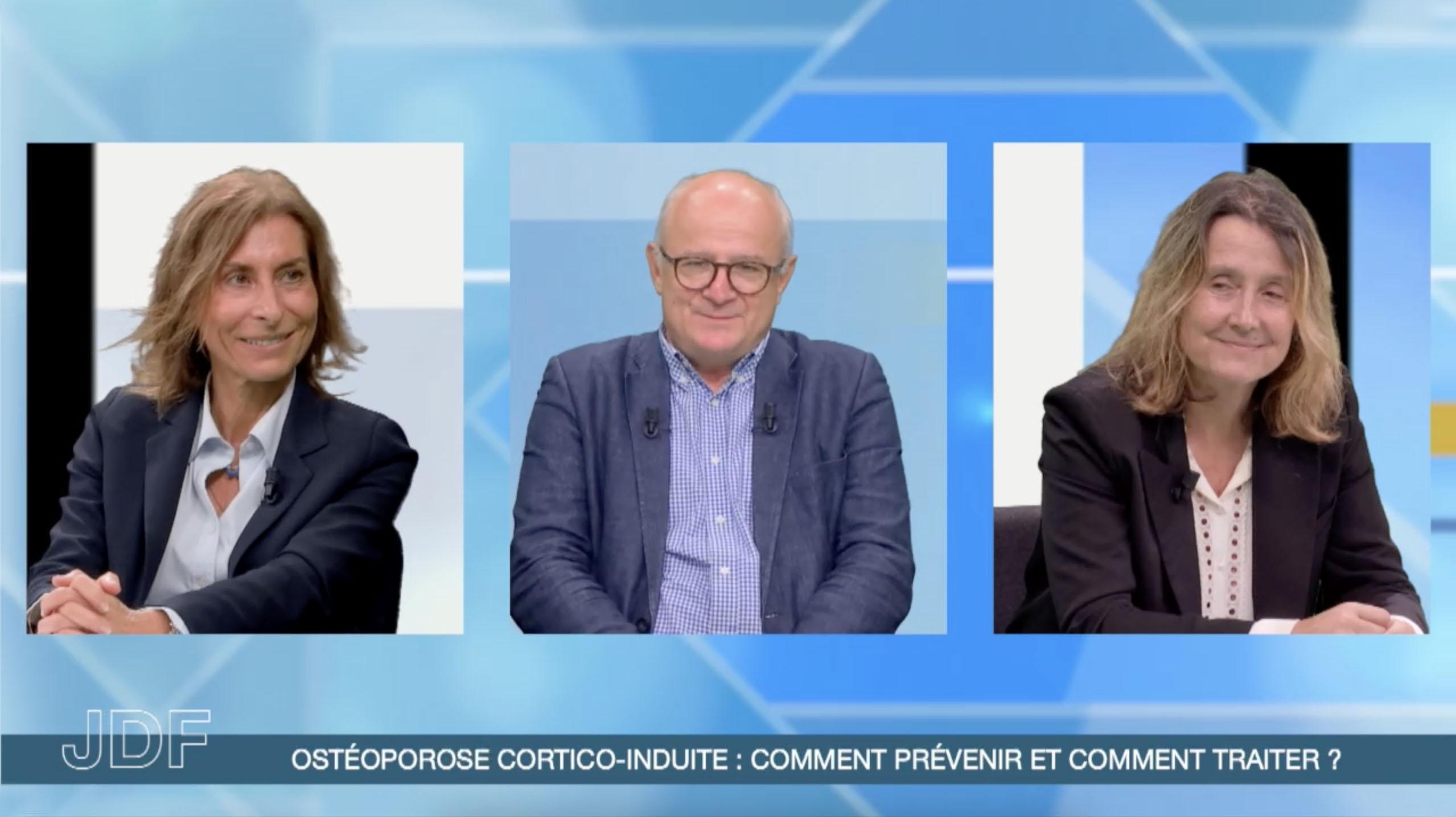Infectiologie
Mpox: persistance des symptômes après la phase aiguë
Dans l'infection MPOX, la prise en charge ne se résume pas à la phase aiguë. Elle devrait également inclure une approche multidsciplinaire. D'autant que les patients décrivent sur le long terme des stigmates psychosociaux.

- Marina Demidiuk/iStock
Les crises en médecine aussi se succèdent l’une après l’autre. On les appelle le plus souvent des épidémies. Et si certaines d’entre elles sont moins sévères que ce que l’on aurait pu redouter, pour les patients atteints les stigmates perdurent bien au-delà du temps de la phase aiguë. En témoigne l’étude « Long-Term Mpox Sequelae 11 to 18 Months After Acute Illness: A Cohort Study in Two U.S. Cities" publiée dans Annals of internal medicine le 20 janvier 2026. L’objectif était d’identifier et de quantifier les séquelles physiques, fonctionnelles et psychosociales persistantes chez des adultes ayant été infectés par mpox lors de l’épidémie de 2022-2023. Le protocole reposait sur une cohorte prospective multicentrique incluant des participants recrutés dans deux grandes villes américaines, New York et Houston, lieux ayant accueilli un grand nombre de cas lors de l’épidémie. Les sujets inclus dans le groupe « post-MPX » présentaient une infection confirmée par mpox entre mai 2022 et janvier 2023, et ont été suivis à 11-18 mois après l’infection aiguë. Un groupe témoin de participants « à risque mais non infectés » a été inclus pour comparaison dans certaines analyses. Les évaluations ont combiné entretiens cliniques, auto-questionnaires sur les symptômes persistants et examen physique ciblé.
58% des patients présentent un symptôme persistant après la phase aiguë
Les résultats principaux montrent qu’une proportion importante de patients présente des séquelles physiques bien au-delà de la phase aiguë. Environ 58 % des personnes infectées rapportent au moins un symptôme persistant à 11-18 mois après l’infection initiale. Les séquelles les plus fréquentes étaient d’ordre esthétique ou liées à des modifications cutanées durables, telles que cicatrices ou hyperpigmentation au site des lésions initiales, souvent situées sur les zones génitales, périanales, le tronc ou les membres. La majorité de ces cicatrices étaient peu étendues (typiquement moins de 10 sites concernés et focalisées sur un ou deux territoires corporels).
Outre ces séquelles apparentes, une fraction non négligeable (environ 13 %) des patients présente encore des troubles fonctionnels persistants. Les plus souvent décrits sont des dysfonctions anorectales, des troubles urinaires incluant une incontinence, ainsi que des douleurs chroniques. Dans un petit sous-groupe de cas, de légers troubles neurologiques ou des atteintes visuelles ont également été signalés. Cependant, ces manifestations fonctionnelles sévères restent moins fréquentes que les séquelles cutanées, et pour l’ensemble des séquelles physiques, l’impact sur les activités de la vie quotidienne était rapporté comme limité chez la majorité des patients.
30% des patients ressentent un niveau de stigmatisation
Une dimension importante du fardeau des séquelles concerne les conséquences psychosociales. Une part notable des participants infectés rapportait que les séquelles physiques — en particulier les cicatrices visibles — avaient eu un impact sur leur vie sociale, y compris des difficultés relationnelles ou des sentiments de stigmatisation. Une portion non négligeable a mentionné des difficultés sexuelles persistantes, et certains ont fait état d’effets sur l’emploi, comme devoir changer de poste ou avoir perdu un emploi en raison des séquelles de l’infection. Plus de 30 % des sujets ressentent un certain niveau de stigmatisation, et près de la moitié déclarent des perturbations dans leur vie sociale ou intime liées à l’infection passée.
L’étude souligne aussi que même si une majorité de participants se considérait en bonne à excellente santé globale, ces perceptions positives ne doivent pas masquer l’existence de séquelles durables chez une proportion majeure des patients. Elle met en avant la nécessité d’un suivi clinique prolongé, incluant non seulement une surveillance des complications physiques mais aussi un soutien pour les aspects fonctionnels, psychosociaux et liés à la qualité de vie. La fréquence significative de séquelles suggère que mpox ne doit pas être considéré comme une maladie strictement auto-limitée chez tous les patients, et que des structures de prise en charge post-aiguë, notamment en dermatologie, urologie, gastroentérologie, soins psychologiques et médecine de réadaptation, seraient justifiées.
Les auteurs discutent également des limites inhérentes à l’étude, notamment une possible biais de sélection des participants et le fait que les résultats pourraient ne pas être entièrement généralisables à toutes les populations touchées par mpox, notamment en dehors des contextes urbains américains ou dans les régions avec d’autres souches virales. Ils appellent à des recherches complémentaires pour mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques sous-tendant ces séquelles prolongées, à des études incluant des cohortes plus variées ainsi qu’à l’élaboration de protocoles de prise en charge spécifiques pour les patients présentant des séquelles chroniques.
En conclusion, cette cohorte de suivi montre que plus de la moitié des patients ayant eu mpox présentent des séquelles physiques ou fonctionnelles persistantes 11 à 18 mois après l’infection aiguë, avec des impacts psychosociaux significatifs chez une proportion importante. La reconnaissance de cette réalité clinique devrait inciter à repenser le suivi à long terme des patients post-mpox, avec une prise en charge multidisciplinaire adaptée à la diversité des séquelles observées.