Cardiologie
Fibrillation atriale : peut-on arrêter les anticoagulants après ablation ?
Chez des patients sans récidive documentée 1 an après ablation, l’arrêt des anticoagulants a réduit un critère composite associant AVC/embolie systémique et hémorragie majeure par rapport à la poursuite d’un AOD. Ce signal favorable concerne surtout des profils à risque thrombotique intermédiaire et à risque hémorragique élevé, sous réserve d’une surveillance rythmique objective et régulière.
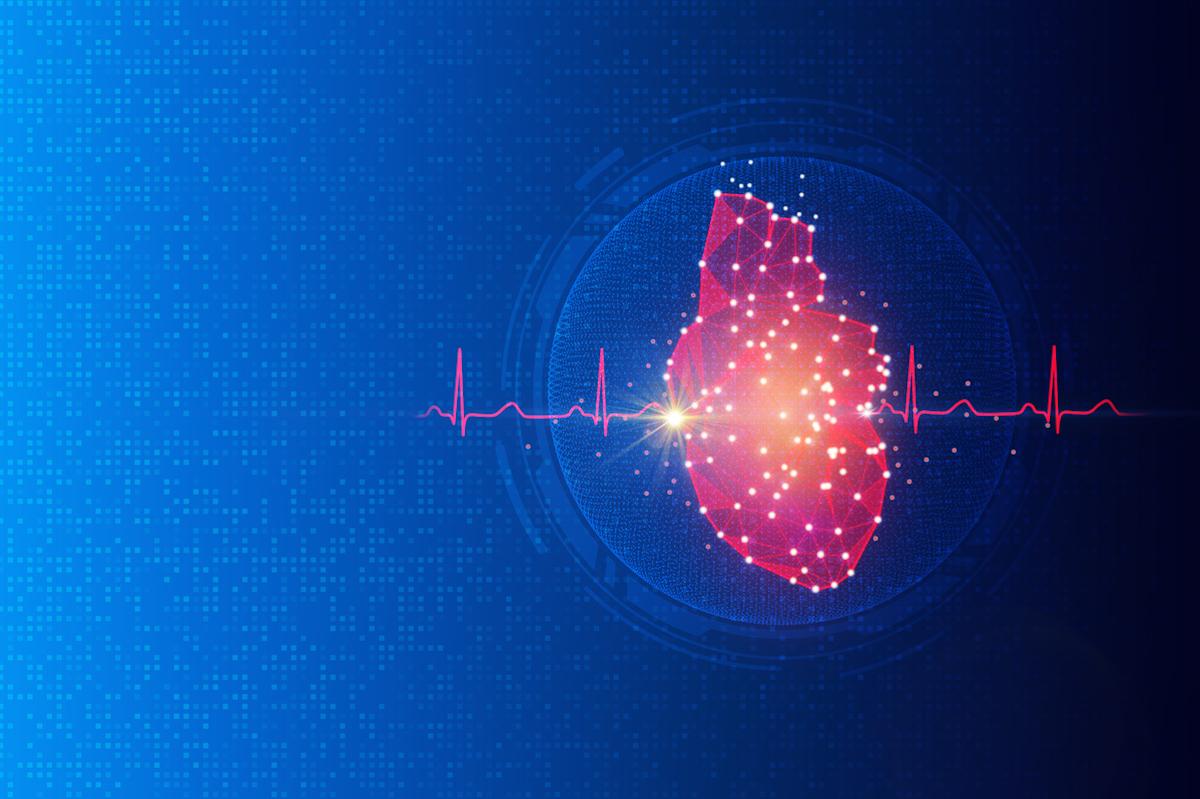
- ArtemisDiana/istock
La fibrillation atriale (FA) pèse lourd en santé publique même si l’ablation est supérieure au traitement médical pour maintenir le rythme sinusal et améliorer la qualité de vie. En revanche, son impact durable sur le risque thromboembolique reste débattu, ce qui explique les recommandations actuelles de poursuivre l’anticoagulation selon le risque CHA₂DS₂-VASc, même après succès procédural.
Présentée à l’ESC 2025 et publiée dans le JAMA, l’étude ALONE-AF comble un manque d’essais randomisés sur le sujet : 840 patients (âge moyen 64 ans, 24,9 % de femmes, CHA₂DS₂-VASc moyen 2,1 ; 67,6 % FA paroxystique), indemnes de récidive d’arythmie pendant ≥12 mois après ablation, ont été randomisés pour arrêter l’AOD (n=417) ou le poursuivre (n=423).
À 2 ans, le critère primaire (AVC, embolie systémique, hémorragie majeure) est survenu chez 0,3 % après arrêt contre 2,2 % en cas de poursuite (différence absolue –1,9 point ; IC à 95 % –3,5 à –0,3 ; p=0,02). L’AVC ischémique a été rare dans les deux bras (0,3 % vs 0,8 %), tandis que les hémorragies majeures n’ont touché que le bras poursuite (0 % vs 1,4 %).
Des bénéfices surtout portés par la tolérance
La supériorité du bras arrêt découle essentiellement de la réduction des saignements majeurs, sans excès d’événements ischémiques observé à 24 mois. En analyses de sous-groupes, le gain paraissait plus net chez les patients >65 ans, les hommes, ceux sans antécédent d’AVC/AIT, sans insuffisance cardiaque ni diabète, et avec HAS-BLED >2. Environ 10 % ont présenté une récidive de FA durant le suivi, imposant la reprise d’un AOD : cela souligne la nécessité d’un monitoring rythmique structuré. Les hémorragies observées sous AOD sont surtout gastro-urologiques ; deux hémorragies intracrâniennes (0,5 %) ont été rapportées, sans mortalité dans aucun groupe.
Ces résultats s’inscrivent dans un contexte où d’autres essais (ARTESIA/NOAH-AFNET 6) ont montré, chez des patients avec FA de faible charge, un arbitrage fin entre légère baisse d’AVC sous AOD et hausse des saignements, avec bénéfice surtout quand CHA₂DS₂-VASc est très élevé. Après ablation, la faible charge rythmique résiduelle pourrait déplacer l’équilibre vers l’arrêt chez des profils sélectionnés.
Il est temps de reconsidérer l’anticoagulation à vie
ALONE-AF est un essai multicentrique, randomisé, conduit en Corée du Sud (18 hôpitaux), en ouvert mais avec critères d’évaluation durs et un protocole de surveillance prédéfini (Holter semestriel). La sélection imposait l’absence de récidive documentée pendant ≥1 an, ce qui renforce l’applicabilité aux « bons répondeurs » de l’ablation, mais limite la généralisabilité aux patients très âgés (>80 ans exclus), aux femmes (25 %) et aux populations non asiatiques, potentiellement moins exposées au risque hémorragique sous AOD.
Selon un éditorial associé, la décision clinique doit donc rester individualisée : documenter objectivement l’absence de FA (ECG prolongés, dispositifs portés/implantables si besoin), réévaluer périodiquement le couple CHA₂DS₂-VASc/HAS-BLED, et engager une décision partagée. En cas de risque thrombotique faible-intermédiaire et risque hémorragique élevé, l’arrêt de l’AOD après 12 mois sans récidive apparaît raisonnable, avec plan de surveillance et reprise conditionnelle en cas de récidive. À l’inverse, les scores élevés (p. ex. CHA₂DS₂-VASc ≥ 3 chez l’homme ou ≥ 4 chez la femme) justifient de maintenir l’anticoagulation en attendant d’autres données.
Des alternatives comme l’occlusion de l’auricule gauche peuvent être discutées lorsque l’AOD est mal toléré chez des patients à haut risque d’AVC, en intégrant le risque procédural. Il est désormais nécessaire de mettre en place des essais pragmatiques internationaux incluant des patienst très âgés et des femmes, des stratégies guidées par monitoring continu, un phénotypage par étendue d’ablation et la fonction auriculaire gauche. Il faut préciser la durée optimale du traitement anticoagulant avant toute tentative d’arrêt. En somme, ALONE-AF ouvre la voie à une dé-escalade post-ablation raisonnée, centrée sur le profil du patient et adossée à une surveillance rythmique robuste.































