Onco-Pédiatrie
Ostéosarcome : un nouveau gène de prédisposition identifié
La mise en évidence d’altérations germinales du gène SMARCAL1 chez près de 2,6 % des enfants atteints d’ostéosarcome redessine le paysage du risque génétique. Ces données plaident pour un dépistage germinal plus large et des parcours de soins intégrant conseil génétique et surveillance ciblée.
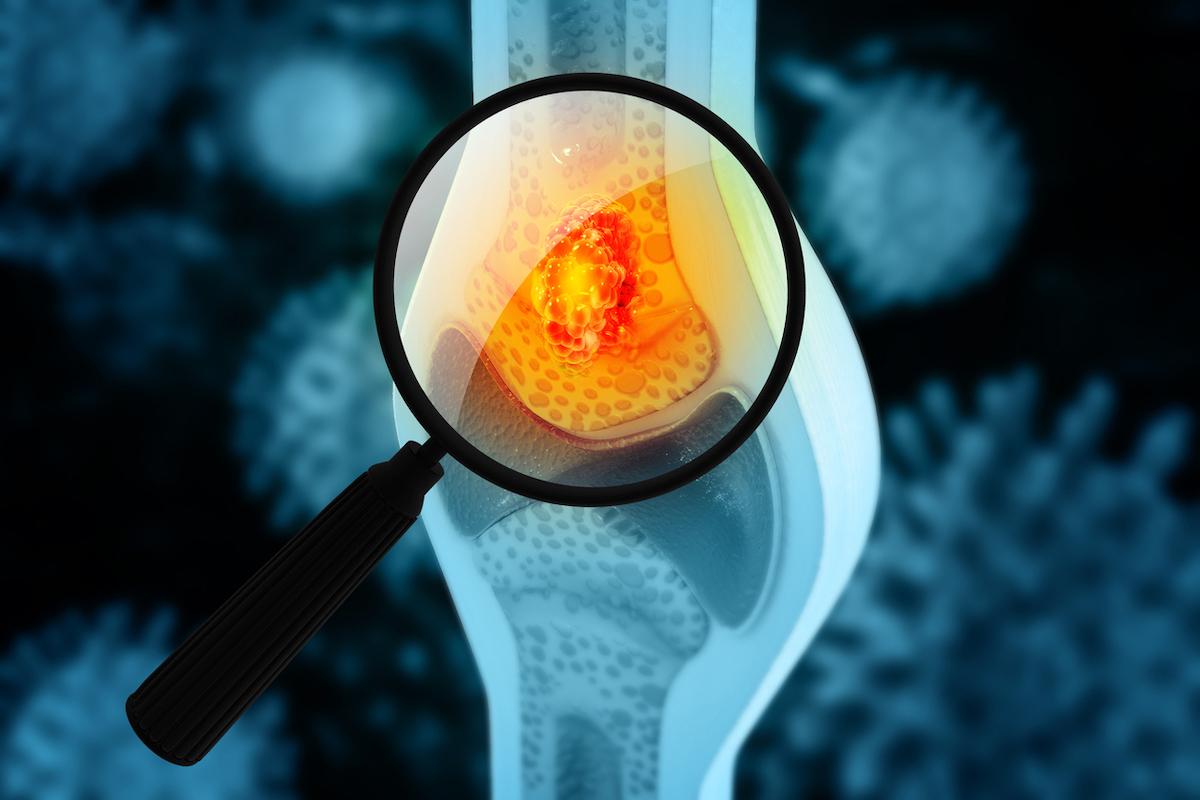
- Mohammed Haneefa Nizamudeen/istock
L’ostéosarcome, tumeur osseuse maligne la plus fréquente de l’enfant et de l’adulte jeune, a peu bénéficié d’avancées thérapeutiques depuis quatre décennies. Dans ce contexte, l’exploration des voies de réparation de l’ADN (DDR) s’impose, nombre de cancers pédiatriques ayant des altérations somatiques sur ces gènes. En réanalysant 189 gènes DDR, les auteurs ont comparé 5 993 cas pédiatriques de cancer à 14 477 témoins adultes indemnes.
Selon les résultats présentés dans JCO, l’analyse « tous cancers » confirme l’enrichissement attendu en variants pathogènes (PV) de TP53 ; les analyses spécifiques de tumeur valident plusieurs associations connues (TP53 dans les corticosurrénalomes, les tumeurs à HGG et le médulloblastome ; PMS2 dans les tumeurs à HGG et la maladie de Hodgkin ; MLH1 dans les tumeurs à HGG ; BRCA2 dans lymphome ; BARD1 dans le neuroblastome). Surtout, quatre signaux inédits émergent, dont SMARCAL1 dans l’ostéosarcome : 6/230 cas (2,6 %) dans la cohorte de découverte (FDR-logistic=0,0189). Dans trois tumeurs sur quatre disponibles, l’allèle sauvage résiduel de SMARCAL1 est délété, suggérant un mécanisme de « two hits » et un rôle tumorigène direct.
Un signal robuste et reproductible
La robustesse de l’association SMARCAL1–ostéosarcome est confirmée dans trois cohortes indépendantes : Childhood Cancer Survivor Study 8/275 (2,9 %, p Fisher<0,0001), un registre allemand 4/135 (3,0 %, p=0,002) et le programme INFORM 4/217 (1,8 %, p=0,012). Les autres nouvelles associations : BRCA1–épendymome, SPIDR–HGG, SMC5–médulloblastome, confortent l’implication transversale des réseaux de maintenance de la réplication.
Cliniquement, identifier un variant de prédisposition SMARCAL1 chez un enfant atteint d’ostéosarcome a plusieurs implications : élargissement du panel de gènes en test germinal initial, information et dépistage familial, vigilance renforcée vis-à-vis de la toxicité des chimiothérapies génotoxiques et mise en place d’une surveillance longitudinale structurée.
À court terme, ces données peuvent affiner la stratification du risque de seconds cancers et la planification des reconstructions osseuses. À moyen terme, elles ouvrent la voie à des stratégies thérapeutiques ciblant la stabilité des fourches de réplication et la létalité synthétique (inhibiteurs des voies ATR/CHK1, modulation de la recombinaison homologue), tout en justifiant des essais spécifiques dans les sous-groupes porteurs de PV DDR.
Vers un dépistage génétique intégré au parcours
L’étude s’appuie sur un schéma rigoureux : interrogation systématique de 189 gènes DDR, définition hiérarchisée des variants de prédisposition combinant ClinVar, InterVar et des outils in silico (REVEL, CADD, MetaSVM), modélisation par régression logistique et de Firth, puis réplication dans trois cohortes indépendantes (n=1 497). La taille d’échantillon, la reproductibilité inter-cohortes et la preuve d’inactivation bi-allélique dans des tumeurs disponibles étayent fortement la causalité. Des limites subsistent : témoins adultes (potentiel biais de survie), hétérogénéité analytique des plateformes, phénotypage tumoral parfois incomplet et absence de données systématiques sur la pénétrance, l’âge au diagnostic et le spectre des manifestations extra-osseuses.
Selon les auteurs, ces résultats justifient l’intégration de SMARCAL1 dans les panels germinaux de première intention chez tout ostéosarcome pédiatrique ou de l’adulte jeune, couplée à un conseil génétique formalisé et à des recommandations de dépistage familial. Ils incitent également à constituer des registres cliniques-génomiques dédiés afin d’estimer la pénétrance, de définir des protocoles de surveillance adaptés à l’enfance et d’explorer l’impact pronostique des variant de prédisposition SMARCAL1 sur la réponse aux chimiothérapies standard. Enfin, le lien entre instabilité de la fourche réplicative et la cancérogenèse osseuse doit être sondé par des essais translationnels, condition nécessaire pour passer du gène au soin et, demain, personnaliser la prise en charge de l’ostéosarcome.































