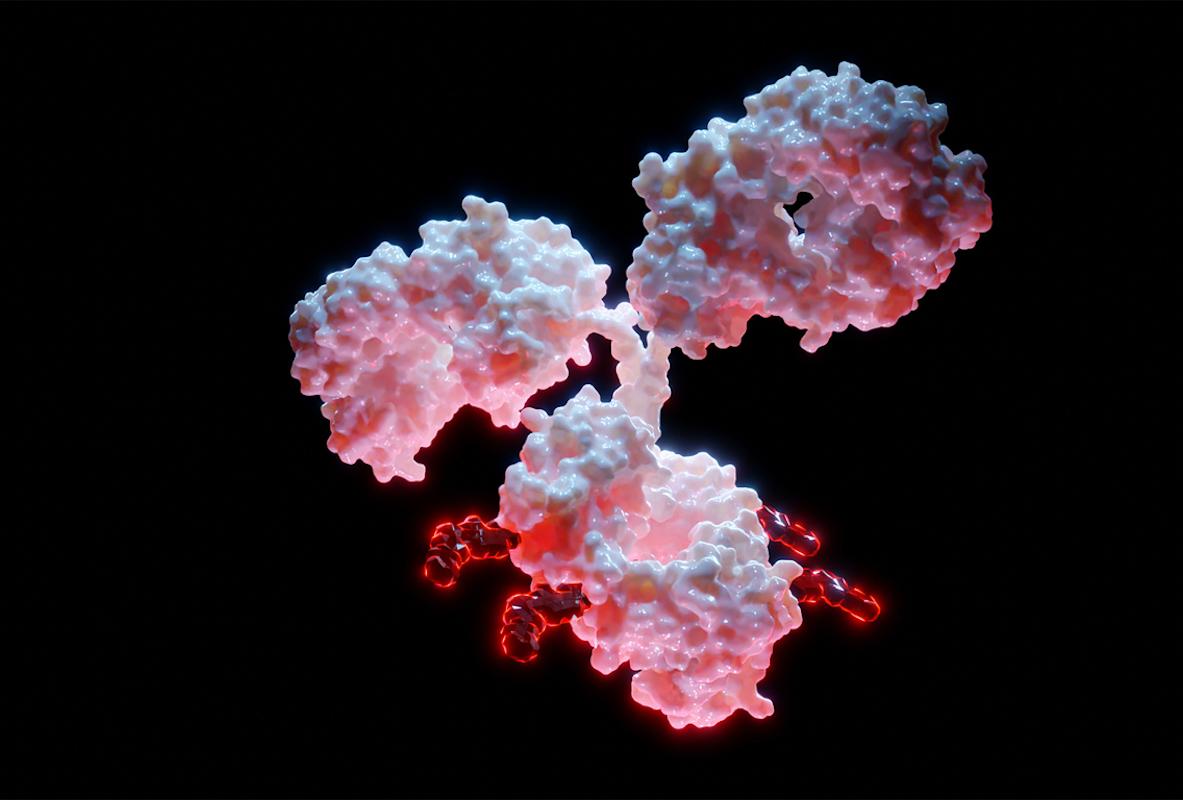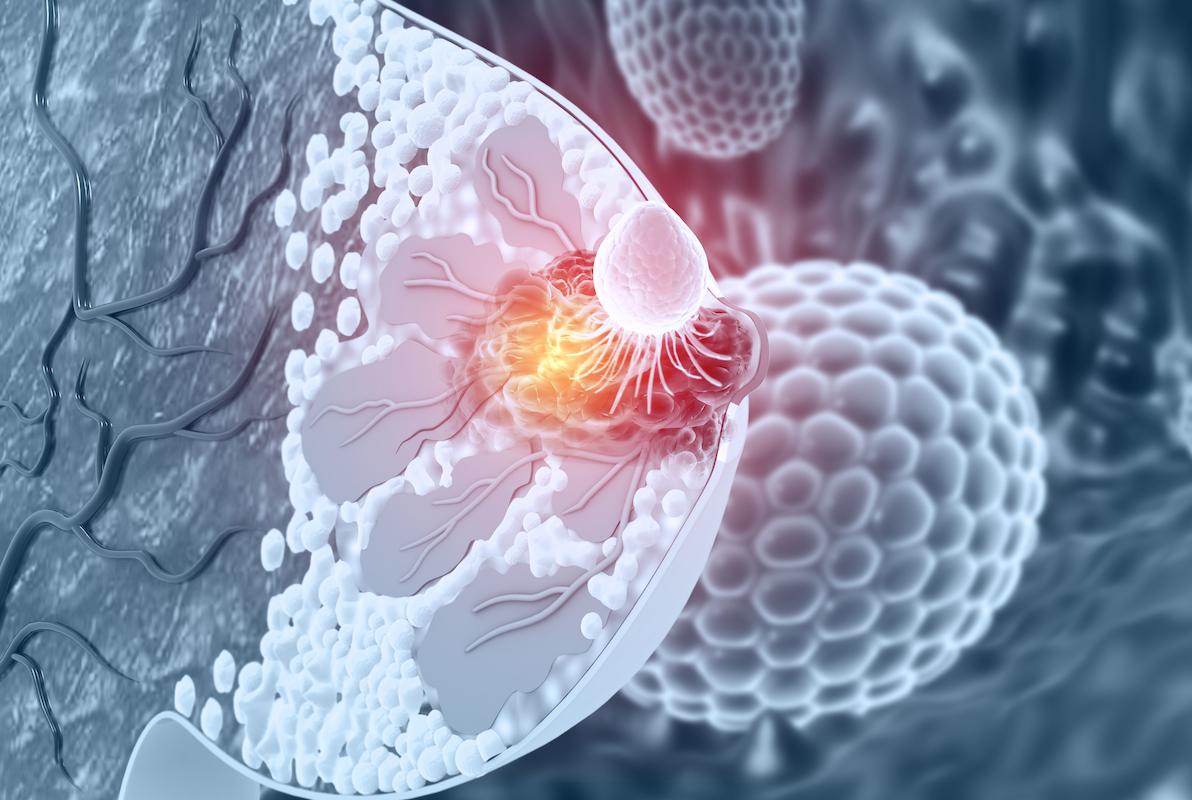Onco-Sein
Cancer du sein : la mammographie après 80 ans peut améliorer la survie
Chez des femmes de 80 ans et plus, la réalisation d’une mammographie de dépistage du cancer du sein est associée à des stades plus précoces de cancer et à une meilleure survie globale et sans récidive. Ces données plaident pour un dépistage individualisé du grand âge chez les femmes en bonne santé.

- peakSTOCK/istock
Le vieillissement démographique ravive la question du dépistage au-delà de 75 ans, zone grise des recommandations (USPSTF sans avis formel ≥75 ans, positions variables des sociétés savantes). Dans ce contexte, une étude rétrospective monocentrique (UCLA, 2013–2020) a comparé des patientes diagnostiquées avec un cancer du sein à 80 ans et plus selon qu’elles avaient bénéficié d’une mammographie de dépistage dans les deux années précédentes ou non.
Selon les résultats publiés dans Annals of Surgical Oncology, sur 174 patientes (âge médian 83 ans), 98 étaient « dépistées » et 76 « non-dépistées ». Les tumeurs étaient principalement RH+ / HER2– et de stade I–II. Le critère principal montre un avantage net au dépistage : amélioration de la survie sans maladie (HR 0,45 ; IC à 95 % 0,301–0,665 ; p < 0,001) et de la survie globale (HR 0,26 ; IC à 95 % 0,126–0,544 ; p < 0,001). L’association persiste après ajustement sur l’âge, le sous-type tumoral et la chirurgie.
Au-delà de la survie : stades, gestes, DCIS, signaux de tolérance
Les patientes non-dépistées ont plus souvent des tumeurs palpables, de haut grade et à un stade plus avancé. Le recours à la tumorectomie est plus fréquent dans le groupe dépisté, tandis que l’omission de la chirurgie est plus fréquente chez les non-dépistées, suggérant que le dépistage facilite des parcours moins lourds. Les groupes ne diffèrent pas de manière significative pour la race/ethnicité, les comorbidités, le sous-type, la chirurgie axillaire, l’hormonothérapie ou la chimiothérapie.
Avec 55 mois de suivi médian, tous les cas métastatiques (2,3 % ; n = 4) surviennent chez des patientes non-dépistées. Les carcinomes in situ (DCIS) représentaient 14 % des diagnostics, majoritairement dans le groupe dépisté (72 % vs 28 %), en cohérence avec une détection radiologique précoce.
Côté tolérance et balance bénéfice-risque du dépistage tardif, la littérature évoque le risque de sur-diagnostic et un taux d’environ 11 % de faux positifs au-delà de 80 ans, avec coûts et anxiété induits. Àl’inverse, la performance de la mammographie tend à s’améliorer avec l’âge (rappel moindre, meilleure valeur prédictive), et des modélisations suggèrent une coût-efficacité au moins pour des schémas espacés jusqu’à 80 ans. Dans une ère de désescalade (omission du SLNB chez >70 ans RH+, bénéfice marginal de la radiothérapie adjuvante dans certains profils), la détection précoce chez l’octogénaire peut permettre de limiter les gestes tout en préservant les résultats oncologiques.
Dépister tard et mieux traiter
Il s’agit d’une étude rétrospective, monocentrique, incluant uniquement des femmes de 80 ans et plus, déjà diagnostiquées d’un cancer du sein (sélection qui ne permet pas d’estimer directement les effets indésirables populationnels du dépistage chez les non-malades). La définition du « dépistage » reposait sur une mammographie ≤2 ans avant le diagnostic de cencer du sein ; les analyses recouraient au Kaplan–Meier/log-rank et aux modèles de Cox (bruts/ajustés).
La majorité des patientes étaient blanches et non hispaniques dans un environnement urbain académique, ce qui limite la généralisabilité, et la taille d’échantillon restreinte contraint les analyses de sous-groupes (p. ex. DCIS ou stade IV). Malgré ces limites, la cohérence interne (équilibre des comorbidités, persistance des effets après ajustement) et la concordance avec des travaux antérieurs renforcent la plausibilité d’un bénéfice clinique du dépistage individualisé chez des patientes très âgées en bon état général.
Selon les auteurs, chez les femmes de 80 ans et plus en bonne santé et prêtes à accepter examens et traitements nécessaires, il est nécessaire de discuter la poursuite d’une mammographie de dépistage à un rythme raisonnable, dans un cadre de décision partagée intégrant espérance de vie, comorbidités, préférences et accessibilité aux soins. Un dépistage continu peut favoriser des traitements conservateurs (tumorectomie, omission de procédures invasives) et améliorer la survie. Des études prospectives pragmatiques, incluant la qualité de vie, les événements indésirables du parcours de dépistage (faux positifs, procédures inutiles), la coût-efficacité et des populations diversifiées, sont nécessaires pour affiner un seuil d’arrêt non arbitraire et des intervalles optimaux après 75–80 ans.