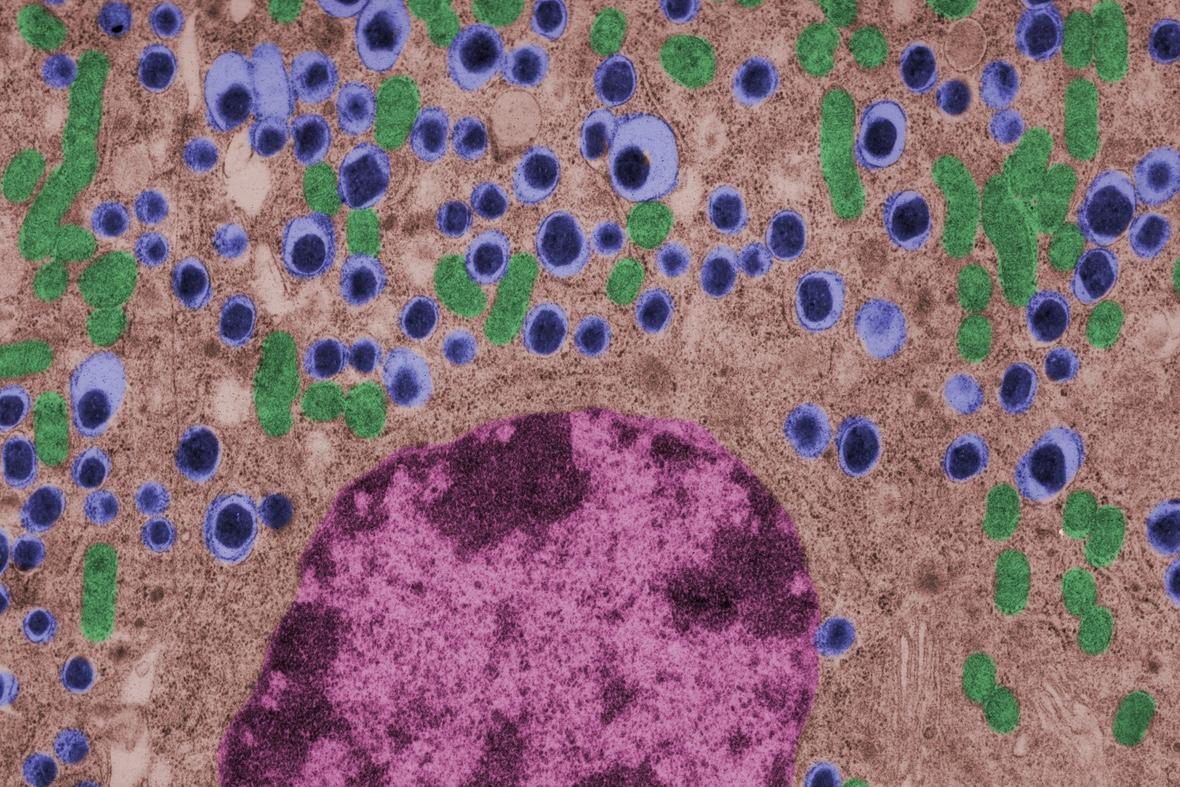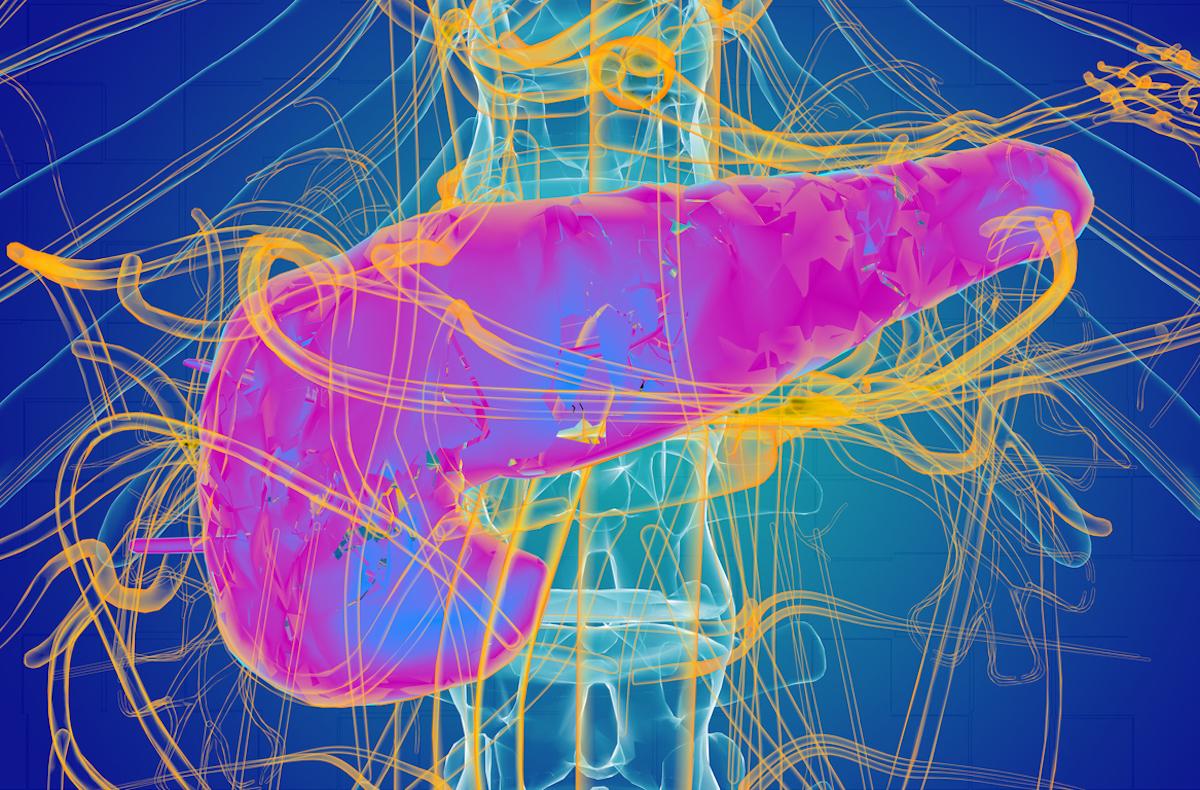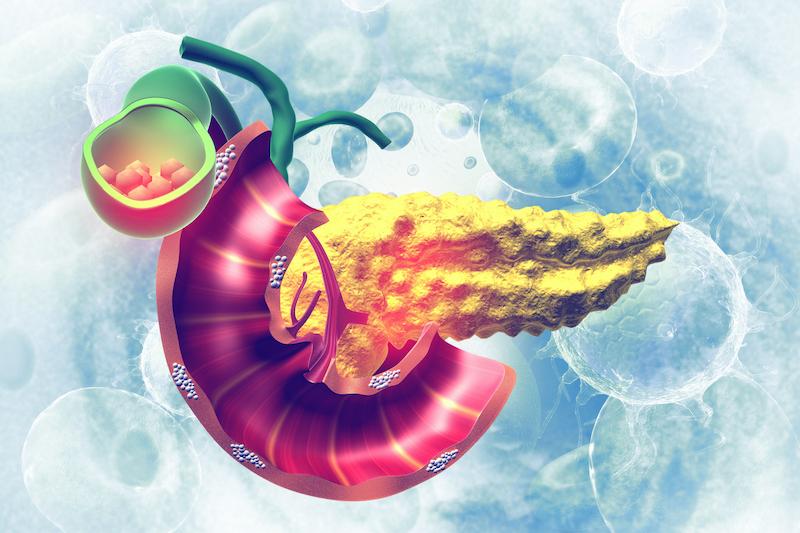Diabétologie
Diabète de type 1 et prévention : les thymoglobulines à faible dose changent la donne
Un essai adaptatif paneuropéen chez des patients de 5 à 25 ans nouvellement diagnostiqués DT1 identifie une dose minimale efficace de thymoglobulines pour préserver la sécrétion de C-peptide à 12 mois soutenant l’intérêt d’une stratégie de modulation plutôt que de suppression immunitaire.

- Tom Merton/istock
Le diabète de type 1 reste dépourvu de traitement véritablement modificateur de l’histoire naturelle de la maladie après le diagnostic clinique (stade 3). La perte accélérée des cellules β, particulièrement chez l’enfant, a conduit à tester des immunothérapies, avec des succès variables et des posologies souvent extrapolées à partir d’autres indications.
L’essai MELD-ATG, conduit dans 14 centres de huit pays, a évalué plusieurs doses de thymoglobulines (globuline anti-thymocyte) administrées sur deux jours chez des enfants et adolescents âgés de 5 à 25 ans, 3 à 9 semaines après le diagnostic, avec auto-anticorps positifs et C-peptide ≥ 0,2 nmol/L. Sur 152 screenés, 117 ont été randomisés : placebo (n=31), ATG 0,1 mg/kg (n=6), 0,5 mg/kg (n=35), 1,5 mg/kg (n=12), 2,5 mg/kg (n=33).
Selon les résultats publiés dans The Lancet, le critère d'évaluation principal, qui était l'aire sous la courbe (AUC) de la concentration de peptide C stimulé pendant un test de tolérance au repas mixte de 2 heures à 12 mois (AUC C-peptide+1), s’est amélioré de 0,124 nmol/L per min (IC ç 95 % 0,043–0,205 ; p=0,0028) avec 2,5 mg/kg versus placebo. La dose 0,5 mg/kg a également fait mieux que le placebo (+0,102 nmol/L par min ; IC à 95 % 0,021–0,183 ; p=0,014). L’efficacité est confirmée pour 2,5 mg/kg, mais au prix d’une tolérance moins favorable qu’à 0,5 mg/kg, soutenant l’intérêt d’une stratégie de modulation plutôt que de suppression immunitaire.
L’efficacité ne dépend pas exclusivement de la déplétion lymphocytaire
Au-delà du C-peptide, la glycémie chronique s’améliore : l’HbA1c est plus basse sous 0,5 mg/kg que sous placebo à 12 mois, suggérant un bénéfice métabolique tangible. Les bras 0,1 et 1,5 mg/kg ont été abandonnés en cours d’étude faute de rapport bénéfice/risque ou de signal suffisant. La tolérance est nettement dose-dépendante : maladie sérique chez 82 % avec 2,5 mg/kg versus 32 % avec 0,5 mg/kg, et 0 % sous placebo ; syndrome de libération de cytokines chez 33 % avec 2,5 mg/kg et 24 % avec 0,5 mg/kg, absent sous placebo, le plus souvent lors du premier jour de perfusion.
Aucun décès lié au traitement n’a été rapporté. Sur le plan immunologique, les thymoglobulines modulent le ratio CD4/CD8 de manière dose-dépendante, mais la dissociation partielle entre cette modulation (non maintenue à 12 mois sous 0,5 mg/kg) et les gains métaboliques persistants suggère que l’efficacité ne dépend pas exclusivement de la déplétion lymphocytaire. Des analyses mécanistiques à venir (préservation des T régulateurs, signatures d’épuisement des CD4, autres axes immunologiques) préciseront ces corrélats. Les tendances d’efficacité paraissent plus marquées chez les plus jeunes, sans puissance statistique suffisante pour conclure formellement par classe d’âge.
Comment ces résultats peuvent-ils infléchir la pratique ?
MELD-ATG est une phase 2, randomisé, en double insu, adaptative, multi-bras, dose-étagée, avec comités non aveugles pilotant la sélection des doses selon des critères préspécifiés (signal sur C-peptide, sécurité, biomarqueurs). La stratification par tranches d’âge (5–9, 10–17, 18–25 ans) et l’ancrage dans une plateforme d’investigation (sites accrédités) renforcent la validité interne et la faisabilité chez l’enfant. Les limites tiennent à l’abandon précoce de doses intermédiaires (0,1 et 1,5 mg/kg) avec effectifs faibles, à une population majoritairement européenne, et au risque de levée partielle de l’aveugle du fait d’effets attendus.
Selon les études, deux inflexions se dessinent. Premièrement, la dose de 0,5 mg/kg émerge comme standard candidat : une seule journée d’infusion, un profil de sécurité supérieur et une efficacité cliniquement pertinente à 12 mois justifient d’envisager cette posologie chez les enfants et jeunes adultes nouvellement diagnostiqués, dans des contextes encadrés. Deuxièmement, l’approche adaptative accélère l’itération thérapeutique et devrait devenir la norme pour tester des agents modulateurs précoces. À moyen terme, la combinaison ou la ré-administration (si des préparations humanisées de thymoglobulines deviennent disponibles) pourraient viser une protection plus durable de la masse des cellules β, tout en affinant la médecine de précision par âge et profils immunologiques.
En attendant, ces résultats plaident pour inclure tôt les enfants dans les essais de modulation immunitaire et pour intégrer, dès le diagnostic, une réflexion sur la préservation du C-peptide comme objectif de soins.