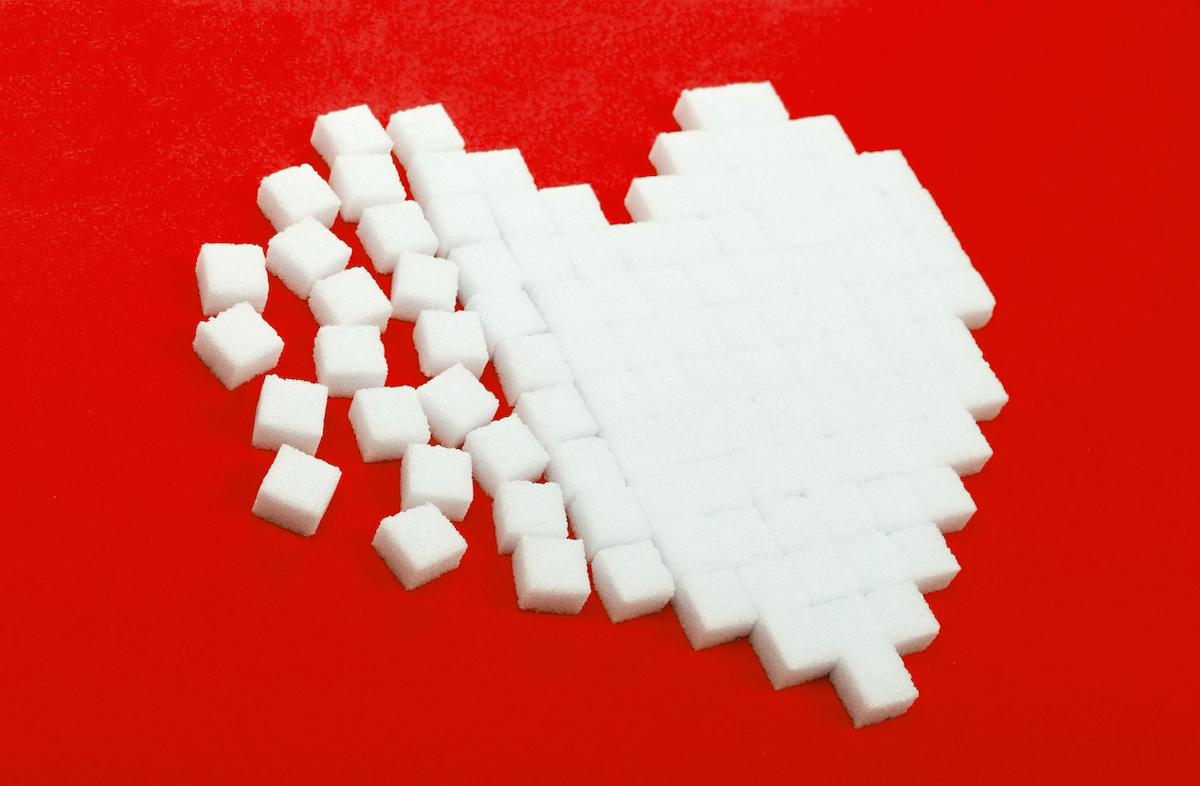Diabétologie
Hyperglycémie persistante à l'adolescence : un facteur de risque précoce d’insuffisance cardiaque
Une étude longitudinale démontre que l’hyperglycémie et l’insulinorésistance chez les adolescents sont associées à une hypertrophie ventriculaire gauche à l’âge adulte jeune, en particulier chez les femmes. Des anomalies glycémiques, même modérées, doivent être identifiées et prises en charge précocement chez l’adolescent, même en l’absence de surpoids.

- Irina_Geo/istock
Alors que l’on sait que l’insulinorésistance et les troubles de la glycémie induisent un remodelage cardiaque chez l’adulte, peu de données sont disponibles chez les jeunes. Dans l’étude ALSPAC (Avon Longitudinal Study of Parents and Children), 1 595 adolescents (âge moyen : 17,7 ans) ont été suivis jusqu’à l’âge de 24 ans. L’objectif : évaluer si une glycémie à jeun élevée (≥5,6 mmol/L ou ≥6,1 mmol/L) ou une insulinorésistance persistante (calculée par HOMA-IR) était associée à une hypertrophie ventriculaire gauche (LVH), définie par une augmentation de la masse ventriculaire gauche indexée pour la taille (LVMI2.7 ≥51 g/m2.7).
Des résultats antérieurs de la même cohorte indiquaient que la fin de l'adolescence est une période critique dans l'évolution des maladies cardiométaboliques. Les résultats actuels, publiés dans Diabetes Care, confirment en outre que même les adolescents et les jeunes adultes en bonne santé et dont le poids est normal peuvent être en train de développer des maladies cardiovasculaires s'ils ont un taux de glucose élevé et une résistance à l'insuline. Chaque augmentation d’une unité de glucose ou de HOMA-IR seraait corrélée à une hausse significative de LVMI2.7 (respectivement +0,37 g/m2.7 et +1,10 g/m2.7 ; p<0,001).
Une glycémie élevée pourrait endommager le cœur des femmes cinq fois plus rapidement
Au cours des 7 années de suivi, la prévalence de l’hypertrophie ventriculaire gauche est passée de 2,4 % à 7,1 %, et celle d’un dysfonctionnement cardiaque de 9,2 % à 15,8 %. L’hyperglycémie persistante ≥5,6 mmol/L serait associée à un surrisque de 46 % d’hypertrophie ventriculaire (OR 1,46 ; IC à 95% 1,35–1,47 ; p<0,001), risque triplé pour une glycémie ≥6,1 mmol/L (OR 3,10 ; IC à 95% 1,19–8,08 ; p=0,021).
Une insulinorésistance persistante est liée à une majoration de 10 % du risque de lésion cardiaque structurelle ou fonctionnelle. Chez les jeunes femmes, l’impact de la glycémie sur l’augmentation de la masse cardiaque serait cinq fois plus marqué que chez les hommes (+0,57 g/m2.7 contre +0,11 g/m2.7). L’augmentation de la masse grasse expliquerait 62 % de l’effet de l’insulinorésistance sur la LVMI2.7.
La plus grande cohorte mondiale d’adolescents et d’adultes jeunes
Ces résultats proviennent de la plus grande étude mondiale combinant mesures répétées de glycémie, d’insuline et d’échocardiographie sur une cohorte saine d’adolescents et de jeunes adultes. L’analyse a intégré de nombreux facteurs confondants, dont le statut socio-économique, la sédentarité (mesurée par accélérométrie), la composition corporelle (absorptiométrie), et les antécédents familiaux cardiovasculaires.
Selon les auteurs, ces données suggèrent que les anomalies glycémiques, même modérées, doivent être identifiées et prises en charge précocement, même en l’absence de surpoids. Cette étude alerte sur un possible « phénotype silencieux » de prédiabète délétère pour le cœur dès l’adolescence, en particulier chez les jeunes filles. Elle appelle à un changement de paradigme : intégrer le dépistage précoce de l’insulinorésistance et de l’hyperglycémie dans les stratégies de prévention cardiovasculaire chez les jeunes, et cibler les interventions sur les comportements alimentaires et l’activité physique dès la fin de l’adolescence.