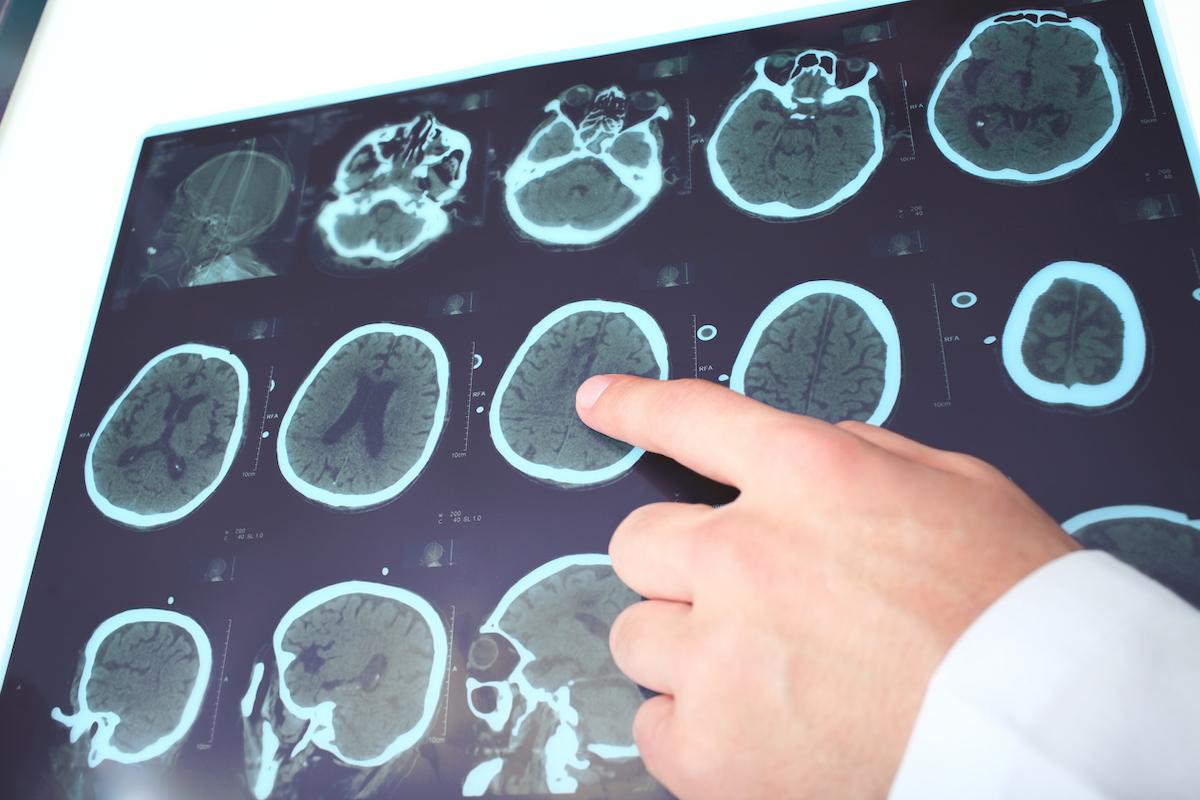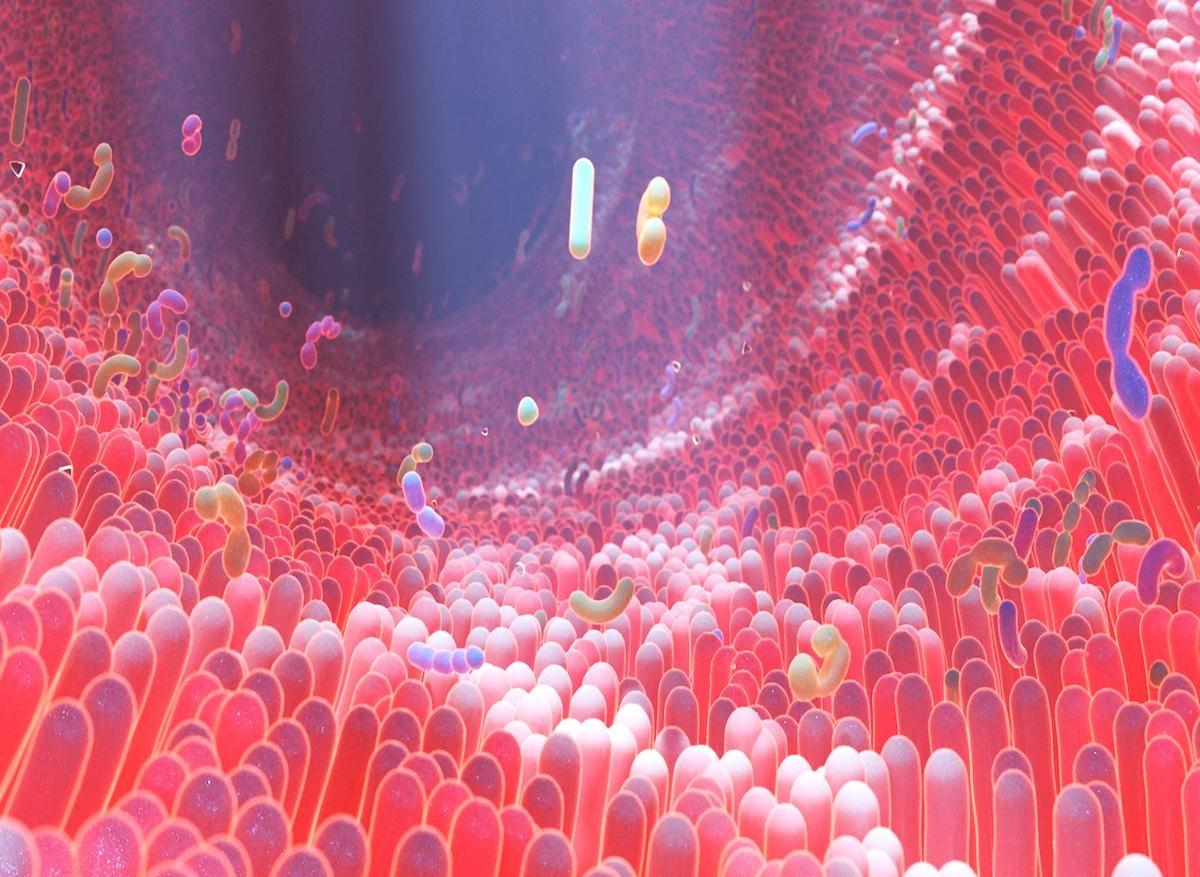Neurologie
Sclérose en plaques et virus Epstein-Barr : un an après le retour en force de la théorie
Dans la sclérose en plaques, les dernières études militent en faveur d’un rôle nécessaire pais pas suffisant de l’infection latente à virus Epstein-Barr. Ces constatations transforment néanmoins la SEP en « maladie post-virale » et introduisent de nouvelles pistes thérapeutiques.

- Rasi Bhadramani/istock
Il y un an, un article dans Science montrait une séquence temporelle quasiment parfaite entre la séroconversion au virus Epstein-Barr (EBV) et l’apparition d’une sclérose en plaques (SEP) dans une cohorte de militaires américains (Bjornevik et al., 2022).
La séquence temporelle, l’ampleur du risque relatif de 30 et la spécificité de la relation par rapport au CMV ont remis EBV sur le devant de la scène, non-plus en tant que facteur de risque environnemental, mais comme l’authentique cause de la SEP. Plusieurs revues ont depuis fait le point sur les éléments en faveur de cette causalité (Bjornevik et al., 2023).
Rappels sur EBV
EBV appartient à la famille des herpès virus. Il se transmet par voie salivaire et infecte initialement les lymphocytes B (LB) oraux. La mononucléose infectieuse est la forme symptomatique de la primo-infection à EBV. Il lui fait suite une phase d’infection latente, où seuls les gènes permettant le maintien de l’ADN viral sont exprimés dans le réservoir viral : le LB.
Les antigènes capsidaires (ex : VCA) ne sont donc plus exprimés au profit d’antigène nucléaires (ex : EBNA1). L’infection latente est asymptomatique, mais peut rarement se compliquer de néoplasies (lymphome de Burkitt, de Hodgkin, autres…). EBV fut ainsi le premier virus identifié comme oncogène. Si à long terme, EBV peut perturber le LB au point d’être oncogène, il peut vraisemblablement le rendre auto-réactif.
Arguments épidémiologiques suggérant une relation causale
La théorie de l’implication d’EBV dans la SEP remonte aux années 1980 sur la base de l’association de la séropositivité EBV avec la SEP ainsi que du titre anticorps anti-EBV. Une hausse voire une apparition de l’incidence de la SEP a été mise en évidence dans des populations insulaires suite à des migrations. L’originalité de l’article de Science est son schéma longitudinal permettant de remonter avant le début de la maladie pour y tester la sérologie EBV de l’époque (Bjornevik et al., 2022).
L’étude s’est concentrée sur le sous-groupe des patients qui étaient séronégatifs au prélèvement le plus ancien. Ceux qui plus tard ont débuté une SEP sont tous devenus séropositifs et ont débuté la maladie après la séroconversion. En outre, les virus apparentés comme CMV n’ont pas d’association avec la SEP, ce que l’étude a documenté épidémiologiquement et biologiquement par un screening sérologique de plusieurs peptides viraux. Il ne s’agit donc pas d’un terrain de susceptibilité globale aux virus, mais d’une association spécifique à EBV.
Une hypothèse mécanistique impliquant plusieurs voies
Contrairement aux maladies pour lesquelles des autoanticorps pathogènes ont été identifiés (ex : la myasthénie, la NMOSD, la MOGAD ou les encéphalites limbiques), l’immunité de la SEP est plus complexe et son déclenchement est plus flou. Plusieurs années peuvent s’écouler entre la séroconversion et la première poussée de SEP, ce qui pourrait correspondre à la phase « prodromale ». Les taux de chaine légère de neurofilament augmentent jusqu’à dix ans avant la première poussée, ce qui traduirait une activité infraclinique déjà présente. Cette phase correspondrait à une dynamique hôte-virus paucisymptomatique sous-tendant des phénomènes de maturation d’affinité, d’invasion du système nerveux central ou d’épuisement des LT spécifique d’EBV.
En termes d’immunité humorale, le mimétisme moléculaire est documenté entre certains antigènes d’EBV et du système nerveux (Lanz et al., 2022). Certains anticorps des bandes oligoclonales reconnaissent des antigènes viraux comme EBNA1 et BRRF2. Les titres d’anticorps sont plus élevés chez les patients et témoins sains portant l’allèle HLA-DRB15.01, le locus le plus associé à la SEP. Cependant, ces anticorps ne sont probablement pas pathogènes puisqu’ils persistent même chez des patients inactifs. Ils représenteraient plutôt un co-produit d’une perturbation des LB infectés.
Au niveau intracellulaire, des LB infectés furent retrouvés dans des lésions de SEP et dans les organes lymphoïdes tertiaires des méninges. Cependant, il ne s’agirait pas d’une réactivation virale puisque les déficits immunitaires comme le SIDA ne sont pas associés au risque de SEP, ni les déficits génétiques en interféron ou les déficits immuns communs variables. Il faut distinguer la réplication virale lytique (aiguë) et la réplication virale latente (chronique) pour comprendre l’impact plus complexe et silencieux que peut avoir l’infection latente à EBV. EBNA2 agit comme facteur de transcription, en se liant notamment au site de liaison du récepteur à la vitamine D, ce qui suggère une compétition entre les 2 protéines modulée par les taux de vitamine D. Certaines protéines virales activeraient AID, le gène activant maturations d’affinité des immunoglobulines. La survie des LB infectés dans le centre germinatif serait augmenté par certaines protéines inhibant l’apoptose. D’autres protéines virales mimeraient l’interaction LT-LB en activant la voie correspondante en aval du HLA de classe 2.
En termes d’immunité cellulaire, EBV peut également impacter les LT. Des clones de LT peuvent être amorcés lors de la mononucléose infectieuse pour détruire les LB infectés. Eux-mêmes sont potentiellement auto-réactifs par mimétisme moléculaire. Indirectement, la protéine LMP1 induirait une surexpression de signaux de co-activation du LT par le LB infecté. La réponse antivirale étant essentiellement cytotoxique (LT, NK,…), celle-ci pourrait s’épuiser à terme. Les titres plus élevés d’anticorps anti-EBNA peuvent refléter un contrôle moindre de la réplication virale, requérant l’augmentation de la synthèse d’anticorps pour compenser une immunité cellulaire moins efficiente chez ces patients.
Une nouvelle piste thérapeutique
Au-delà de proposer un synopsis un peu plus clair à la pathogenèse de la SEP, la théorie EBV dégage une nouvelle piste thérapeutique. Plusieurs stratégies peuvent cibler le virus ou chercher à détruire son réservoir pour traiter l’infection latente.
Les vaccins, prophylactiques ou thérapeutiques, pourraient cibler le virus spécifiquement. Un vaccin prophylactique existe déjà, mais ne fait que réduire le taux de mononucléose infectieuse sans prévenir le passage à une infection latente. Deux nouveaux vaccins, dont un à ARNm sont en essais cliniques. La durabilité de leur protection est en question connaissant les résultats contre le SARS-Cov-2. Des vaccins thérapeutiques ont également été testés à visée oncolytique dans les cancers EBV-induites. Enfin, dans l’hypothèse d’un mimétisme moléculaire, il est envisageable que l’immunisation d’un vaccin thérapeutique réactive de manière indésirable l’immunité croisée envers des auto-antigènes du système nerveux, ce qui résulterait en une poussée de SEP.
Les antiviraux classiques n’inhibent que la réplication lytique d’EBV et non la réplication latente. Il a donc été envisagé d’induire une reprise de la réplication lytique par inhibiteurs d’histone désacétylase ou du protéasome pour rendre les LB infectés sensibles aux antiviraux classiques.
Enfin, des essais de preuve de concept de thérapie cellulaire à LT autologues anti-EBV ont montré des améliorations du handicap dans la SEP progressive (Ioannides et al., 2021; Pender et al., 2020). Toujours est-il que dans l’arsenal thérapeutique actuel, les anti-CD20 ciblent déjà les LB et sont considérés comme une classe thérapeutique de haute efficacité dans la SEP. Le fait qu’il détruisent la cellule réservoir d’EBV conforte leur rationnel sachant que le mécanisme de leur efficacité n’est pas totalement élucidé.
Conclusion
Jusque-là considéré comme un facteur de risque de SEP, EBV serait en réalité une étape nécessaire mais insuffisante pour déclarer la maladie, considérée comme post-virale. Plusieurs voies intra-cellulaires et fonctions immunologiques sont potentiellement perturbés dans le LB infecté, ce qui pourrait mener à une reprogrammation cellulaire pathogène après plusieurs années. Cibler ces LB transformés par EBV apparaît comme une nouvelle piste thérapeutique.
Références
Bjornevik, K., Cortese, M., Healy, B.C., Kuhle, J., Mina, M.J., Leng, Y., Elledge, S.J., Niebuhr, D.W., Scher, A.I., Munger, K.L., Ascherio, A., 2022. Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr virus associated with multiple sclerosis. Science 375, 296–301. https://doi.org/10.1126/science.abj8222
Bjornevik, K., Münz, C., Cohen, J.I., Ascherio, A., 2023. Epstein–Barr virus as a leading cause of multiple sclerosis: mechanisms and implications. Nat. Rev. Neurol. 1–12. https://doi.org/10.1038/s41582-023-00775-5
Ioannides, Z.A., Csurhes, P.A., Douglas, N.L., Mackenroth, G., Swayne, A., Thompson, K.M., Hopkins, T.J., Green, K.A., Blum, S., Hooper, K.D., Wyssusek, K.H., Coulthard, A., Pender, M.P., 2021. Sustained Clinical Improvement in a Subset of Patients With Progressive Multiple Sclerosis Treated With Epstein-Barr Virus-Specific T Cell Therapy. Front. Neurol. 12, 652811. https://doi.org/10.3389/fneur.2021.652811
Lanz, T.V., Brewer, R.C., Ho, P.P., Moon, J.-S., Jude, K.M., Fernandez, D., Fernandes, R.A., Gomez, A.M., Nadj, G.-S., Bartley, C.M., Schubert, R.D., Hawes, I.A., Vazquez, S.E., Iyer, M., Zuchero, J.B., Teegen, B., Dunn, J.E., Lock, C.B., Kipp, L.B., Cotham, V.C., Ueberheide, B.M., Aftab, B.T., Anderson, M.S., DeRisi, J.L., Wilson, M.R., Bashford-Rogers, R.J.M., Platten, M., Garcia, K.C., Steinman, L., Robinson, W.H., 2022. Clonally expanded B cells in multiple sclerosis bind EBV EBNA1 and GlialCAM. Nature 1–7. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04432-7
Pender, M.P., Csurhes, P.A., Smith, C., Douglas, N.L., Neller, M.A., Matthews, K.K., Beagley, L., Rehan, S., Crooks, P., Hopkins, T.J., Blum, S., Green, K.A., Ioannides, Z.A., Swayne, A., Aftab, B.T., Hooper, K.D., Burrows, S.R., Thompson, K.M., Coulthard, A., Khanna, R., 2020. Epstein-Barr virus–specific T cell therapy for progressive multiple sclerosis. JCI Insight 3. https://doi.org/10.1172/jci.insight.124714