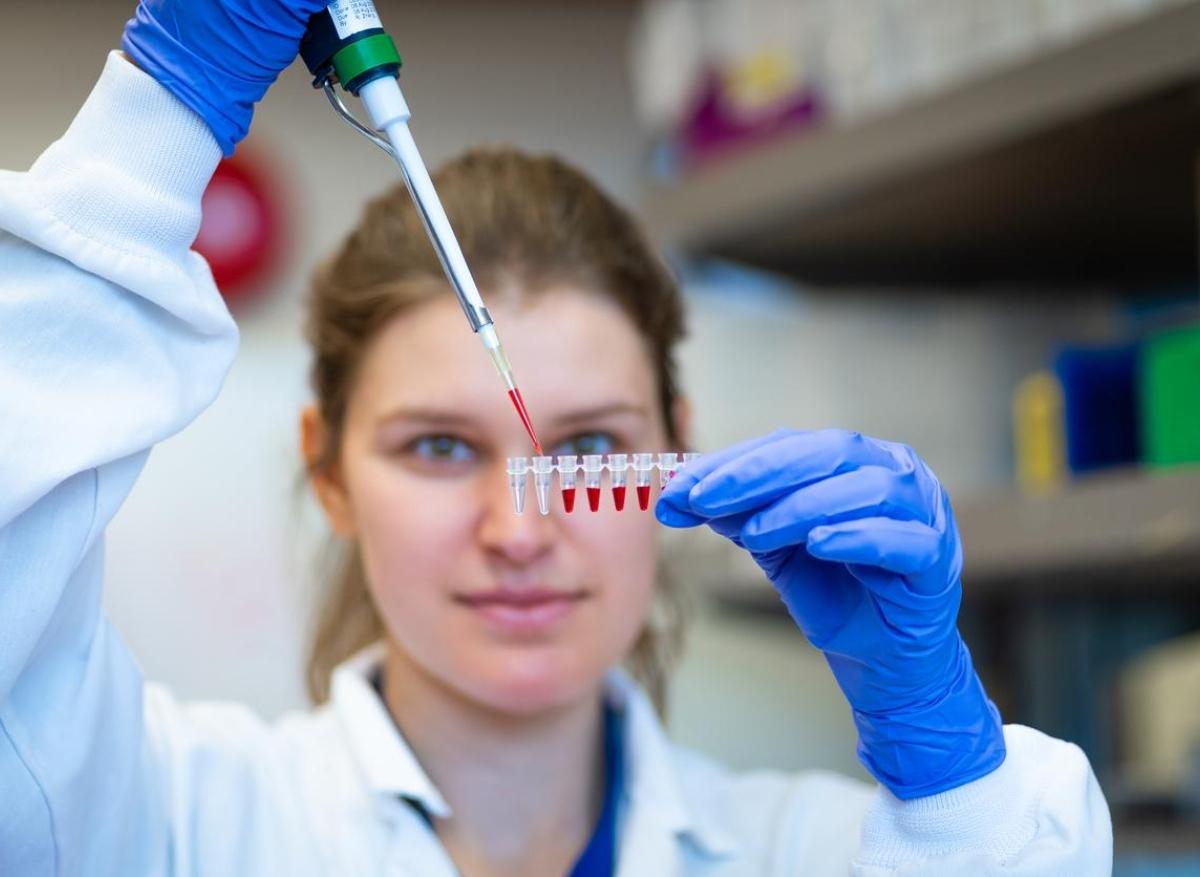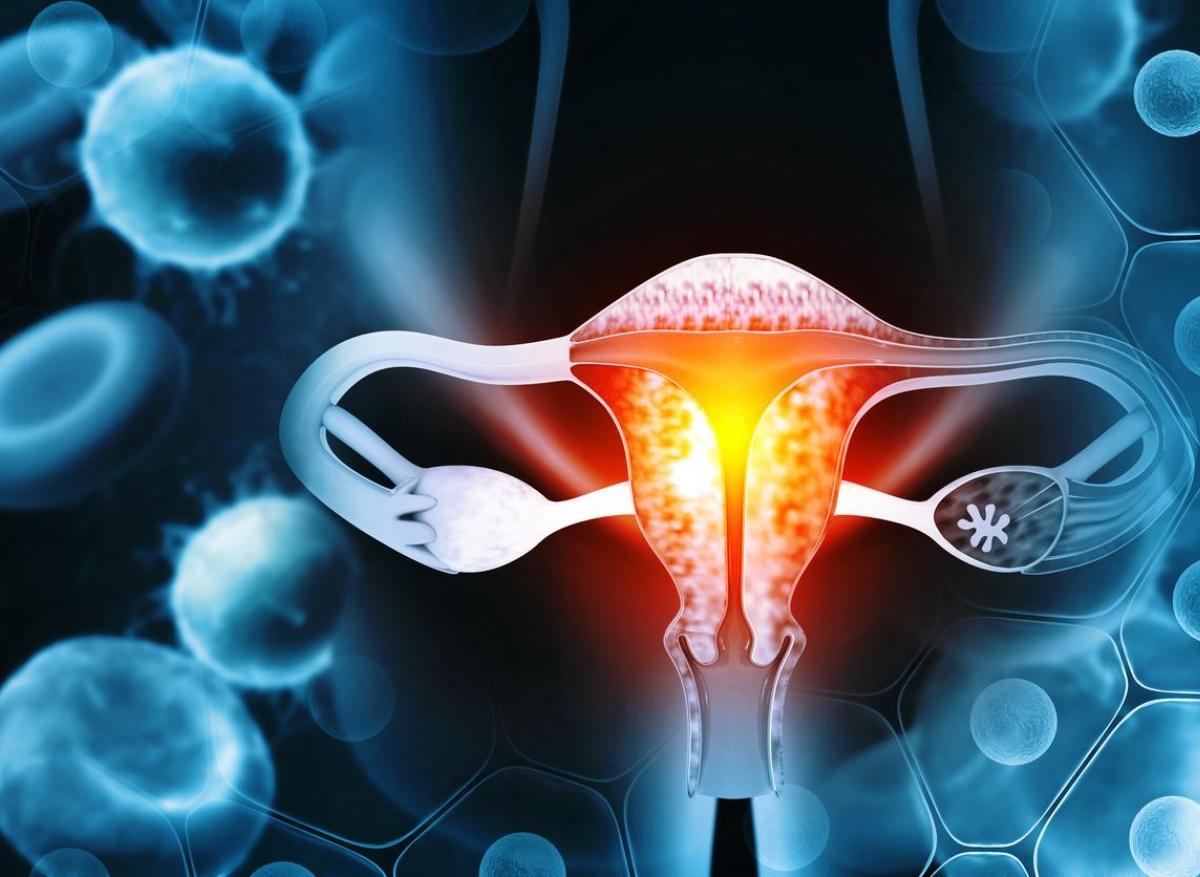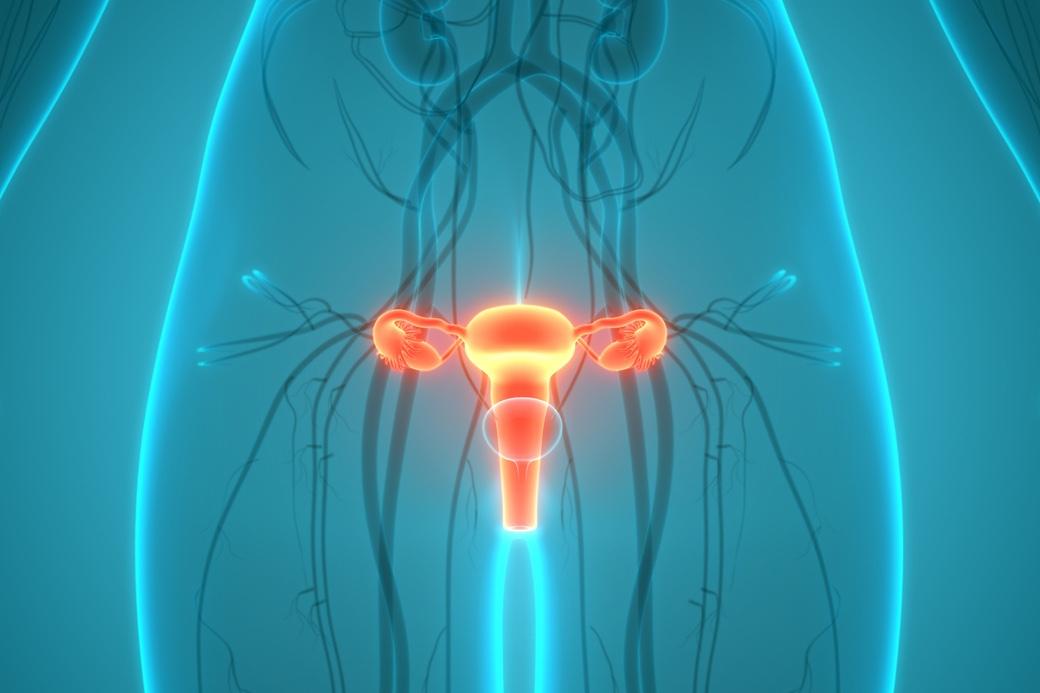Onco-Gynéco
Cancer du col de l’utérus : la biopsie du ganglion sentinelle remet en cause le curage pelvien
L’étude PHENIX démontre que, chez des patientes avec un cancer du col de l’utérus au stade précoce, une stratégie « ganglion sentinelle seul » préserve le contrôle oncologique à 3 ans tout en réduisant nettement la morbidité associée (douleurs, lymphœdèmes, lymphocèles…).

- SewcreamStudio/istock
Le cancer du col reste un enjeu majeur. Historiquement, l’hystérectomie radicale associée au curage ilio-pelvien était la référence, malgré une morbidité substantielle (lymphœdème, lymphocèles, douleurs, neuropathies). La cartographie ganglionnaire et la biopsie du ganglion sentinelle (BGS) visent à limiter les dissections pelviennes inutiles, sachant que la majorité des stades précoces n’ont pas d’atteinte ganglionnaire.
L’étude PHENIX, essai multicentrique randomisé de non-infériorité, a comparé la biopsie du ganglion sentinelle seule versus le curage ganglionnaire ilio-pelvien chez des patientes FIGO 2009 IA1 avec emboles, IA2, IB1 ou IIA1. Après BGS et examen extemporané, les patientes sans atteinte sentinelle étaient randomisées (1:1) vers « BGS seule » ou « curage », toutes recevant une hystérectomie et des traitements adjuvants selon un protocole unifié. Critère principal : survie sans maladie (SSM) à 3 ans, marge de non-infériorité 5 points.
Selon les résultats publiés dans le New England Journal of Medicine, parmi 838 patientes (420 BGS seule, 418 curages), et un suivi médian de 62,8 mois, la survie sans maladie à 3 ans est de 96,9 % avec BGS seule contre 94,6 % avec curage (différence –2,3 points ; IC à 95 % –5,0 à 0,5 ; p<0,001 pour la non-infériorité). La survie spécifique à 3 ans tend même à favoriser BGS seule (99,2 % vs 97,8 %; HR cancer-spécifique 0,37 ; IC 95 % 0,15–0,95).
Réduire la morbidité sans perdre en contrôle tumoral
Aucun cas de récidive ganglionnaire rétro-péritonéale n’a été observé dans le bras BGS seule, contre 2,2 % après curage. Le profil de morbidité est nettement amélioré : lymphocèles 8,3 % vs 22,0 % (p<0,001), lymphœdèmes 5,2 % vs 19,1 % (p<0,001), paresthésies 4,0 % vs 8,4 % (p=0,009), douleurs 2,6 % vs 7,9 % (p=0,001).
Les temps opératoires sont réduits avec la BGS, tout en conservant des performances diagnostiques élevées déjà documentées (détection bilatérale élevée, forte sensibilité et valeur prédictive négative). L’analyse exploratoire selon la voie d’abord, dans un contexte où environ 60 % des patientes ont eu une chirurgie laparoscopique, suggère un risque de récidive plus élevé avec curage que BGS seule en cas de chirurgie mini-invasive, tendance non retrouvée en chirurgie ouverte ; ces données restent génératrices d’hypothèses.
Des questions persistent : sécurité de la stratégie pour des tumeurs de 3–4 cm, intérêt réel des extemporanés (faible rendement d’eviron 8 % et faux négatifs > 10 %, au prix d’un coût et d’une possible altération de l’ultrastadification), et conduite à tenir devant les faibles volumes tumoraux (cellules isolées <0,2 mm vs micrométastases 0,2–2 mm) dont l’impact pronostique diffère.
Un essai robuste qui bouscule la norme
PHENIX est un essai randomisé, multicentrique, de non-infériorité, avec assignation per-opératoire après confirmation de l’absence d’envahissement sentinelle à l’extemporané, adjuvants protocolisés et suivi >5 ans. La représentativité est solide pour les stades précoces ≤3 cm et des patientes candidates à une chirurgie primaire, mais l’extrapolation aux IB2 de 3–4 cm doit attendre des données dédiées (p. ex. SENTICOL III). Le design et la puissance statistique autorisent une conclusion ferme : chez les patientes éligibles, la BGS seule n’est pas inférieure au curage pour la SSM à 3 ans et réduit la morbidité.
Selon un éditorial associé, la biopsie du ganglion sentinelle devrait devenir l’option standard pour le staging ganglionnaire des cancers du col précoces sans atteinte sentinelle perçue, avec ultrastadification systématique et adaptation des adjuvants en cas de micro-maladie. Les perspectives incluent la clarification du rôle des extemporanés, l’harmonisation de la prise en charge des cellules isolées, et la réévaluation des voies mini-invasives actuellement en cours dans les essais (ROCC, RACC, LASH).
Ces résultats invitent à repenser la place du curage pelvien systématique dans la prise en charge chirurgicale initiale. Cette transition vers une chirurgie plus parcimonieuse promet de préserver la qualité de vie sans sacrifier l’efficacité oncologique.


-1729844634.jpg)