Rhumatologie
Arthrose : du désert thérapeutique aux promesses des aGLP-1
Longtemps considérée comme une affection « mécanique », conséquence logique de l’âge et de l’usure, l’arthrose serait aussi une maladie métabolique. Une piste thérapeutique inattendue venue du diabète et de l’obésité, bouleverse les certitudes : les agonistes du GLP-1 pourraient bien changer la donne.
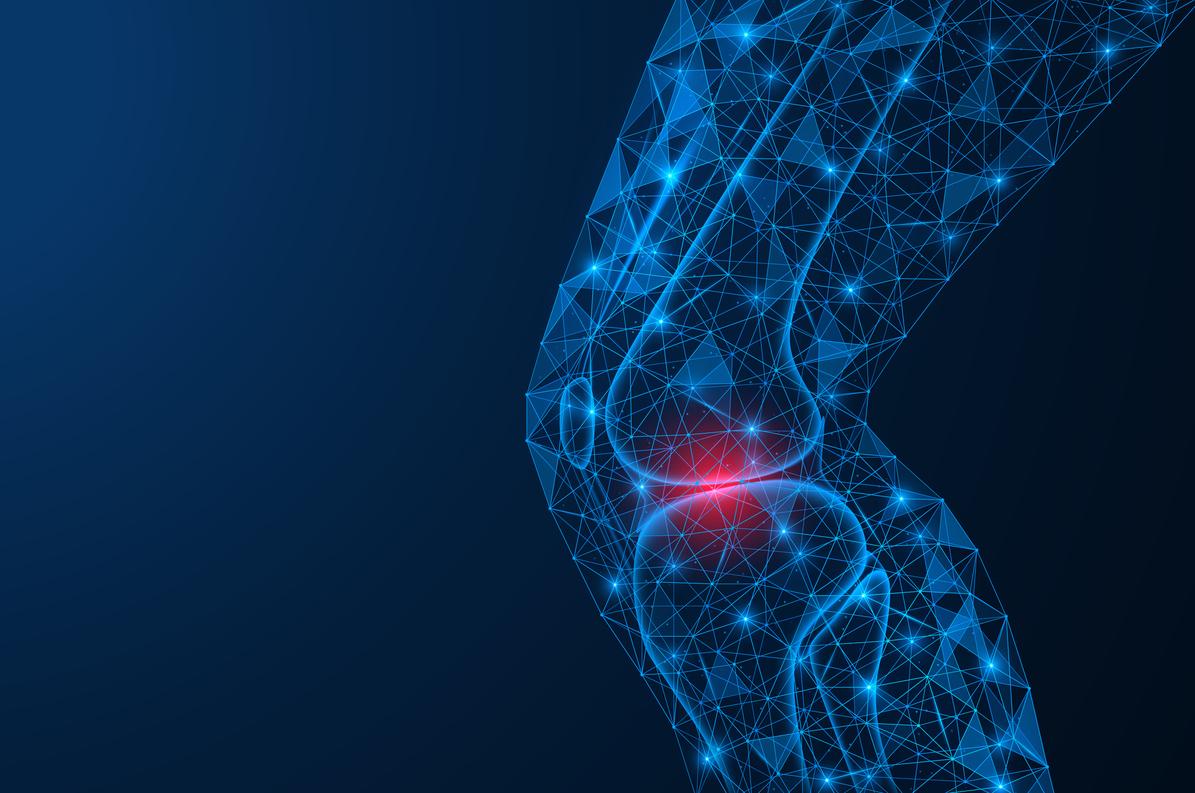
- Ilya Lukichev/istock
Longtemps considérée comme une affection « mécanique », conséquence logique de l’âge et de l’usure, l’arthrose a été abordée avec un schéma simpliste : soulager la douleur en attendant la prothèse. Depuis plus de trente ans, aucune molécule n’a réussi à modifier l’histoire naturelle de cette maladie. Les anti-inflammatoires, infiltrations et antalgiques restent le quotidien. Mais une piste inattendue venue du diabète et de l’obésité bouleverse les certitudes : les agonistes du GLP-1 pourraient bien changer la donne.
Sur le plan pharmacologique, le constat est amer. Depuis plus de trente ans, aucun traitement n’a véritablement transformé la prise en charge de l’arthrose. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, le paracétamol, les infiltrations de corticoïdes ou d’acide hyaluronique constituent toujours l’arsenal de base. Ils apportent un soulagement transitoire mais ne modifient pas l’évolution de la maladie.
Les espoirs n’ont pourtant pas manqué dans les années 2000. Plusieurs pistes prometteuses se sont fracassées sur la réalité clinique. Les anticorps anti-NGF, tel le tanzéumab , ont dû être abandonnés pour des raisons de sécurité, notamment à cause d’une accélération paradoxale de la dégradation articulaire (RPOA) . La sprifermine, un facteur de croissance (FGF18), a bien montré à l’IRM une augmentation du volume cartilagineux, mais sans traduction clinique robuste sur la douleur ou la fonction. Quant au lorecivivint, modulateur de la voie Wnt, il a échoué en phase 3 sur le critère douleur.
Bref, aucune molécule n’a obtenu à ce jour le statut de DMOAD — Disease Modifying Osteoarthritis Drug, ou traitement modificateur de l’arthrose. Pour les patients comme pour les praticiens, le sentiment est celui d’un champ sinistré, presque abandonné par la pharmacologie.
L’irruption inattendue des GLP-1 : du diabète au genou
Et c’est dans ce contexte de désillusion qu’un pavé est tombé dans la mare en 2024. Une publication dans le New England Journal of Medicine a rapporté les résultats de l’essai STEP-9. Conduit chez plus de 400 patients obèses souffrant d’arthrose douloureuse du genou, il évaluait le sémaglutide à la dose de 2,4 mg hebdomadaire.
Les résultats ont surpris par leur ampleur. La perte de poids atteignait en moyenne près de 14 % à 68 semaines, contre 3 % sous placebo. Mais au-delà de la balance, la douleur mesurée par l’échelle WOMAC chutait de 41,7 points sur 100, contre 27,5 pour le placebo, avec une significativité très forte. La fonction physique, évaluée par le WOMAC fonction, progressait, elle aussi, de manière notable.
Moins de kilos, moins de douleur, plus de mobilité : l’équation était d’une évidence clinique déconcertante. Un éditorial du NEJM rappelait immédiatement que la décharge mécanique restait l’explication la plus simple. Alléger un genou, c’est le soulager. Mais la taille de l’effet analgésique intriguait. Et si quelque chose d’autre était en jeu ?
Francis Berenbaum et la piste métabolique
C’est ici qu’intervient la réflexion d’experts comme le Pr Francis Berenbaum, chef du service de rhumatologie de l’hôpital Saint-Antoine à Paris. Pour lui, les agonistes du GLP-1 ne sont pas seulement des médicaments de l’obésité ou du diabète. Ils agissent aussi comme des modulateurs de l’inflammation métabolique. Dans un éditorial publié en 2025 dans Osteoarthritis & Cartilage, Berenbaum a avancé que les GLP-1 pourraient constituer les premiers véritables DMOAD, capables à la fois de soulager et de modifier l’évolution de la maladie.
Depuis plusieurs années déjà, lui et d’autres chercheurs défendent une vision différente de l’arthrose. Loin de l’image simpliste d’une maladie mécanique, liée à l’usure des articulations, ils la décrivent comme une pathologie métabolique et inflammatoire. Les données appuient cette lecture. Les adipokines — leptine, adiponectine, résistine — produites par le tissu adipeux influencent directement l’inflammation synoviale. L’obésité accroît le risque d’arthrose non seulement au niveau des genoux et des hanches, mais aussi dans les mains, preuve que la seule charge mécanique n’explique pas tout. Le tissu adipeux dysfonctionnel induit un état inflammatoire chronique de bas grade qui entretient la douleur et accélère la destruction du cartilage.
Mieux encore, des travaux expérimentaux montrent que les récepteurs du GLP-1 sont présents sur les chondrocytes et les synoviocytes. Leur activation réduit la production de cytokines pro-inflammatoires et module l’immunité locale. En clair, ces molécules agiraient sur deux fronts : d’un côté, la réduction pondérale avec son effet mécanique immédiat ; de l’autre, une modulation directe de l’inflammation métabolique intra-articulaire. C’est cette double action qui fait des aGLP-1 des candidats crédibles à un statut inédit : à la fois symptomatiques et potentiellement structuraux.
Promesses et limites : où en est-on vraiment ?
Peut-on déjà parler de révolution ? Pas encore. Plusieurs questions restent ouvertes. Tout d’abord, cela concerne l’effet structural. En dehors de données positives dans des modèles animaux, aucun essai n’a, pour l’instant, démontré de manière claire que les aGLP-1 ralentissent la perte de cartilage sur le long terme. Les données restent concentrées sur la douleur et la fonction. D’après Francis Berenbaum, le plein effet des aGLP1 sur le cartilage se fait à concentration forte ce rendrait nécessaire leur utilisation en infiltrations intra-articulaires. Ensuite, les indications. Aujourd’hui, les aGLP-1 sont validés dans l’obésité et le diabète de type 2, pas dans l’arthrose. Leur usage dans ce champ relève donc d’un bénéfice métabolique indirect.
Troisième limite, l’accessibilité. Ces traitements restent coûteux, leur disponibilité est encore contrainte, et la priorisation réglementaire risque de limiter leur diffusion à grande échelle. Imaginer un accès large pour des millions de patients arthrosiques paraît encore lointain. Enfin, la recherche clinique doit continuer. Le programme STOP KNEE-OA, actuellement en cours avec le tirzépatide, vise un objectif plus ambitieux : démontrer un critère clinique dur, comme le retard ou la réduction du recours à la prothèse totale de genou. Les résultats sont attendus pour 2026.
En attendant : le quotidien des patients
D’ici là, la prise en charge de l’arthrose reste fondée sur les bases classiques : perte de poids, activité physique adaptée, kinésithérapie, antalgiques, infiltrations. Mais l’horizon s’éclaire. Pour les patients, l’espoir renaît que des médicaments issus d’autres domaines thérapeutiques puissent enfin changer leur quotidien. Pour les praticiens, c’est un rappel que l’arthrose ne se réduit pas à une simple mécanique, mais qu’elle doit être pensée comme une maladie systémique, métabolique et inflammatoire.
Après trois décennies de désillusions, l’irruption des aGLP-1 dans le champ de l’arthrose a valeur de séisme. Ces médicaments n’ont pas encore obtenu le statut de DMOAD, mais ils redonnent une perspective, en particulier grâce à la réflexion de chercheurs comme Francis Berenbaum. L’arthrose, longtemps considérée comme une fatalité mécanique, s’impose désormais comme une maladie métabolique.
Les aGLP-1 ne sont pas encore la révolution attendue. Mais ils ouvrent une brèche dans un champ sinistré. Et parfois, une brèche suffit pour que tout un pan de la recherche et de la clinique retrouve de l’élan.


































