Diabétologie
Diabète de type 1 : à quoi sert le peptide-C ?
On retrouve chez les patients diabétiques de type 1 un peptide : le peptide C. Si sa présence est connue, son impact sur les fonctionnalités du pancréas demeure flou. Une étude très récente nous apporte des éléments de réponse.
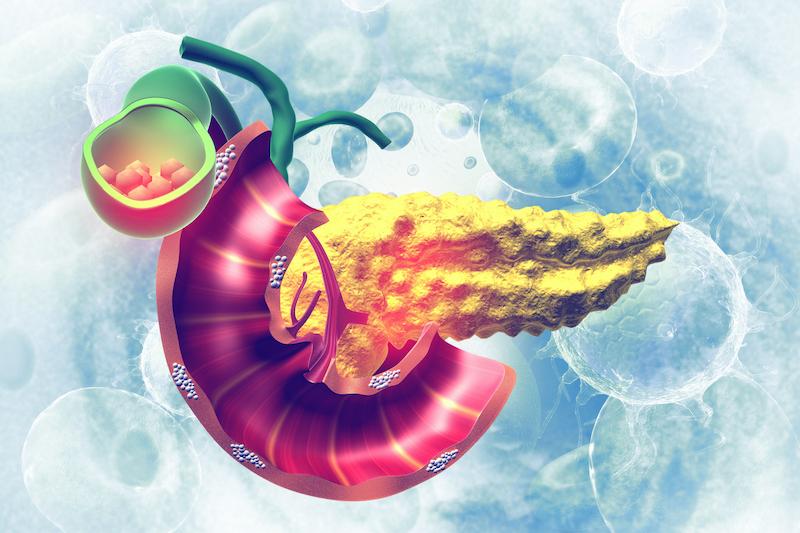
- Istock/Mohammed Haneefa Nizamudeen
La présence d’un peptide-C dosable après plusieurs années d’évolution d’un diabète de type 1 traduit la persistance de cellules bêta pancréatiques, sans qu’un rôle fonctionnel clair puisse lui être attribué selon la concentration retrouvée.
Afin de mieux préciser la relevance d’un peptide-C dosable chez un patient diabétique de type 1, des Etude peptide Cont réalisé une batterie de tests biologiques chez des patients diabétiques de type 1 via le réseau Américain T1D Exchange Clinic Network. Ils ont ainsi pu déterminer que seuls les patients avec un pic de sécrétion de peptide-C au cours d’un repas test supérieur à 0,40 nmol/L (1,20 ng/mL, correspondant au groupe peptide-C élevé) conservaient une réelle sécrétion d’insuline induite par une hyperglycémie.
De plus, si la sécrétion de glucagon augmente chez tous les patients en cas d’hypoglycémie, elle est significativement plus importante dans le groupe peptide-C élevé. Enfin, les patients de ce groupe peptide-C élevé présentent un meilleur équilibre glycémique global, qu’il soit défini par l’HbA1c ou par le temps dans la cible d’une mesure continue du glucose.
L'hyperglycémie n'est pas toujours suffisante à la sécreation d'insuline
Chez les individus présentant un pic de peptide-C lors d’un repas test entre 0,017 et 0,20 nmol/L (groupe peptide-C faible) ou entre 0,20 et 0,40 nmol/L (groupe peptide-C intermédiaire), une stimulation de l’insulino-sécrétion par injection de glucose associé à de l’arginine (acide aminé puissant sécrétagogue) permet l’augmentation de production du peptide-C, confirmant la présence de cellules bêta pancréatiques.
En revanche, ces cellules bêta, dans ces deux groupes peptide-C faible et intermédiaire, ne sont pas capables d’augmenter leur sécrétion d’insuline en réponse à l’hyperglycémie seule. De manière intéressante, cette « défaillance » des cellules bêta persistantes est associée à une moins bonne réponse des cellules alpha à l’hypoglycémie, avec une moindre sécrétion de glucagon, traduisant donc une défaillance globale de l’ilot endocrine pancréatique. En revanche, les tests d’insulino-sensibilité sont identiques quel que soit le taux mesurable de peptide-C, de même que la sécrétion de GLP-1 en réponse à l’hyperglycémie.
Une multitude de tests pour comprendre...
La force de cette étude est d’avoir pu réaliser plusieurs tests non réalisables en pratique quotidienne, permettant de bien caractériser les capacités sécrétoires des cellules bêta et alpha pancréatiques, puis de corréler ces résultats avec les données d’un « simple » repas test (peptide-C maximal) :
- test de sécrétion d’insuline très sensible par co-stimulation glucose – arginine ;
- clamp euglycémique hyperinsulinémique permettant à la fois de quantifier la réponse sécrétoire des cellules bêta en présence d’une hyperglycémie, puis de mesurer la sensibilité à l’insuline ;
- clamp hypoglycémique hyperinsulinémique, durant lequel le patient est maintenu en hypoglycémie par une perfusion d’insuline, afin d’étudier ses capacités de contre-régulation glycémique ;
- et une plus classique mesure continue du glucose pour déterminer le temps dans la cible et la variabilité glycémique.
La mesure du peptide-C après un repas test (ingestion de boissons calibrées associant glucose et quelques acides aminés) est quant à lui un test réalisable en clinique courante. En associant la concentration de peptide-C mesurée lors du repas test aux réponses aux précédents tests, cette étude permet pour la première fois d’extrapoler les capacités sécrétoires alpha et bêta à partir de cette mesure du peptide-C lors du repas test.
... et mieux définir les seuils pour les études d’intervention ou transplantation d’ilots
Toutes les études visant à préserver voire restaurer l’insulino-sécrétion endogène de patients diabétiques de type 1 ont un critère d’inclusion basé sur la concentration du peptide-C mesuré lors d’un repas test. La présente étude montre que les patients avec un peptide-C détectable lors d’un repas test, mais inférieur à 0,40 nmol/L, ont certes des cellules bêta pancréatiques persistantes, mais que celles-ci sont défaillantes et ne sont plus capables de sécréter de l’insuline en réponse à l’hyperglycémie seule. Ces cellules bêta persistantes ont donc une faible probabilité de participer à l’équilibre glycémique, et seuls les patients avec un pic de peptide-C supérieur à 0,40 nmol/L devraient être inclus dans des études visant à préserver une insulino-sécrétion résiduelle.
Une autre application concerne la greffe d’ilots pancréatiques, aujourd’hui réservée aux patients diabétiques de type 1 sans aucun peptide-C détectable. Cette étude relativise donc ce critère, puisque des individus avec un peptide-C détectable mais inférieur à 0,40 nmol/L ont certes des cellules bêta persistantes, mais ne participant probablement pas à l’équilibre glycémique global, et présentent en revanche une diminution de la sécrétion de glucagon, augmentant donc le risque d’hypoglycémie sévère.
Les auteurs proposent donc qu’un peptide-C détectable mais inférieur à 0,40 nmol/L ne contre-indique pas formellement une transplantation d’ilots.



























