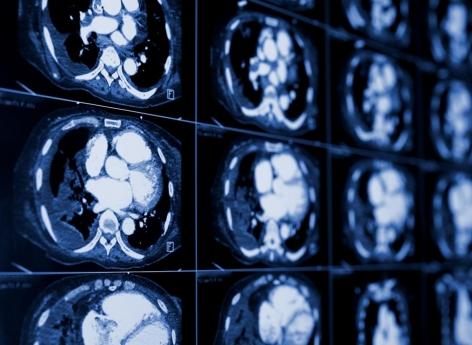Urologie
Cancer du rein métastasé : 2 nouvelles associations immunothérapie et iVEGF
Deux nouvelles associations, immunothérapie-inhibiteur du VEGF, produisent des résultats comparables en première ligne au traitement de référence dans le cancer du rein au stade avancé. Les analyses en sous-groupes devraient aider à mieux individualiser le traitement.
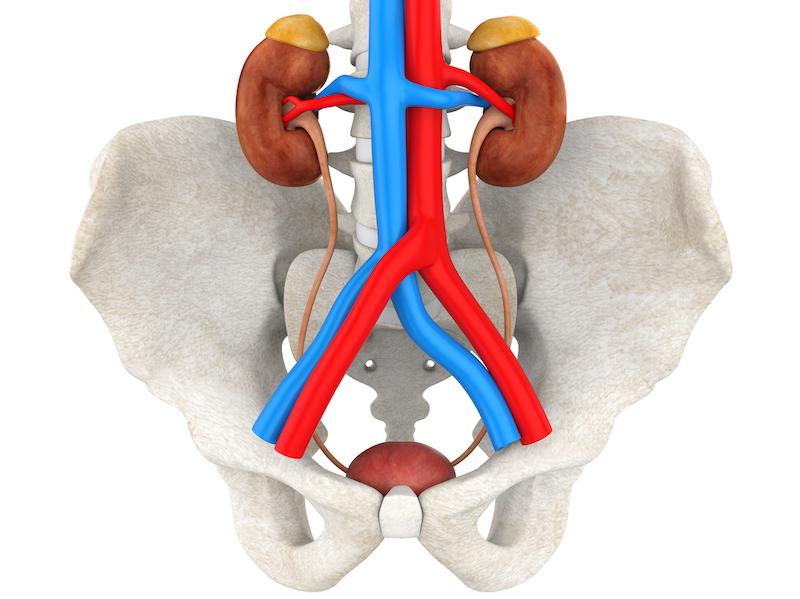
- Nerthuz/istock
Les résultats de deux grands essais cliniques de phase 3 en première ligne dans le carcinome métastatique du rein sont publiés dans le New England Journal of Medicine. L'un compare l'avelumab, un anti-PD-L1, associé à l'axitinib (anti-VEGF) par rapport au sunitinib (iTKI avec forte activité anti-VEGF), et l'autre compare le pembrolizumab, un anti-PD1, associé à l'axitinib par rapport au sunitinib.
Ces deux essais montrent une supériorité des 2 associations versus le sunitinib seul en termes de survie sans progression et de taux de réponse objective. L'étude sur le pembrolizumab montre également un avantage sur la survie globale. Les principaux critères d'évaluation de ces essais sont la survie sans progression et la survie globale, mais dans l'étude avelumab, c’est chez les patients PD-L1 positif, alors que dans l'étude pembrolizumab, c’est dans l’ensemble de la population (60% de patient PD-L1 ≥ 1).
Evolution rapide des traitements
Le traitement du carcinome métastatique du rein a été révolutionné à deux reprises en un peu plus de 10 ans par les études montrant, d'une part, que l'inhibition du facteur de croissance vasculaire endothélial (VEGF) pouvait induire une réduction tumorale et augmenter la survie sans progression et, d'autre part, que les immunothérapies pouvaient induire des réponses durables et augmenter la survie globale chez les patients atteints de ce type de cancer.
Les recommandations pour le traitement du carcinome métastatique rénal ont donc radicalement changé et promeuvent désormais des stratégies qui ciblent ces deux principales voies. On peut légitimement s’attendre à ce que ces deux nouvelles associations deviennent des références de traitement et soient incorporées dans les futures recommandations aux côtés de l’association nivolumab et ipilimumab, sous réserve de bien en comprendre les tenants et les aboutissants.
Rôle du nouvel anti-VEGF
La première question est de savoir si l'inhibition du PD-1 et du PD-L1 est synergique avec l'axitinib, le nouvel anti-VEGF, et quel est le rôle de cette molécule dans ces associations.
Dans une vaste étude de phase 2, l'axitinib s'est révélé un inhibiteur puissant et sélectif du VEGF, avec une excellente activité antitumorale, mais il nous manque un groupe témoin (axitinib en monothérapie) dans les 2 essais pour s'assurer que l'avelumab et le pembrolizumab apportent bien une contribution supplémentaire aux résultats observés.
Résultats globalement comparables
Il est difficile de comparer les 2 essais, qui sont très proches, car il y a toujours un risque de différence de populations étudiées, ce qui est le cas pour l’étude pembrolizumab qui contient un plus grand pourcentage de patients à risque favorable (30% versus 20%). Les deux essais, ainsi que l'essai récent sur le nivolumab et l'ipilimumab, ont été menés versus le même groupe témoin (sunitinib en monothérapie).
Les taux de survie sans progression et les taux de réponse objective sont très semblables et le meilleur profil des patients de l’étude pembrolizumab se reflète probablement dans la survie sans progression plus longue des patients recevant le sunitinib seul dans l’essai pembrolizumab par rapport à celui de l’avelumab (11,1 mois vs 8,4 mois). Cependant, la survie globale de l'étude sur le pembrolizumab est significativement plus longue que celle de l'étude sur l'avelumab, à durée de suivi équivalente : il faudra regarder si celle de l’avelumab s’allonge également avec un suivi plus prolongé.
Pour l'essai sur le nivolumab et l'ipilimumab il n’y a pas eu d'augmentation significative de la survie sans progression, bien que la survie globale soit augmentée au même niveau et, surtout, que le taux de réponse complète des patients soit plus élevé.
Mieux individualiser le traitement
La vraie question au final est donc de savoir si les analyses en sous-groupes de ces essais pourront aider les urologues et les oncologues à mieux individualiser le traitement à l’aide de différents biomarqueurs.
Le taux de PD-1/PD-L1 souffre de critiques récurrentes depuis plusieurs années, mais d’autres biomarqueurs sont peut-être susceptibles d’apporter un progrès dans le carcinome rénal métastatique (marqueur de l'angiogenèse pour prévoir la réponse aux inhibiteurs du VEGF, la réponse effectrice des lymphocytes T pour prévoir celle aux inhibiteurs du PD-1 et PD-L1…).