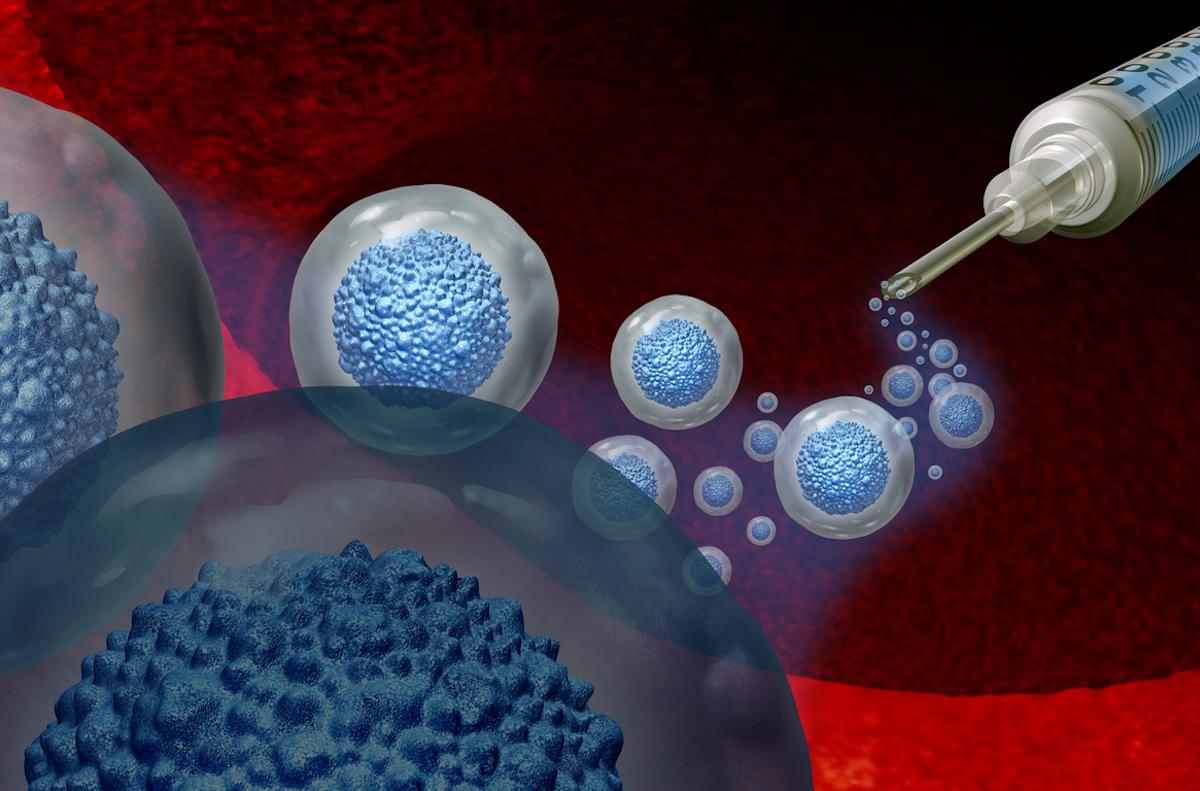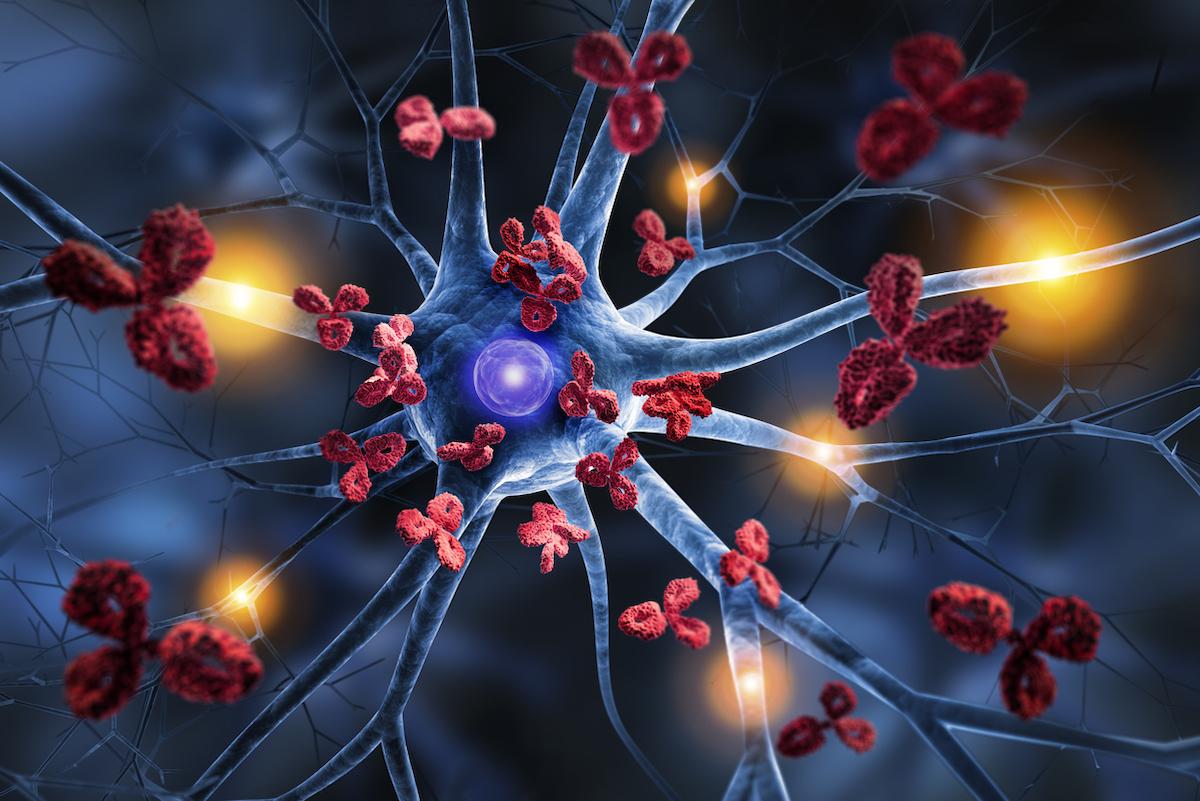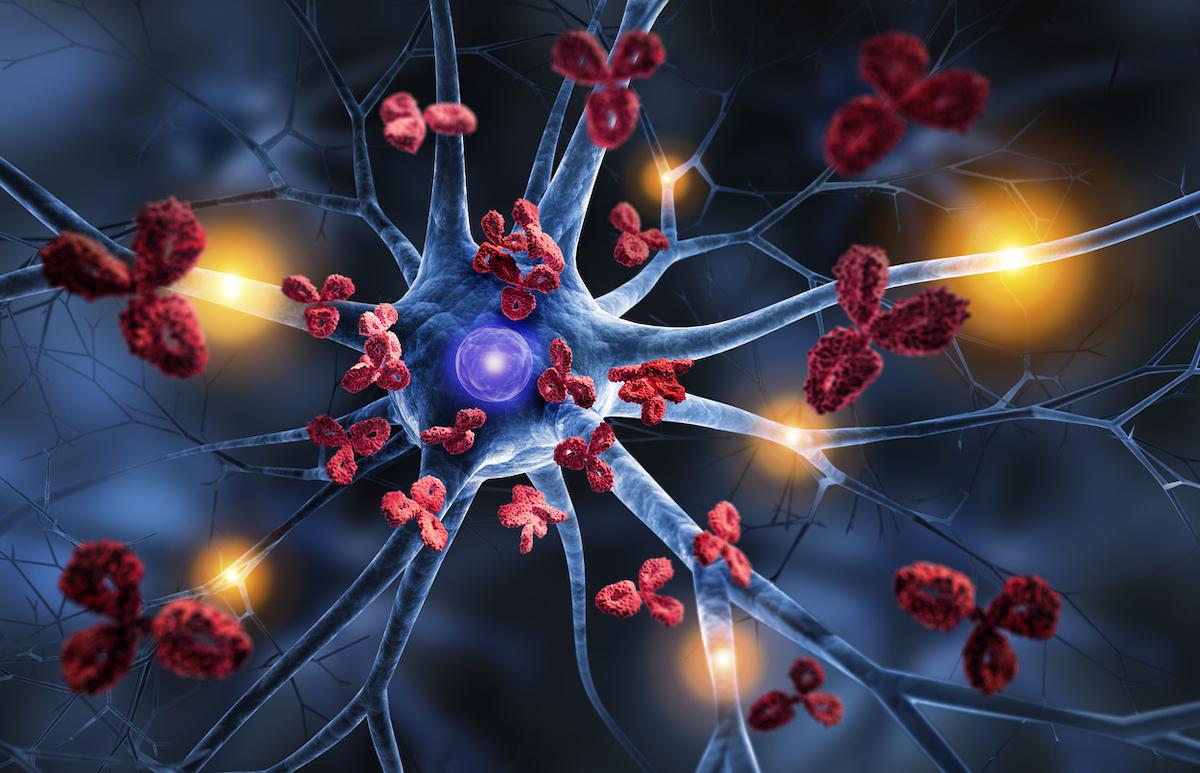Neurologie
Sclérose en plaques rémittente-récurrente : intérêt d’un inhibiteur des tyrosines kinases de Bruton
Une étude de phase 2 (FENopta) a analysé l’impact prometteur du Fenebrutinib, un inhibiteur des Tyrosines kinases de Bruton (BTK), sur les marqueurs IRM et LCR dans la SEP rémittente-récurrente

- Mykola Sosiukin/istock
La classe thérapeutique des inhibiteurs des Tyrosines kinases de Bruton (BTK) est développée depuis quelques années dans différentes indications neurologiques (SEP par poussée et SEP progressives). BTK est impliqué dans l’inflammation du système nerveux périphérique et central dans la SEP, ce qui peut entraîner une évolution biologique de la maladie.
En début d’année, une première étude dans la SEP par poussée n’a pas montré de supériorité de l’Evobrutionib par rapport au Teriflunomide (études Evolution RMS 1 et 2). Début Septembre 2024, un communiqué de presse a annoncé que le Tolebrutinib n’était pas supérieur au Teriflunomide dans la SEP par poussée (études Gemini 1 et 2) mais qu’en revanche cette molécule retardait la survenue d’une progression du handicap confirmée à 6 mois dans les formes secondairement progressives non actives (étude Hercules). Deux études (études Fentrepid et Perseus) sont également en cours dans les formes progressives d’emblée avec, respectivement, le Fenebrutinib et le Tolebrutinib.
Une étude de phase 2 randomisée versus placebo
L’objectif de l’étude était d’évaluer les effets du Fenebrutinib sur les résultats de l'IRM ainsi que la capacité du Fenebrutinib à pénétrer dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) dans l'étude de phase II FENopta.
Cent six patients atteints de SEP récurrente ont été randomisés selon un rapport 2:1 pour recevoir du Fenebrutinib (200 mg, deux fois par jour) ou un placebo pendant 12 semaines. Le critère d'évaluation principal était le nombre total de nouvelles lésions IRM T1 rehaussées par le gadolinium (Gd+) aux semaines 4, 8 et 12. Les principaux critères d'évaluation secondaires évaluaient l'effet du traitement sur le nombre de lésions IRM (par exemple, les lésions T2 nouvelles/agrandies [NET2]) et la sécurité. Les critères d'évaluation exploratoires évaluaient les concentrations de Fenebrutinib dans le LCR.
Des résultats prometteurs
Sur 106 patients randomisés avec IRM évaluable, 70 ont reçu du Fenebrutinib et 36 ont reçu un placebo. Aux semaines 4, 8 et 12 (combinées), les patients atteints de Fenebrutinib ont eu une réduction de 69 % du total de nouvelles lésions Gd+ et une réduction de 74 % du total des lésions NET2 par rapport aux patients sous placebo. Des réductions relatives des lésions Gd+ et NET2 ont été observées à la semaine 8 (92 % et 90 %, respectivement) et à la semaine 12 (90 % et 95 %, respectivement).
La concentration moyenne de Fenebrutinib dans le LCR chez 11 pwRMS après 12 semaines d'administration continue de Fenebrutinib était de 43,1 ng/mL, ce qui est supérieur à la CI50 moyenne (plage active) de CD63 (10,0 ng/mL), de phospho-BTK (7,5 ng/mL) et dosages sur sang total CD69 (5,3 ng/mL). Le profil de sécurité était favorable, aucun événement indésirable grave, ni décès, n'ayant été signalé.
En pratique
Ces données de FENopta mettent en évidence le potentiel du Fenebrutinib pour traiter le RMS en réduisant les lésions IRM avec un profil de sécurité favorable. Même si les études de phase 3 n’ont pas montré de supériorité des BTK inhibiteurs sur le Teriflunomide, leur action sur la part inflammatoire de la maladie reste importante (taux annualisé de poussée de l’ordre de 0.15/an) et ces résultats sur l’IRM confirment leur action « périphérique ».
Les premiers résultats sur le LCR montrent une bonne pénétration et indiquent que le Fenebrutinib a été détecté dans le LCR à des concentrations cliniquement pertinentes pour avoir un impact sur les mécanismes sous-jacents à la biologie de la maladie chronique évolutive dans la SEP. Ces résultats sont encourageants et semblent illustrer indirectement l’efficacité des BTK inhibiteur sur les mécanismes centraux/intracérébraux qui pourrait expliquer les résultats de l’étude