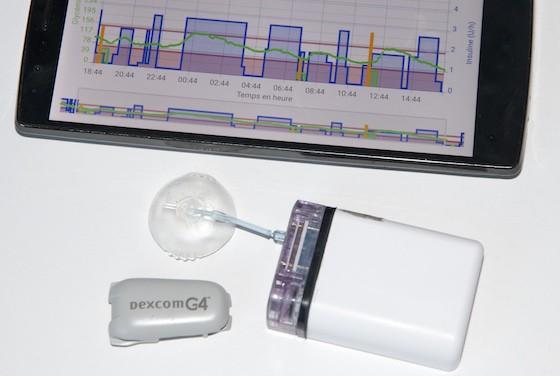Diabétologie
Etude E3N : attention aux sodas lights et aux régimes alimentaires acides
Vin, café décaféiné et soda light : état des lieux de l'influence des aliments sur les risques de développer un diabète de type 2.

- a.has / Flickr
Avec les antécédents familiaux, le manque d'exercice physique et le surpoids, la mauvaise qualité de l'alimentation est un facteur bien connu de risques de développer un diabète de type 2 (DT2). Reste qu'il n'est pas toujours évident de savoir quels aliments sont à proscrire. Invité à s'exprimer lors du troisième jour du Congrès annuel de la Société francophone du diabète à Lyon, Guy Fagherazzi, chercheur en épidémiologie nutritionnel, a fait un état des lieux sur les résultats de l'étude française E3N, qui permettent d'affiner notre connaissance des liens entre diabète et alimentation.
Etude E3N
Cette étude qui s’appuie sur une cohorte d’environ 100 000 femmes volontaires françaises, adhérentes à la MGEN, nées entre 1925 et 1950 et suivies depuis 1990, démontre ainsi que le café entraîne chez les femmes une baisse des risques de développer un DT2 de 27 % à partir de 3 tasses par jour. Un résultat qui est vrai aussi pour le décaféiné, démontrant que ce n'est donc pas la caféine qui est en jeu ici, mais plutôt les polyphénols, en particulier les lignanes.
Le vin protecteur
Le vin démontre également des résultats intéressants : « Les femmes qui consomment du vin auraient moins de risques de développer un DT2 que les femmes qui n'en ont jamais consommé », explique encore Guy Fagherazzi. Une baisse qui est même plus importante si ces femmes commencent à consommer au moment de l'adolescence. Pas d'apologie de l'alcool néanmoins, car l'étude ne parle que d'une consommation très faible : moins d'un verre par semaine.
Les sodas lights délétères
Si le chercheur note une hausse, assez logique, des risques de développer un DT2 avec une consommation importante de soda (plus de 1,5 litre par semaine), il met surtout en avant une augmentation encore plus prononcée des risques avec les sodas lights, qui pourtant ne contiennent pas de sucre, remplacé par des édulcorants comme l'aspartame. Pour expliquer ces résultats, publiés pour la première par la même équipe en 2013, ils n'existent pour l'instant que des hypothèses. Certains chercheurs avancent l'idée que l'aspartame serait un leurre pour l'organisme qui générerait en réponse un pic d’insuline, provoquant le besoin de surconsommer du sucre. D'autres avancent l'hypothèse d'une « décomplexion » des consommatrices qui, pensant que ces sodas sont sans danger pour l'organisme, en consommerait davantage, ce qui, « au long cours, aurait des effets psychologiques voire neurologiques comme une addiction au sucre ».
La question de l'acidité des repas est enfin une piste à investiguer puisque les régimes acidogéniques augmenteraient par quatre les risques de développer un DT2 par rapport aux régimes alcalinisants, c'est-à-dire basiques. Mieux vaudrait donc préférer un régime riche en fruits et légumes qu'en charcuterie, jambon, fromage et pain.