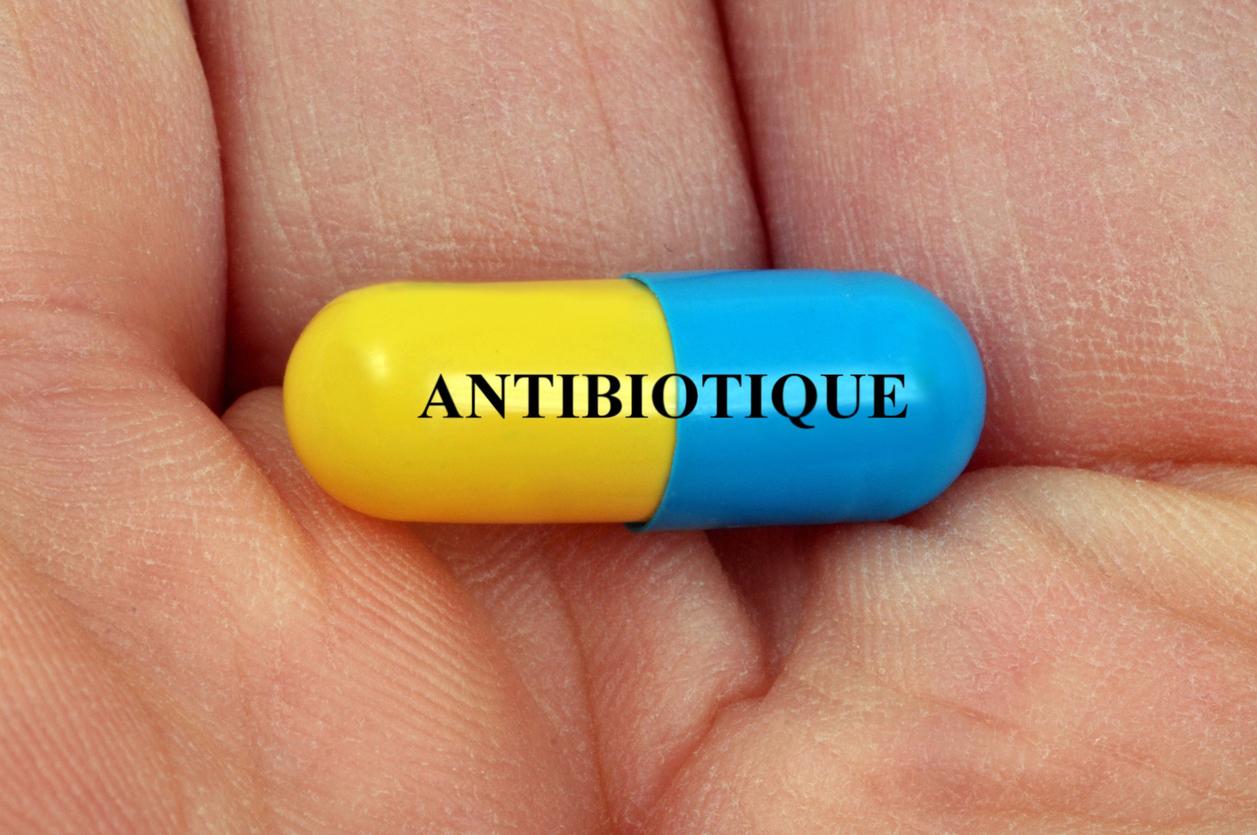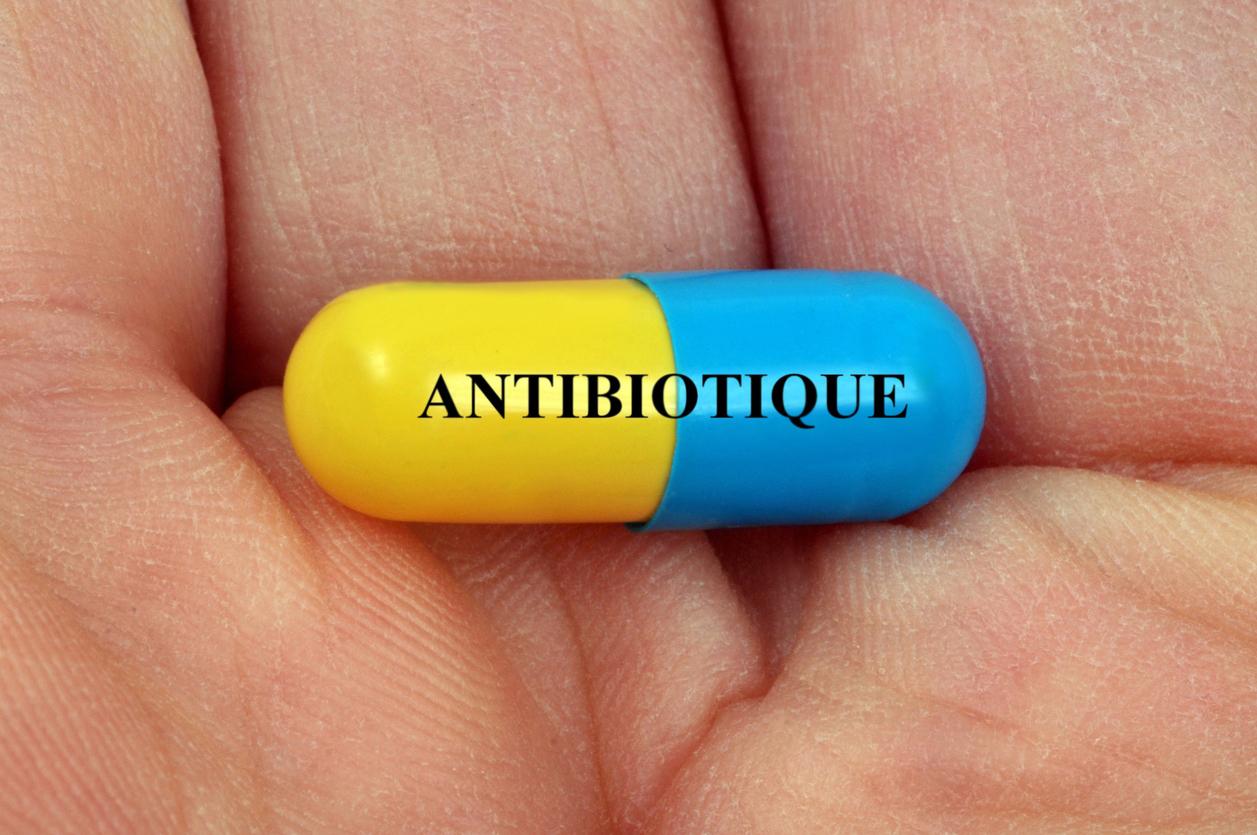Pneumologie
Actualisation des recommandations de prise en charge des pneumonies aiguës communautaires de l'adulte.
De nouvelles recommandations sur la démarche diagnostique et la prise en charge thérapeutique des pneumopathies aigues communautaires de l’adulte ont été récemment publiées. Les nouveaux points forts concernent surtout la place de l’échographie thoracique et le meilleur ciblage du traitement, avec un raccourcissement de sa durée. D’après un entretien avec Damien BASILLE.

Des recommandations, parues en français dans la Revue des Maladies Respiratoires et en anglais dans le Respiratory Medicine and Research, ont été élaborées par les sociétés de pneumologie et d’infectiologie, en collaboration avec d’autres spécialistes, comme les généralistes enseignants, les urgentistes, les microbiologistes ou encore les radiologues. Les précédentes recommandations dataient de 2010. Dans cette nouvelle version, trois niveaux de gravités ont été définis, permettant de cibler à la fois la démarche diagnostique et la stratégie thérapeutique. Le premier groupe comprend les pneumonies aigues communautaires non graves, prises en charge en ambulatoire. Le deuxième groupe comporte les pneumonies aigues non graves mais nécessitant une hospitalisation. Enfin, le troisième groupe correspond aux pneumopathies aigües graves, qui selon les critères de 2019, peuvent être accompagnées d’un choc septique, d’une détresse respiratoire nécessitant une ventilation mécanique ou encore d’au moins trois critères mineurs de gravité.
Point sur la démarche diagnostique
Le docteur Damien BASILLE, pneumologue dans le Service de Pneumologie et Unité de Soins Continus Cardio Thoracique Vasculaire et Respiratoire au Centre Hospitalier Universitaire Amiens-Picardie, a participé à la rédaction de ces recommandations. Il explique que la gradation des examens de confirmation diagnostique est fonction des trois niveaux de gravité. Il précise qu’une place importante est gardée à l’examen d’imagerie de confirmation, mais qu’en ambulatoire, il ne faut pas attendre cette imagerie pour traiter, mais qu’il est recommandé qu’elle soit réalisée dans un délai raisonnable de trois jours. Damien BASILLE insiste sur la place de l’échographie thoracique, nouveauté dans les recommandations, comme outil alternatif au même titre que la radiographie de poumons, sous réserve que les opérateurs aient reçu une formation validante. L’échographie thoracique a, en effet, une bien meilleure sensibilité et spécificité que la radiographie standard, surtout pour les patients ayant des difficultés à se mobiliser. Le scanner thoracique garde une place seulement en cas de doute diagnostique, d’évolution défavorable après trois jours de traitement bien conduit, ou si des facteurs de risque de cancer pulmonaire comme l’âge et le tabagisme sont présents. Dans ce dernier cas, le scanner peut être réalisé à distance de la pneumonie, une fois que les images de celle-ci se sont résorbées. En termes d‘examens biologiques, la CRP et la procalcitonine ont une place très limitée, puisqu’elles n’apportent aucun bénéfice en termes de diagnostic ou de prise en charge thérapeutique. Elles ne sont donc pas recommandées en systématique. Damien BASILLE souligne qu’il y peu d’évolution sur les examens microbiologiques par rapport aux recommandations de 2010 : En ambulatoire, le traitement est probabiliste et il n‘est pas nécessaire de documenter l’infection en première intention par un examen des crachats ou des hémocultures. Pour les patients hospitalisés sans critères de gravité, ces examens sont utiles seulement en cas d’antibiothérapie non conventionnelle, en cas de doute sur un germe atypique, en cas d’infection à pyocyanique ou d’antibiothérapie parentérale dans les trois mois précédents. L’antigénurie légionelle est utile en cas de forte suspicion clinique ou d’histoire compatible, éventuellement pour redresser un diagnostic. L’antigénurie pneumocoque n’est pas recommandée car elle est peu spécifique et rarement positive. Pour les patients graves, pris en charge en soins critiques, tout le spectre d’examens microbiologiques doit être proposé, y compris les antigénuries légionnelle et pneumocoque, susceptible d’impacter le choix de l’antibiothérapie initiale ou son adaptation. Damien BASILLE insiste sur la place croissante que prennent les tests de biologie moléculaire. Les PCR triplex ou quadriplex (grippe, VRS, SARS-CoV-2…) sont utiles en période épidémique. Les PCR à panel respiratoire étendu ont un impact difficile à évaluer. On distingue les panels « haut », basés sur un prélèvement rhinopharyngé (identification de 10-15 virus + certaines bactéries atypique) et les panels « bas », nécessitant un prélèvement profond et permettant en plus d’identifier certaines bactéries cultivables et gènes de résistance. En cas de pneumonie hospitalisé, un panel haut peut être proposés en cas de suspicion de bactérie atypique ou si l’identification d’un virus autre que VRS / Grippe A et B / SARS-CoV-2 est susceptible d’influer sur la prise en charge du patient. La réalisation d’une PCR avec un panel respiratoire bas est limitée aux cas de pneumonies graves.
Evolution de la prise en charge thérapeutique
Damien BASILLE explique qu’il n’y a pas eu de changent majeur sur le type de molécules recommandées par rapport à 2010. Les patients ambulatoires, sans comorbidité, doivent bénéficier d’amoxicilline ou de pristinamycine, en alternative. En cas de comorbidités, l’amoxicilline-acide clavulanique est préconisée, ou, en alternative, une céphalosporine de troisième génération parentérale. En cas de germe atypique, la préférence ira aux macrolides. Pour les patients hospitalisés non graves, le schéma thérapeutique est identique sauf pour la pristinamycine qui n’a pas été évaluée. L’alternative est donc une céphalosporine de troisième génération (ou une fluoroquinolone en cas d’allergie grave et documentée aux béta-lactamines). Aucun bénéfice à la bithérapie n’a été démontré chez ce type de patients. Celle-ci est réservée aux patients les plus sévères, en étant d’emblée probabiliste, avec une régression secondaire en fonction des pathogènes mis en évidence. Damien BASILLE souligne que le changement le plus important concerne la durée du traitement. En effet, dans le cadre des pneumonies non graves, avec une évolution favorable à 3 jours, il a été montré qu’un schéma de 3 jours était non inférieur à un schéma de 7 jours en termes de succès clinique ou de risque de récidive (en l’absence d’immunodépression ou d’insuffisance respiratoire). L’arrêt des antibiotiques à trois jours est conditionné à l’obtention de critères de stabilité clinique (température ≤ 37,8°c, tension artérielle systolique ≥ 90mmHg, fréquence cardiaque ≤ 100, fréquence respiratoire ≤ 24 et saturation ≥ 90% en air ambiant). Dans le cas contraire, les antibiotiques seront poursuivis 48h de plus et un nouveau point sera fait à cinq jours, sans aller au-delà de sept jours. Auquel cas, une erreur diagnostique ou une complication comme un abcès ou une pleurésie doivent être évoqués. Enfin, concernant la place de la corticothérapie, les bénéfices sont limités aux cas de pneumonies graves. Un essai français a ainsi montré que la prescription précoce d’hémisuccinate d’hydrocortisone (HSHC)montrait des résultats positifs, avec une diminution assez nette de la mortalité, dans les cas de pneumonies graves, nécessitant une hospitalisation en soins critiques. La corticothérapie n’est donc pas recommandée en cas de pneumonie non grave (ambulatoire ou hospitalisée). En cas de pneumonie grave, il est recommandé de débuter un traitement par HSHC dans les 24h suivant l’apparition des signes de gravité (200 mg par jour pendant 4 à 7 jours suivant l’évolution clinique suivi d’une décroissance pour une durée totale de traitement de 8 à 14 jours).
En conclusion, les principales nouveautés des recommandations de prise en charge des pneumonies aigues communautaires sont représentées par la place croissante qu’occupe l’échographie thoracique et par une utilisation plus raisonnée des traitements antibiotiques avec le raccourcissement de la durée du traitement, et un recours plus limité aux associations d’antibiotiques. Enfin, la corticothérapie est désormais recommandée précocement en cas de pneumonie grave.