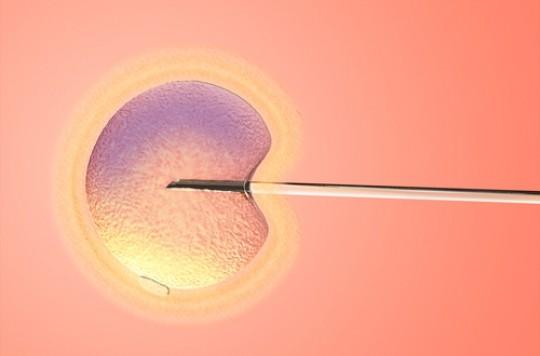Gynéco-obstétrique
Risque cardiovasculaire après AMP : un suivi à très long terme reste nécessaire
Les données d’une vaste étude de cohorte suédoise sont plutôt rassurantes à court terme, mais seul un suivi à très long terme pourrait permettre d’apporter une réponse tranchée à la question d’un éventuel sur-risque cardiovasculaire chez les enfants nés après assistance médicale à la procréation.
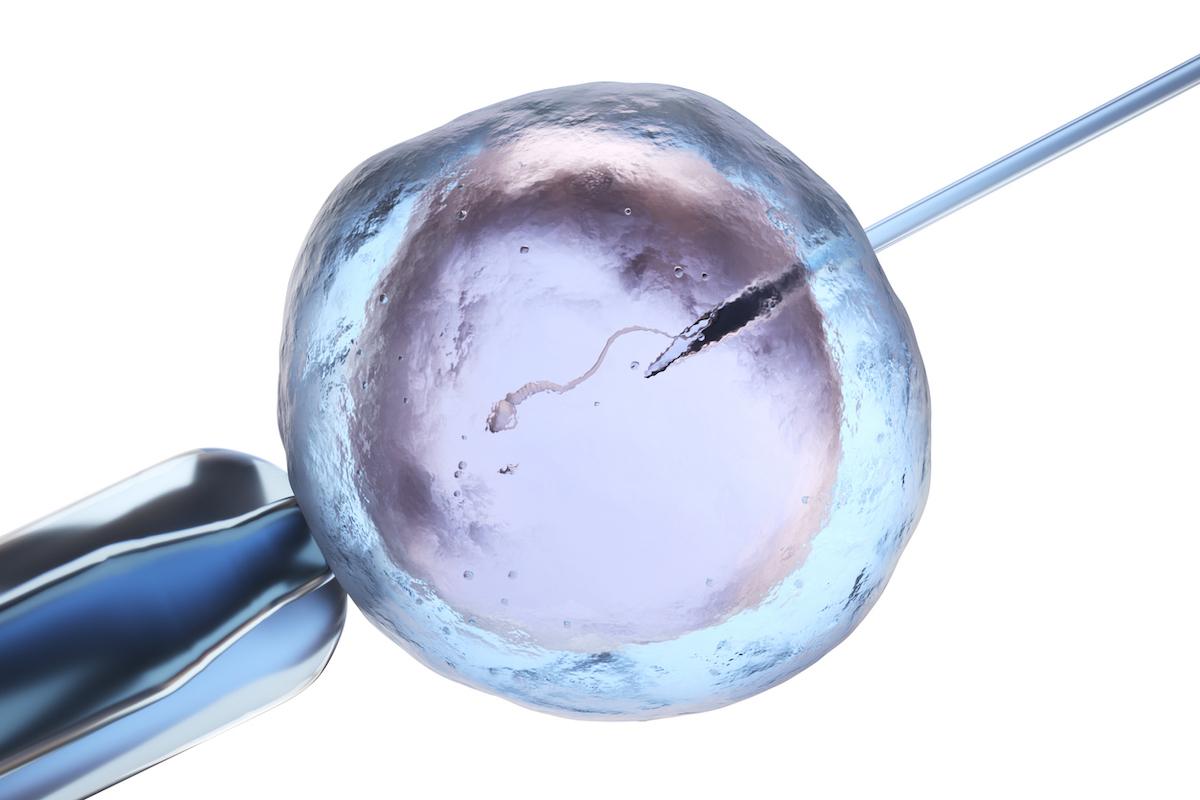
- iLexx/istock
L’impact des techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP) sur la santé ultérieure des enfants ainsi conçus suscite des interrogations depuis les premiers développements de la fécondation in vitro.
Des études antérieures, menées sur de petites cohortes, et donc sujettes à biais, ont suggéré de possibles modifications du profil de risque cardiovasculaire.
Un peu plus d’obésité
Des chercheurs suédois ont donc comparé sur une vaste cohorte l’incidence des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2 (DT2) et de l’obésité chez des enfants nés entre 1984 et 2015 après AMP (122 429 grossesses simples) et après grossesses spontanées (7 574 685 grossesses simples).
Selon ce travail, dont les résultats sont publiés dans PLOS Medicine, il n’y a pas d’augmentation du risque de maladie cardiovasculaire ni de DT2 chez les enfants nés après AMP, mais un risque un peu accru d’obésité (HR 1,14, IC à 95% 1,06-1,23, p = 0,001).
Peu d’événements
Les auteurs de ce travail ont ajusté les résultats sur l’âge maternel (33,9 ans vs 29,7 ans), la parité (45,2% de primipares vs 32,1%), le terme (7,9% de prématurité vs 4,8 %), le poids de naissance (5,7 % vs 3,3% de poids de naissance < 2500 g) et le niveau d’études.
Au total, une maladie cardiovasculaire (cardiopathie ischémique, insuffisance cardiaque ou atteinte vasculaire cérébrale) a été diagnostiquée chez 0,11% des enfants nés après AMP versus 0,14% des enfants du groupe témoin. Pour le DT2, ces chiffres ont été respectivement de 0,01% et 0,04 %, et pour l’obésité de 0,65% et de 0,74%.
Des données à interpréter avec prudence compte tenu du faible nombre d’événements, en lien avec une durée de suivi relativement courte (8,6 ans après AMP et 14 ans après grossesse spontanée). Et comme l’indiquent les auteurs dans leur conclusion, de petites différences chez des sujets jeunes peuvent avoir des conséquences importantes plus tard dans la vie.