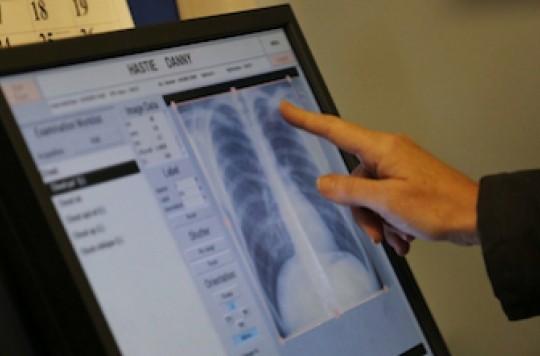Pneumologie
5% des patients avec CBNPC sous immunothérapie développent une pneumopathie interstitielle
La prévalence des pneumopathies interstitielles diffuses chez les patients présentant un cancer bronchique non à petites cellules et traités par immunothérapie est de 5%. D’après un entretien avec Nicolas Girard.

- jovanjaric/Epictura
Une étude rétrospective multicentrique, publiée dans l’European Respiratory Journal, et coordonnée par une équipe toulousaine, a évalué la toxicité pulmonaire chez des patients atteints de cancer bronchique non à petites cellules traités par immunothérapie. Elle montre une prévalence de 5% des pneumopathies interstitielles diffuses chez les patients cancéreux, traités par immunothérapie, soit 6% des cas. Ces résultats ne paraissent pas si alarmants car les patients cancéreux constituent une population à risque de toxicité pulmonaire, d’autant plus que ce sont souvent des fumeurs, quel que soit leur traitement, immmunothérapie, chimiothérapie ou inhibiteur de kinases, l’immunothérapie agissant comme réactivateur de l’immunité.
Des pneumopathies interstitielles diffuses de grades différents
Il existe différents stades de pneumopathie interstitielle diffuse liée à l’immunothérapie, allant du patient asymptomatique au patient présentant une dyspnée brutale avec hypoxémie. Le mécanisme de toxicité de l’immunothérapie est différent de celui de la chimiothérapie. Le délai d’apparition de ces pneumopathies est assez précoce et pour Nicolas Girard, institut du thorax, Curie-Montsouris, Paris, un scanner d’évaluation assez précoce, à 2 ou 3 mois, est intéressant, surtout pour faire le diagnostic différentiel avec une évolution tumorale. La radio et le lavage broncho-alvéolaire ont aussi un intérêt dans l’évaluation de cette toxicité.
L’évolution est dans la plupart des cas favorable et l’interruption de l’immunothérapie dépendra de la gravité de l’atteinte, d’autant que l’arrêt du traitement peut quand même s’associer à une poursuite de la réponse tumorale.
Essayer d’identifier les patients à risque
Selon le Professeur Girard, il est difficile d’identifier les profils à risque et plus particulièrement ceux à risque de développer une forme grave de pneumopathie interstitielle diffuse. Quel que soit le cancer (mélanome, cancer du fumeur ou autre), ce risque est peu prévisible et la surveillance de la toxicité doit rester à l’esprit des cliniciens.
En conclusion, cette étude a permis, grâce à une série importante de cas, de décrire différents modèles cliniques de pneumopathies interstitielles diffuses, d’alerter les praticiens à regarder le scanner sur l’angle tumoral , mais aussi « toxicité » pour précocement identifier les patients et adapter la prise en charge de façon optimale.