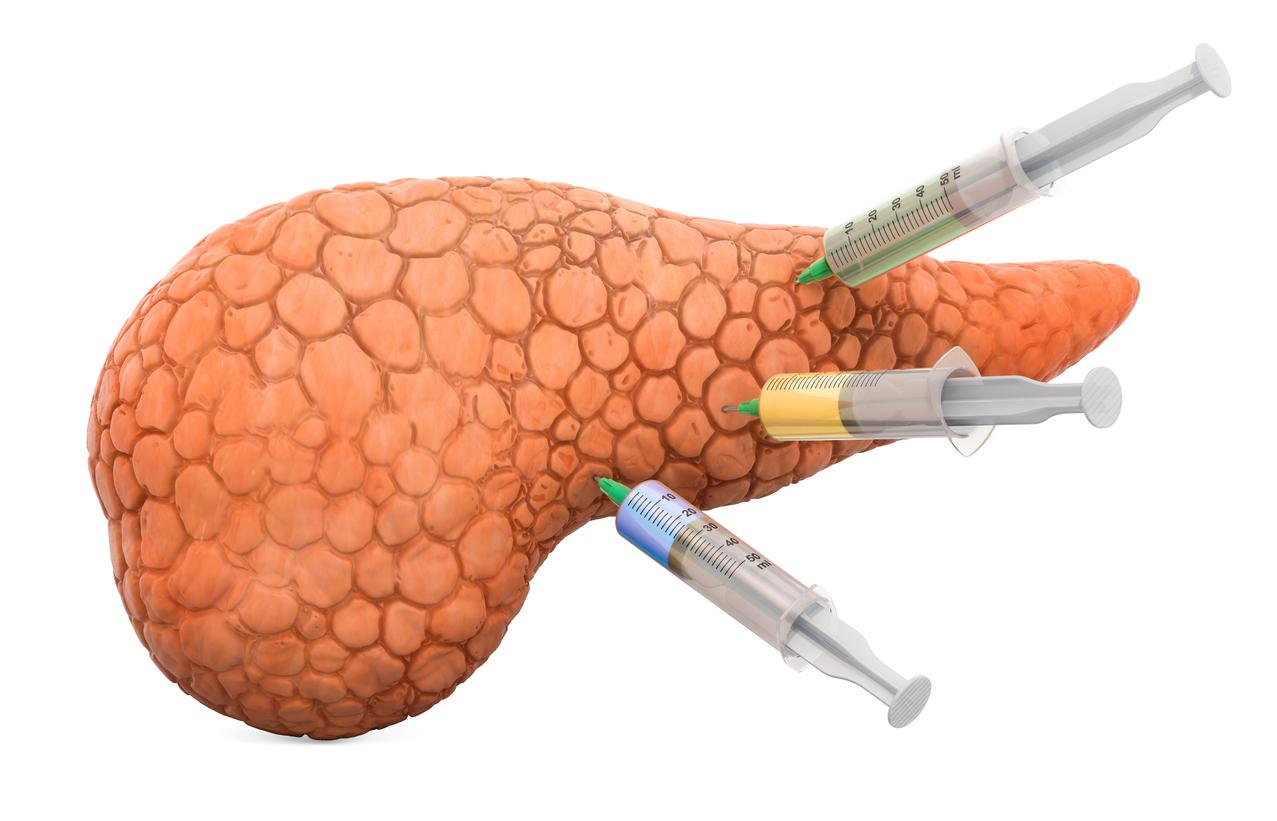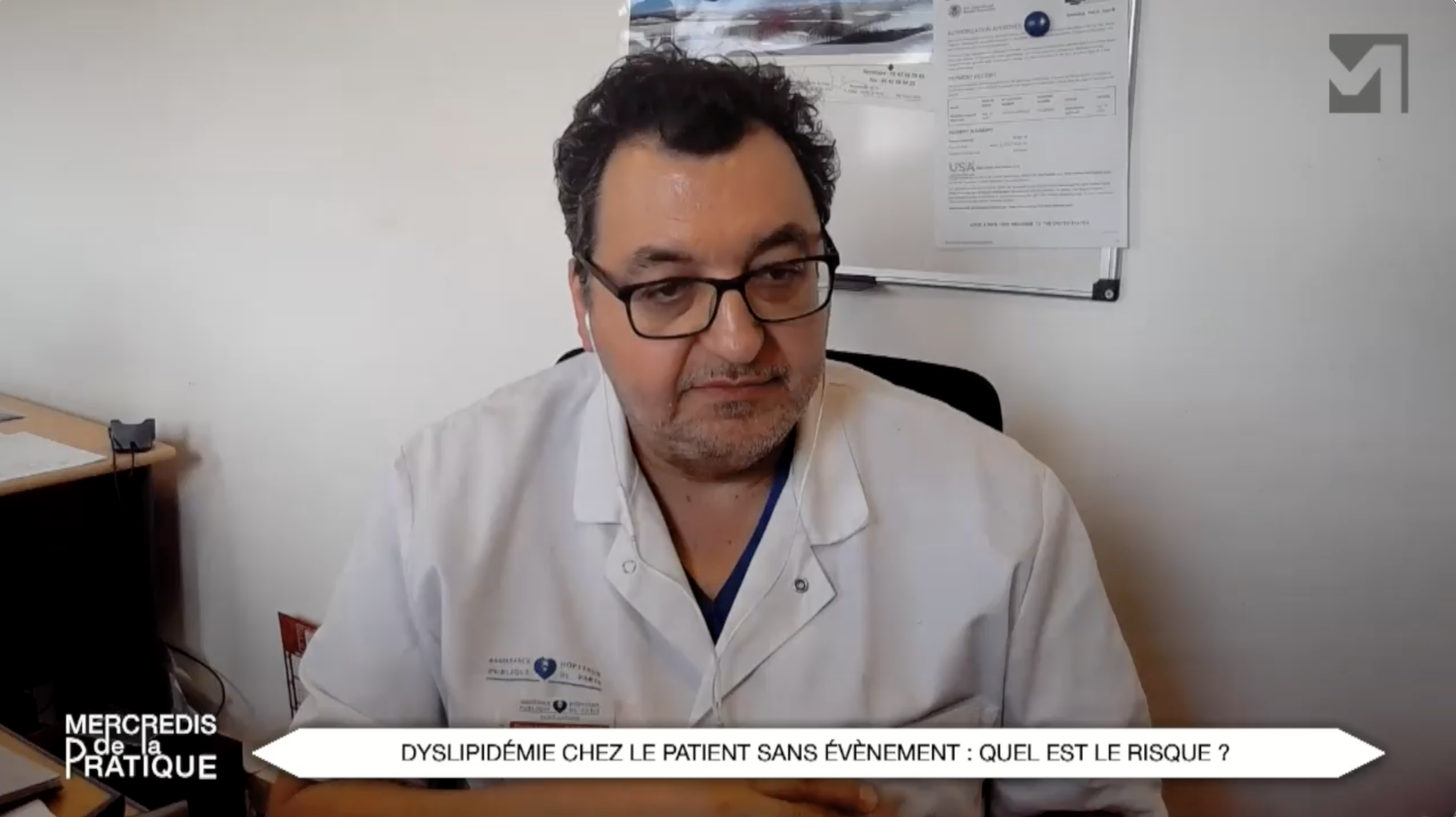Psychologie
Quand l'évitement n'est pas une faiblesse mais une recette de survie
Dans certains contextes, l'évitement permet de respecter ses ressources et de se protéger.

- Par Dr Claire Lewandowski
- Commenting
- iStock/Axel Bueckert
Si on confond parfois l’évitement avec de la peur ou un manque de courage, c'est parce que se mettre en retrait est souvent perçu comme un signe de faiblesse. Pourtant, dans certaines situations, éviter un événement, un lieu ou une interaction peut être une manière de se protéger, d’écouter ses limites et de préserver son équilibre.
L’évitement est une réaction naturelle de protection
Lorsqu’une situation déclenche un souvenir douloureux ou une forte charge émotionnelle, notre système nerveux peut enclencher un comportement d’évitement automatique. Face à une menace perçue, notre cerveau choisit la fuite ou l’inhibition non pas par faiblesse, mais pour réduire la souffrance et rétablir un sentiment de sécurité.
Si une personne ayant vécu un accident de voiture évite temporairement de conduire, cela ne signifie pas qu’elle renonce définitivement, mais qu’elle s’accorde le temps nécessaire pour récupérer dans un environnement moins stressant. De même, éviter une conversation conflictuelle peut parfois permettre de désamorcer une escalade émotionnelle et de revenir plus tard avec davantage de recul.
Quand l’évitement devient un espace de réorganisation intérieure
Prendre ses distances, limiter certaines activités ou interactions peut offrir un temps précieux pour se recentrer, clarifier ses pensées et retrouver de l’énergie. Ce recul choisi n’est pas un repli définitif, mais plutôt une phase de réorganisation intérieure.
Si une personne subit un harcèlement au travail, éviter certaines réunions ou contacts directs peut lui permettre de se protéger temporairement, d’élaborer une stratégie de sortie ou même de chercher de l’aide. L’évitement joue alors son rôle d’auto-préservation. En revanche, il peut devenir problématique lorsqu’il se rigidifie et restreint durablement la vie quotidienne, alimentant un cercle vicieux de peur.
Le rôle essentiel du soutien et de la communication
Pour que l’évitement puisse évoluer de façon constructive, il a besoin d’être compris et accompagné, et non jugé. Un regard bienveillant de l’entourage aide à réduire la culpabilité et encourage une reprise progressive de confiance. Dire à quelqu’un « je comprends que ce soit difficile pour toi » est souvent plus aidant que de le pousser à se confronter coûte que coûte.
Parler avec un proche, un thérapeute ou un groupe de soutien peut aussi aider à apprivoiser peu à peu la situation évitée, en respectant le rythme de chacun. La communication devient alors un outil de reconstruction, plutôt qu’une injonction à changer.
En savoir plus : "Le corps n'oublie rien" de Bessel A. Van der kolk.