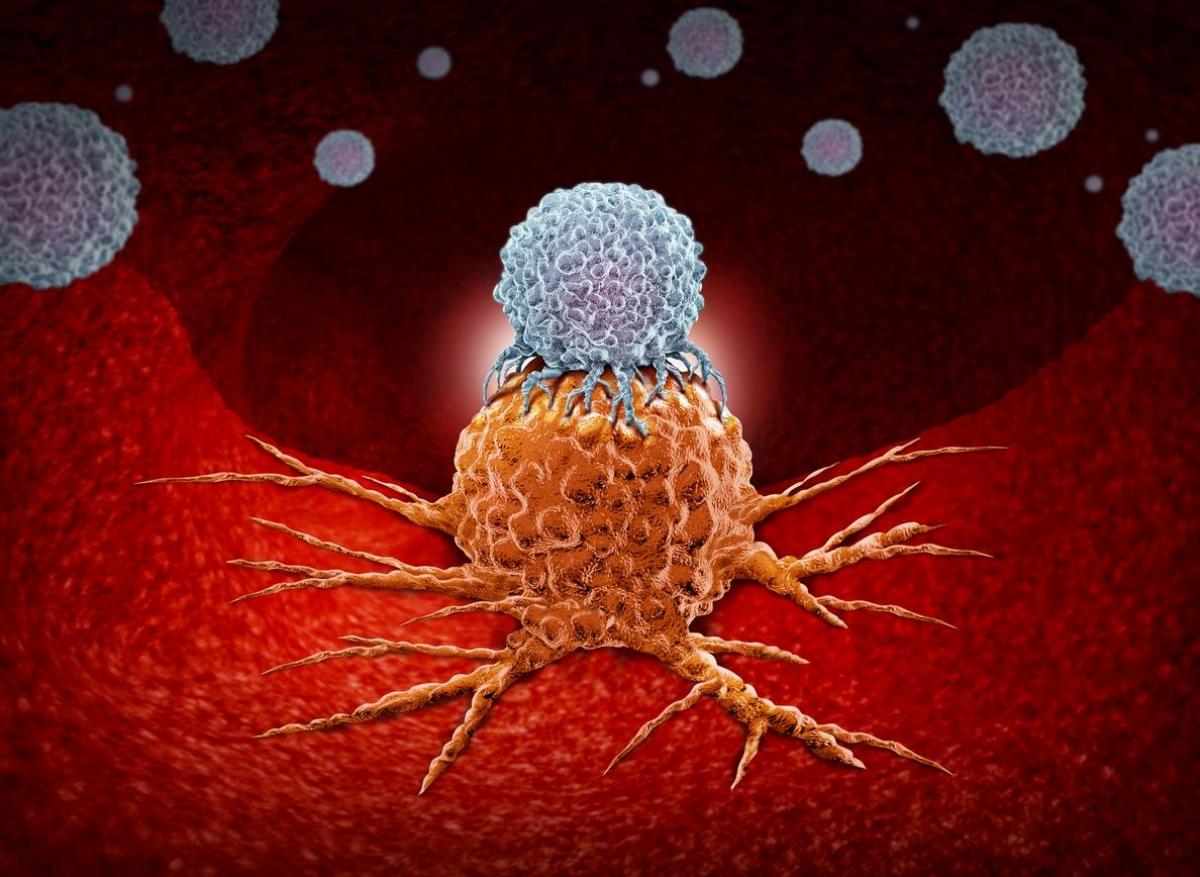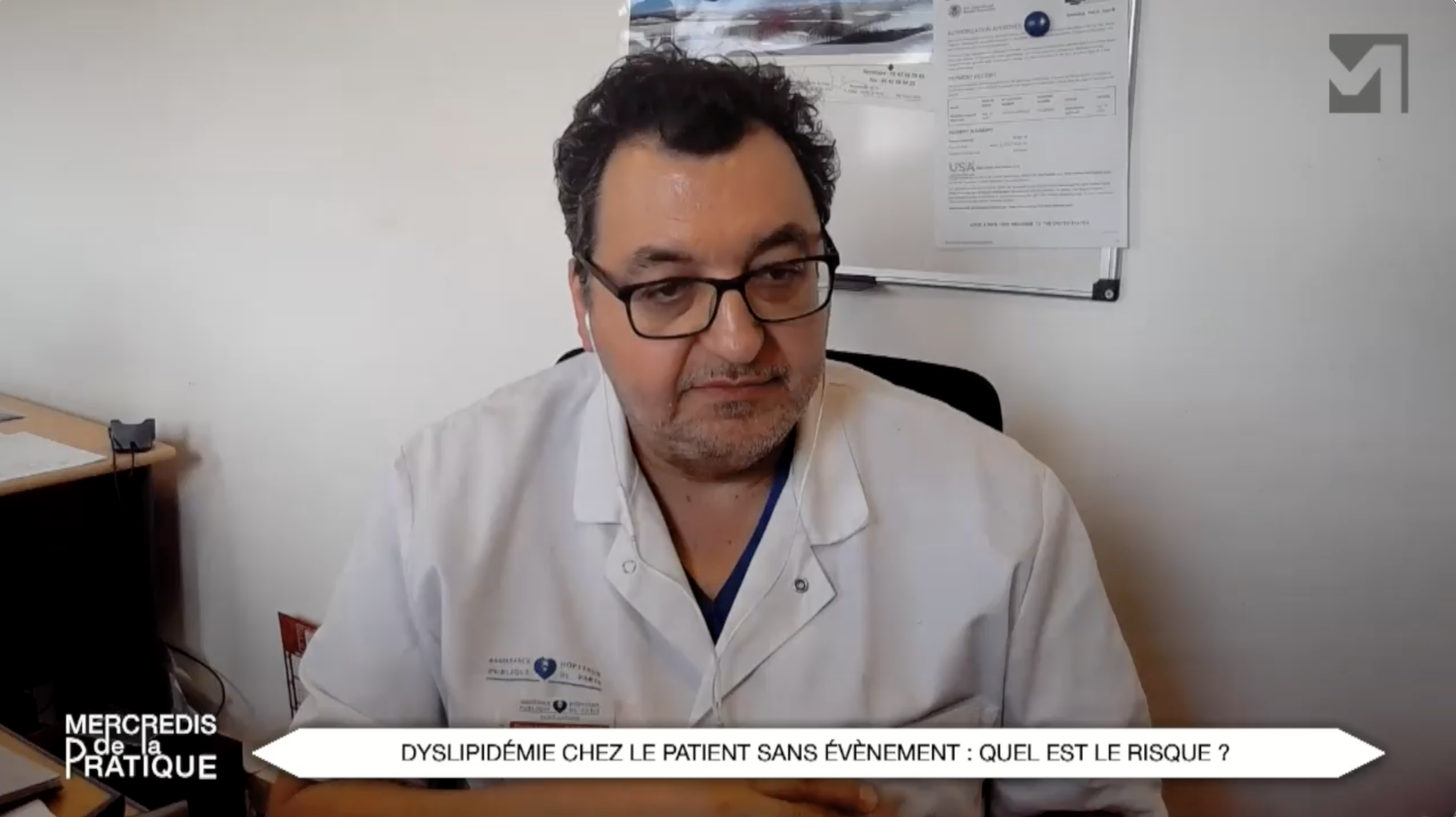Onco-digestif
Cancer du canal anal en rechute et/ou métastatique : résultats décevants pour l’Immunothérapie
Les cancers du canal anal sont des cancers rares dont les traitements de référence sont pour le moment à base de chimiothérapies. Les immunothérapies, prometteuses pour d'autres localisations tumorales sont pour le moment décevantes dans le canal anal, en combinaison en 2ème ligne. Nous présentons ici des résultats publiés à l'ESMO et à l'ASCO 2020.

- Istock/Rasi Bhadramani
Les carcinomes épidermoïdes du canal anal sont une entité rare d'évolution essentiellement locorégionale. De nombreux essais ont été réalisés afin de définir le traitement locorégional optimal, permettant d'améliorer la survie des ces patients avec préservation de l'appareil sphinctérien. Par contre, jusqu'à récemment, il y avait peu d'options thérapeutiques validées en cas de rechute ou d'évolution métastatique.
Pendant longtemps, le traitement de référence est resté l'association cisplatine-5FU. Celle-ci vient d'être détrônée en 1ère ligne par les associations paclitaxel-carboplatine ou DCF (docetaxel-cisplatine-5FU). Quelle est la place pour les nouvelles immunothérapies ?
Des résultats discordants pour l’avelumab (+/- cetuximab)
Deux inhibiteurs de PD1, le nivolumab et le pembrolizumab, ont été étudiés en 2ème ligne en monothérapie avec des résultats assez intéressants. Les taux de réponse rapportés étaient de 17 à 24% avec une survie médiane de 12 mois avec le nivolumab. Cette année ont été présentés à l'ESMO les résultats de deux essais de phase II évaluant l'efficacité d'une immunothérapie associée à une thérapie ciblée en 2ème ligne.
Dans l'essai de phase II CARACAS présenté par S. Lonardi, 30 patients ont été randomisés entre un traitement par avelumab ou par avelumab associé au cetuximab. L'objectif principal était le taux de réponse avec une hypothèse de plus de 20% dans le bras combiné. Celui-ci était de 10% avec l'avelumab seul versus 17% avec l'avelumab associé au cetuximab. La médiane de survie sans progression était de 2,05 versus 3,88 mois. Le taux de toxicité de grade 3-4 était de 47% versus 53%.
Ces résultats doivent être pris avec précaution. En effet, ils ont également été présentés en juin 2020 à l'ASCO (abstract 4051) mais avec des résultats différents. Le taux de réponse y était de 10% dans les deux bras... Les autres résultats étaient identiques.
Des développements en cours avec d’autres molécules …
Une 2ème étude était présentée à l’ESMO, un essai de phase II monobras présenté par Van Morris. Vingt patients ont reçu en 2ème ligne un traitement par atezolizumab et bevacizumab. L'objectif principal était également le taux de réponse qui était de 11%. La médiane de survie sans progression était de 4,1 mois et la survie globale de 11,6 mois. Au niveau de la tolérance, il y a eu un décès toxique par perforation intestinale et 35% de toxicités sévères.
En conclusion, l'ajout d'un inhibiteur d'EGFR ou d'un antigiogénique à une immunothérapie n'améliore pas son efficacité mais semble majorer sa toxicité. Il serait intéressant de connaître l'efficacité de l'immunothérapie en 1ère ligne, notamment dans l'essai SCARSE. Une étude plus approfondie des biomarqueurs de réponse est également nécessaire avant de poursuivre le développement des immunothérapies dans cette indication.