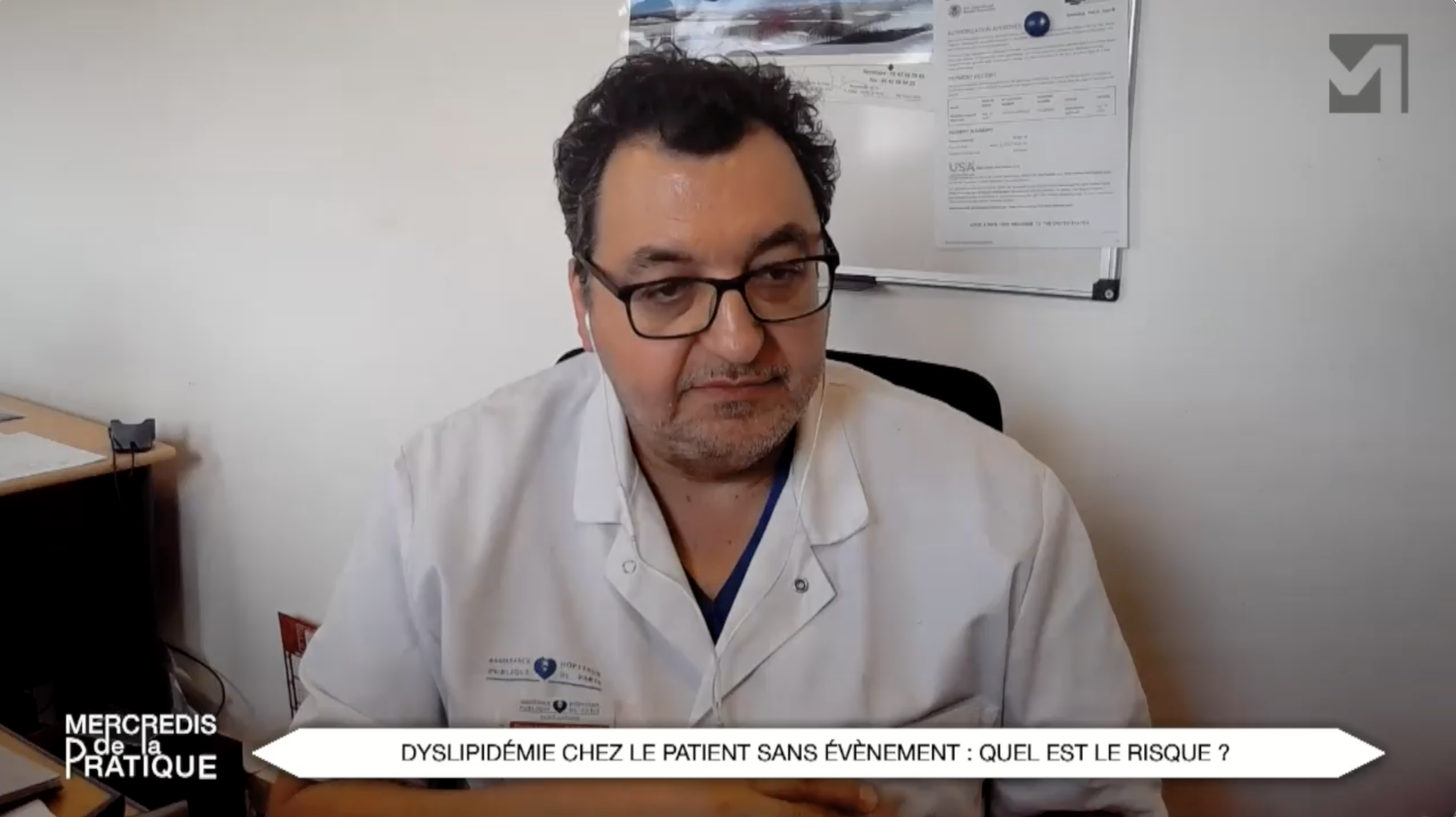Gynéco-obstétrique
Grossesse : le déclenchement à 41 semaines réduit les complications périnatales
Le déclenchement à 41 semaines d’aménorrhée réduit les complications chez le nouveau-né par rapport à la surveillance simple jusqu’à 42 semaines (avec un déclenchement ultérieur).

- gorodenkoff/istock
Chez les femmes à faible risque, déclencher le travail à 41 semaines d’aménorrhée apporte une légère réduction du nombre de complications à la naissance par rapport à attendre jusqu'à 42 semaines (approche attentiste).
Cependant, le risque absolu de problèmes graves est faible dans les deux groupes et surtout, il a fallu contacter 6 000 femmes pour que 1800 d’entre elles acceptent de participer à l’étude, avec un biais possible de sélection qui ne permet donc pas d’inciter à changer les pratiques actuelles dès maintenant. Cet article est publié dans le BMJ.
Quel est le bon terme ?
Les grossesses tardives (à 42 semaines d’aménorrhées ou plus selon l’OMS) concernent environ 10 à 15% des femmes et sont associées à une augmentation des problèmes périnataux, y compris le décès du nouveau-né. Bien que la très grande majorité des accouchements se passent bien entre 40 et 42 semaines d’aménorrhée, il existe une augmentation statistique graduelle des problèmes entre ces 2 termes.
Certaines études suggèrent que le déclenchement du travail à partir de 41 semaines d’aménorrhée améliorerait les résultats, pour la mère comme pour le bébé, mais ces études sont hétérogènes en termes de critères, de protocoles et de délais de comparaison et les résultats doivent donc être interprétés avec prudence. Malgré cela, le déclenchement à 41 semaines est maintenant une politique en vigueur dans de certains pays développés comme le Danemark.
Une étude randomisée
Une équipe de chercheur de l’Université UMC d’Amsterdam, ont donc voulu comparer le déclenchement du travail à 41 semaines d’aménorrhée versus l’attitude naturelle « attentiste » jusqu’à 42 semaines lors de grossesses à faible risque.
L’étude a été menée auprès de 1 800 femmes (principalement de race blanche) âgées de moins de 35 ans et ayant déjà eu une grossesse sans complication aux Pays-Bas.
Les femmes ont été tirées au sort entre soit un déclenchement à 41 semaines d’aménorrhée (SA) ou une simple surveillance jusqu'à 42 SA (avec une déclenchement ultérieur si nécessaire). Les résultats périnataux défavorables ont été évalués en utilisant une mesure combinée de la santé du nouveau-né (comprenant la mort périnatale, le score Apgar cinq minutes après la naissance inférieur à 7 et l'admission dans une unité de soins intensifs pour bébés). Les autres résultats incluaient le type d'accouchement et la santé de la mère juste après l'accouchement.
Des résultats comparables
Quinze femmes (1,7%) du groupe déclenchement à 41 SA ont eu des résultats périnataux défavorables, contre 28 (3,1%) du groupe surveillance jusqu’à 42 SA, un écart de risque absolu de 1,4% en faveur du groupe déclenchement à 41 SA (et une réduction de 45% en risque relatif).
Onze nourrissons (1,2%) du groupe déclenchement à 41 semaine d’aménorrhée et 23 (2,6%) du groupe attentiste ont eu un score d'Apgar à cinq minutes inférieur à 7 sur 10. Aucun nouveau-né du groupe déclenchement à 41 SA et trois (0,3%) dans le groupe surveillance jusqu’à 42 SA n'ont eu un score de Apgar à cinq minutes inférieur à 4 sur 10.
Un décès fœtal (0,1%) est survenu dans le groupe déclenchement à 41 SA et deux (0,2%) dans le groupe attentiste. Aucun décès néonatal (décès au cours des 28 premiers jours de la vie) n’a été observé.
Trois nourrissons (0,3%) du groupe déclenchement à 41 SA contre 8 (0,9%) du groupe attentiste ont été admis dans une unité de soins intensifs pour bébés.
Aucune différence significative en termes de complications chez la mère ou de taux de césarienne n'a été trouvée entre les groupes.
Des limites potentielles
Dans cet essai randomisé de grande taille (1 800 femmes), le déclenchement du travail à 41 semaines d’aménorrhée entraîne une réduction des problèmes périnataux pour le nouveau-né par rapport à l’approche attentiste jusqu’à 42 SA, mais la différence de risque absolu est faible dans les deux groupes (1,4%).
Surtout, l’étude a été réalisée aux Pays-Bas où la société, les sages-femmes et les médecins sont très « pro-natures » : il a donc été difficile pour les chercheurs de recruter des femmes acceptant de se soumettre à cette étude avec un déclenchement possible à 41 semaines d’aménorrhée. Près de 6 000 femmes ont été approchées pour en recruter 1800, ce qui a pu induire un biais de sélection de femmes enceintes en particulière bonne santé.
En pratique
Comme pour toute interférence dans un processus naturel comme la naissance, la décision d'induire le travail doit être prise avec prudence, car les avantages escomptés doivent l'emporter sur les éventuels effets néfastes pour la mère et l'enfant.
Selon les auteurs de l’étude, ces résultats « devraient être utilisés pour informer les femmes qui approchent de 41 semaines d’aménorrhée, afin de pouvoir peser le pour et le contre et décider s'il faut ou non un déclenchement à 41 semaines ou attendre jusqu'à 42 semaines ».
Un choix qui peut être critique dans certaines régions isolées et en hiver : il peut être préférable de « programmer la naissance » à 41 semaines d’aménorrhée plutôt que de partir en catastrophe et dans de mauvaises conditions météorologiques pour accoucher à plus de 50 km de son domicile… En dehors de ces cas théoriquement minoritaires, les experts conseillent d’attendre les résultats de l’étude SWEPIS pour conclure définitivement.