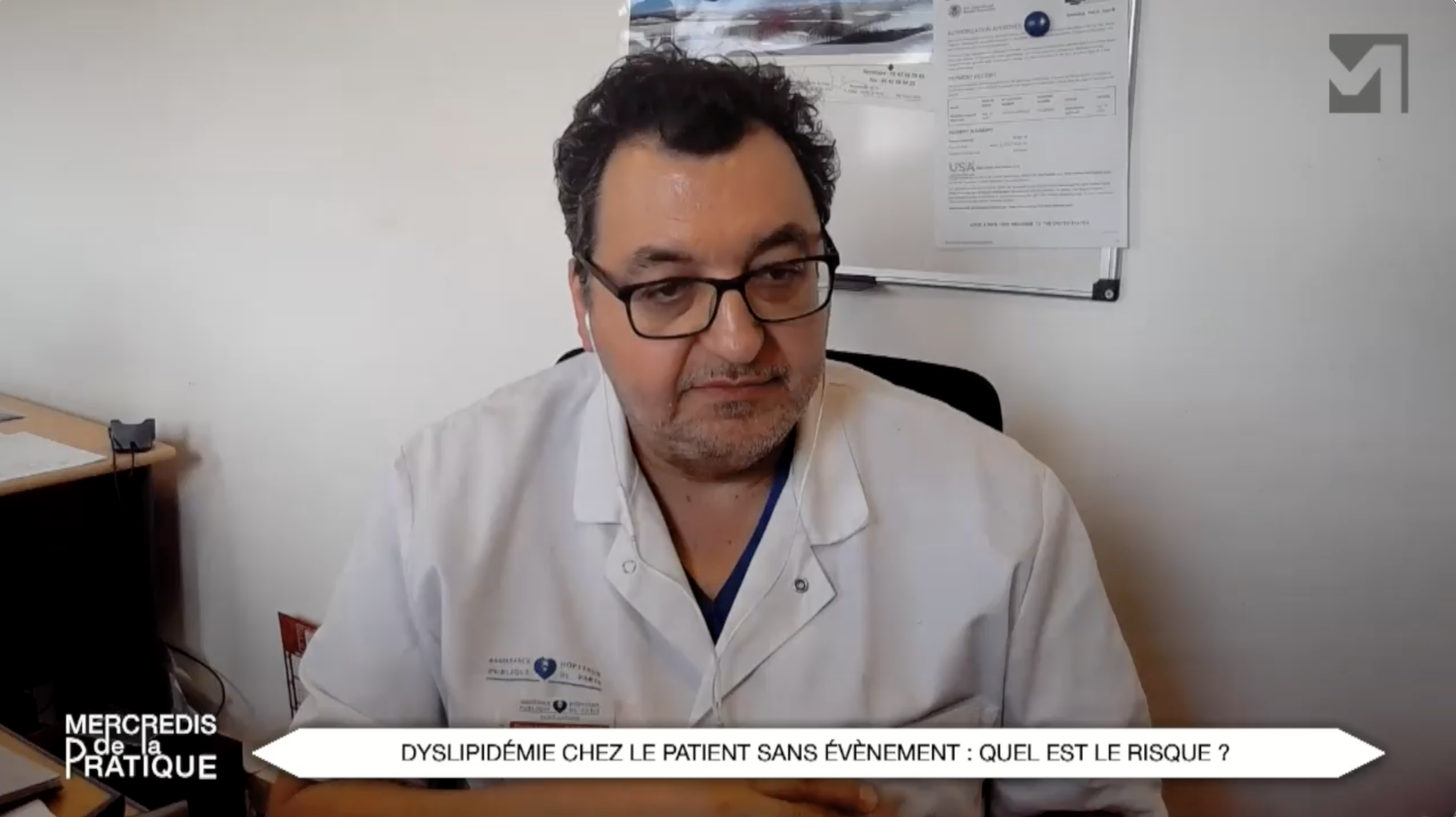Oncologie
Cancers du sein post-ménopausiques : 53% pourraient être évités

- DURAND FLORENCE/SIPA
Après la ménopause, plus de la moitié des cancers du sein seraient attribuables à des facteurs comportementaux, ce qui signifie que la modification de ces comportements permettrait de réduire considérablement le nombre de cancers du sein. Rappelons que le cancer du sein est le plus fréquent des cancers féminins : une femme sur 9 est, ou sera, concernée par cette pathologie. Mais cette conclusion d’une étude INSERM sur près de 70 000 femmes, âgées de 42 à 72 ans, suivies pendant 15 ans, n’est pas applicable pour les cancers survenant avant la ménopause.
Ces résultats sont issus de l’étude E3N, mise en place en 1990, qui se base sur une cohorte de femmes adhérentes de la MGEN, donc principalement des enseignantes. Cette étude est déjà bien connue pour avoir mis en évidence les relations entre le THS et le risque de cancer du sein. A noter que les informations fournies par les femmes sont validées par la récupération des comptes rendus anatomopathologiques des cancers déclarés, ce qui permet de les authentifier.
Durant les 15 ans de suivi de cette population, 15 000 cas de cancer ont été enregistrés dont la moitié environ de cancer du sein. Il ressort, qu’avant la ménopause, 61,2% des cancers sont attribuables à des facteurs de risque non comportementaux, et seulement 39,9% sont liés au comportement. Par contre c’est l’inverse après la ménopause, où environ 40% des cancers sont liés à des facteurs non comportementaux et 53,5 % à des facteurs comportementaux.
Facteurs évitables
Parmi les facteurs comportementaux évitables, il faut citer en premier le traitement hormonal substitutif. Il est considéré comme facteur comportemental dans la mesure où on peut choisir ou pas de le prendre. Dans cette étude, 14,5% des cancers du sein survenant après la ménopause serait lié à la prise de THS. Des chiffres qui vont sans doute évoluer, le nombre de prescriptions de THS ayant diminué et le type de médicaments ayant changé depuis plusieurs années.
Autres facteurs de risque bien connus, et chiffrés dans cette étude, l’alimentation. Deux profils alimentaires ont été identifiés : l’alimentation dite méditerranéenne , riche en fruits, légumes , huile d’olive, etc… et l’alimentation occidentale riche en aliments industriels, transformés. Pour Françoise CLAVEL-CHAPELON, épidémiologiste, directeur de recherche INSERM à l’Institut Gustave Roussy de Villejuif, 10 % des cancers du sein post ménopausiques pourraient être évités par une alimentation méditerranéenne, de même que 5,6% serait évités si les femmes ne dépassaient pas un verre d’alcool par jour.

Mince à la puberté, risque augmenté !
Souvent mis en cause comme facteur de risque de cancer du sein, le surpoids. A ce point de vue, les résultats de l’étude E3N sont assez étonnants, tout au moins pour le poids à la puberté. En effet, les femmes qui étaient minces à la puberté semblent plus à risque de cancer du sein que les plus corpulentes à cet âge-là ; et la différence est importante : 15,1% des cancers du sein survenant après la ménopause, seraient attribuables au fait d’être mince à la puberté !
Un constat assez paradoxal, car les jeunes-filles en surpoids font des pubertés plus précoces et la puberté précoce est reconnue pour être un facteur de risque de cancer du sein. Mais les auteurs, qui ont dans une autre étude déjà observé ce paradoxe, n’ont pas trouvé d’explication. Par contre, et c’est plus classique, l’étude confirme que le surpoids à l‘âge adulte est un facteur de risque de cancer du sein post- ménopausique : 5,1% d’entre eux serait lié à un IMC > à 25 à l’âge adulte.
En conclusion, pour Françoise CLAVEL-CHAPELON, s’il est plus difficile avant la ménopause de prévenir des cancers du sein pour lesquels on n’a pas identifié de facteurs comportementaux qui jouent, c’est beaucoup plus aisé après la ménopause. Donc il semble particulièrement intéressant de mener des études de sciences humaines et sociales qui permettraient de trouver des leviers pour modifier les comportements.