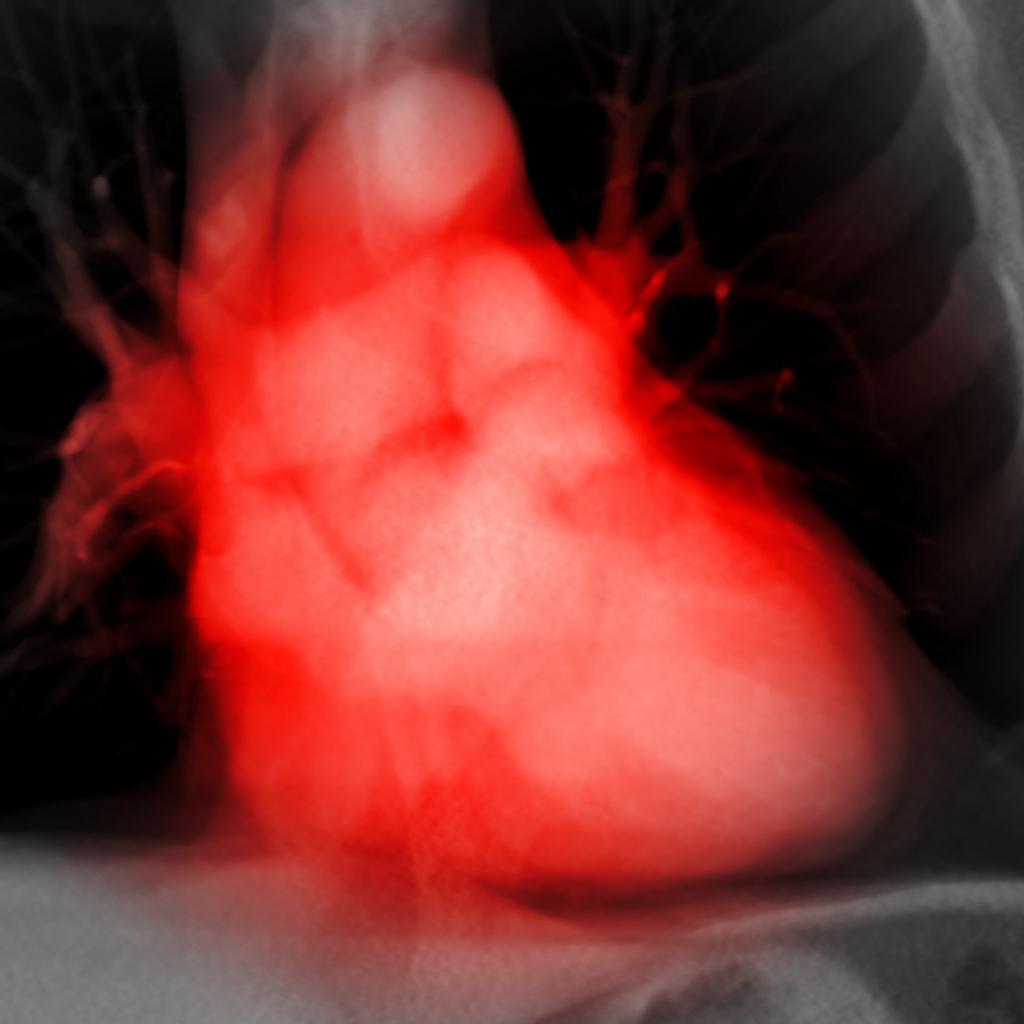L'interview du week-end
On ne peut pas avoir de trouble sexuel sans raison, c’est un baromètre de la santé
Manque de communication, poids des injonctions, tabous... Dans son dernier ouvrage, le docteur Gilbert Bou Jaoudé, sexologue, décrypte les causes profondes des troubles sexuels et propose des clés pour mieux vivre et exprimer sa sexualité, qui constitue un "formidable signal d’alerte" pour la santé globale.

- Par Stanislas Deve
- Commenting
- torwai / istock
- Pourquoi Docteur : Votre ouvrage s’intitule Amour et sexualité, c’est pas si compliqué (éd. Solar). Cela ne semble tout de même pas si simple, puisque vous en avez fait un livre de 368 pages...
Dr Gilbert Bou Jaoudé : Tout est dans le "si" ! Ce n’est "si" compliqué dès lors que l’on a les bonnes clés. Et c'est précisément l'objectif de ce livre : fournir des repères, expliquer les enjeux, rassurer, permettre aux lecteurs de mieux comprendre ce qui se passe dans leur tête, leur corps, leur couple. Donner des clés, pour aider à comprendre et à mieux vivre sa sexualité.
- Pourquoi, selon vous, la sexualité reste-t-elle un sujet si tabou, même à une époque où l’on parle de plus en plus facilement de sexe ?
On parle plus librement de sexe aujourd’hui, mais surtout sous l'angle du plaisir, de la performance ou du divertissement. Certains sujets sont moins tabous, comme l’homosexualité ou les troubles liés à la ménopause, mais parler de ses difficultés sexuelles reste très compliqué. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : seules 25 à 30 % des personnes qui rencontrent un problème sexuel consultent. Les deux tiers restants gardent le silence, alors même qu'ils aimeraient une aide – par honte, par peur du diagnostic, par incertitude sur le bon interlocuteur... On aurait pu penser que l’arrivée du Viagra allait changer les choses, en mettant davantage en lumière la médecine sexuelle. Mais non : la proportion de personnes consultant pour un trouble sexuel n'a pas bougé. Ce n’est donc pas une question d'accès aux traitements, mais de regard sociétal.
"La sexualité est un formidable signal d'alerte"
Et puis, il y a le problème médical : les patients ne savent pas toujours s’ils peuvent en parler à leur médecin. Dans les enquêtes, une réponse revient souvent : "J'avais peur de gêner mon médecin". Ce n’est pas un reproche aux soignants, mais un constat : la sexualité est rarement abordée de façon proactive. On interroge systématiquement sur la fièvre, le sommeil, les douleurs... mais jamais sur la vie sexuelle. Résultat, les patients hésitent. Et du côté des médecins, très peu ont reçu une formation dédiée à la médecine sexuelle. On compte souvent moins de quatre heures de formation sur tout le cursus médical. Certains médecins se sentent donc démunis, pensent que ce n'est pas de leur ressort, ou craignent de ne pas savoir réagir. Et c’est dommage, car la sexualité est un formidable signal d’alerte. Des troubles sexuels peuvent révéler des pathologies sous-jacentes, parfois graves : apnée du sommeil, syndrome métabolique, dépression, déficit en testostérone, voire insuffisance coronarienne. Une dysfonction érectile est parfois le premier symptôme d’une pathologie cardiovasculaire.
"Le délai moyen entre les premières difficultés sexuelles et la recherche d'aide est de trois ans"
- Au sein du couple, quelles sont les conséquences d’un manque de communication sexuelle ?
Elles sont multiples. Le délai moyen entre les premières difficultés sexuelles et la recherche d'aide est de trois ans. Pendant ce temps, des cercles vicieux s'installent : perte de confiance, anxiété, isolement affectif... J'ai rencontré des personnes restées plusieurs années sans relation intime, par peur d'un échec sexuel. Et cela ne concerne pas que la sexualité : cela affecte la qualité de vie, lien affectif, la complicité, l'image de soi. Dans le couple, ce silence crée des malentendus. Par exemple, un homme confronté à des troubles de l’érection peut craindre de décevoir, éviter les rapports, ce qui inquiète sa partenaire qui se demande s’il ne l'aime plus, s’il a quelqu’un d’autre... Inversement, une femme très fatiguée, proche du burn-out, n’a pas de désir, mais n’ose pas le dire. Et son conjoint se sent rejeté. On finit par s’éloigner, alors qu’une simple phrase suffirait : "J’ai une difficulté, je vais chercher de l'aide."
- Vous évoquez un "palmarès des troubles sexuels". Quels sont les problèmes les plus fréquents que vous rencontrez en consultation ?
Chez les hommes, les deux "champions" restent les troubles de l’érection et l’éjaculation précoce. Suivent la baisse de libido (de plus en plus fréquente chez les moins de 40 ans), les troubles de l'orgasme et les complexes physiques, notamment autour de la taille du pénis. Chez les femmes, la baisse de libido est aussi en tête, suivie des troubles de l’excitation, des orgasmes inexistants ou difficiles, et des douleurs à la pénétration.
- Quelles en sont les causes les plus fréquentes ?
La première, c'est le rythme de vie actuel, qui favorise la fatigue et la charge mentales, le stress, la pression professionnelle, familiale. Nous sommes épuisés, hyperconnectés, sursollicités. Le deuxième facteur, c'est le mode de vie : obésité, sédentarité, alimentation industrielle... Le troisième : les maladies chroniques (diabète, hypertension artérielle...). Enfin, il y a des causes psychologiques, notamment l’angoisse de performance, très présente chez les jeunes et chez les plus de 50 ans nouvellement en couple.
- Comment expliquez-vous la hausse des troubles sexuels sévères chez les jeunes de 18 à 25 ans ?
C'est une réalité très nouvelle. Aujourd’hui, les jeunes de 18-25 ans ont plus de troubles sexuels que les 25-50 ans. Plusieurs causes : la sexualité découverte via le porno, la pression des réseaux sociaux, les injonctions de performance, mais aussi des facteurs biologiques. La qualité du sperme diminue, tout comme le niveau de testostérone moyen. Les perturbateurs endocriniens, les microplastiques et l’alimentation ultra-transformée, bourrée d’additifs chimiques, jouent probablement un rôle. Et les troubles sexuels de ces jeunes sont souvent plus sévères de nos jours qu’il y a 30 ans.
"En changeant ses habitudes de vie, un tiers des patients n’avaient plus aucun trouble sexuel six mois plus tard"
- Quel est l'impact de la pornographie ?
D'abord, quand on s'habitue à être excité uniquement par la stimulation visuelle, on peut perdre l'habitude d'être excité par le contact, les baisers, le jeu de séduction. On perd l’habitude d'utiliser son imaginaire sexuel. Le cerveau ne sait plus trop comment réagir à une situation réelle. Deuxièmement, cela peut modifier la sensibilité de la zone génitale : la masturbation, fréquente devant du porno, crée des sensations particulières qui ne sont pas les mêmes que lors d’un rapport. Et troisièmement, chez ceux qui ont un petit doute sur eux-mêmes, une petite anxiété ou un manque de confiance, cela peut créer un cercle vicieux. Ils se rendent compte que devant du porno, c'est plus simple, et ils peuvent donc perdre l'envie d'avoir des rapports réels. Mais je ne diabolise pas le porno : tout dépend de l’usage. Certains couples l'utilisent ensemble, comme un support. Le risque vient de l'exclusivité ou de l'addiction au porno.
- Quel rôle joue notre hygiène de vie (sommeil, stress, alimentation, drogues…) dans notre santé sexuelle ?
Le sommeil, d'abord. Pendant les phases de sommeil paradoxal, on a des érections du pénis ou du clitoris. Ce n'est pas un hasard, ces érections nocturnes ont un rôle physiologique. Si l’on dort mal ou pas assez, il y aura donc une conséquence mécanique directe. Ensuite, la nutrition. Une alimentation industrielle ou déséquilibrée favorise l'inflammation chronique. Cela agit sur les micro-artères, donc sur la circulation sanguine dans les organes génitaux. Et sur le moral aussi. L'activité physique a également un impact très positif, c’est prouvé. Chez les hommes, la combinaison de cardio et de renforcement musculaire a les effets les plus positifs ; chez les femmes, ce sont plutôt des sports comme le Pilates ou le yoga, qui sollicitent le périnée. Mais au fond, toute activité physique est bonne. Et bien sûr, le tabac, l’alcool, le cannabis qui, au-delà d'un certain seuil, ont tous un impact négatif. Une étude a montré qu’en changeant ses habitudes de vie, un tiers des patients n’avaient plus aucun trouble sexuel six mois plus tard. Un autre tiers avait vu une nette amélioration.
- Vous dites que la sexualité est un bon indicateur de notre état de santé global. Pouvez-vous détailler ?
On ne peut pas avoir de trouble sexuel sans raison. Quand quelqu'un a une douleur à la pénétration, une difficulté d'érection, une absence de désir, il y a toujours une explication – d’ordre psychologique, relationnel, biologique. Cela peut être un mélange de tout cela. Parfois, le trouble sexuel est la première alerte : il permet de détecter un burn-out, une dépression, un dérèglement hormonal qui n'avait pas encore été identifié. Je dis même à mes patients que c'est une chance. Comme la fatigue ou la perte d’appétit, le trouble sexuel est un signal avant-coureur, un baromètre.
- Les jeunes font aujourd’hui moins l’amour qu’il y a 30 ans. Moins de rapports sexuels dans un couple signifie-t-il nécessairement qu’il y a un problème ?
Pas du tout, si les deux partenaires le vivent bien. Ce n'est pas la fréquence qui compte, mais la raison du manque de fréquence. S'il y a tension, frustration ou silence, c’est problématique. Mais si c’est un moment de vie où le couple est d'accord sur un rythme plus calme, il n'y a aucun souci. Certains couples font l'amour une fois par semaine et s’en portent très bien. D'autres le font tous les jours, mais ne sont pas satisfaits sexuellement. La fréquence est un indicateur, pas un objectif.
"Sous prétexte de libération sexuelle, on a créé d'autres pressions"
- À force de vouloir coller à une norme imaginaire de fréquence ou de performance, risque-t-on de nuire à sa propre sexualité ?
Bien sûr. Il y a 20-30 ans, le principal problème était le manque d'information autour de la sexualité. Aujourd'hui, c'est l'excès d’informations. Il y a trop d'injonctions. Avant, on disait "une femme ou un homme bien ne fait pas ci". Aujourd'hui, c'est "si tu n'as pas tout essayé, tu es nul ou coincé". Sous prétexte de libération sexuelle, on a créé d'autres pressions. Et beaucoup se sentent en échec, comme s'ils devaient atteindre un standard imaginaire de performance ou de fréquence.
- Quels conseils donnez-vous aux couples qui souhaitent raviver leur désir mais ne savent pas par où commencer ?
D'abord, ne pas commencer par le sexe : il faut restaurer la complicité, la séduction, le plaisir d'être ensemble, en dehors du sexe. Ensuite, il faut verbaliser : "Ça te dirait qu'on passe plus de temps de qualité à deux, y compris sexuellement ?" Rien que de se le dire, cela change tout. Mais si l'autre répond : "Je ne sais pas", ce n'est pas le moment de raviver la flamme, c'est qu'il faut d'abord régler autre chose. Avant d'allumer des bougies dans le bain ou d’acheter des vibromasseurs, il faut que les deux soient prêts ! Pour la séduction, un conseil simple : se demander, en regardant son partenaire, "si c'était une des premières fois qu'on se voyait, qu’est-ce que je ferais différemment ?" Parfois, cela suffit à relancer le désir.