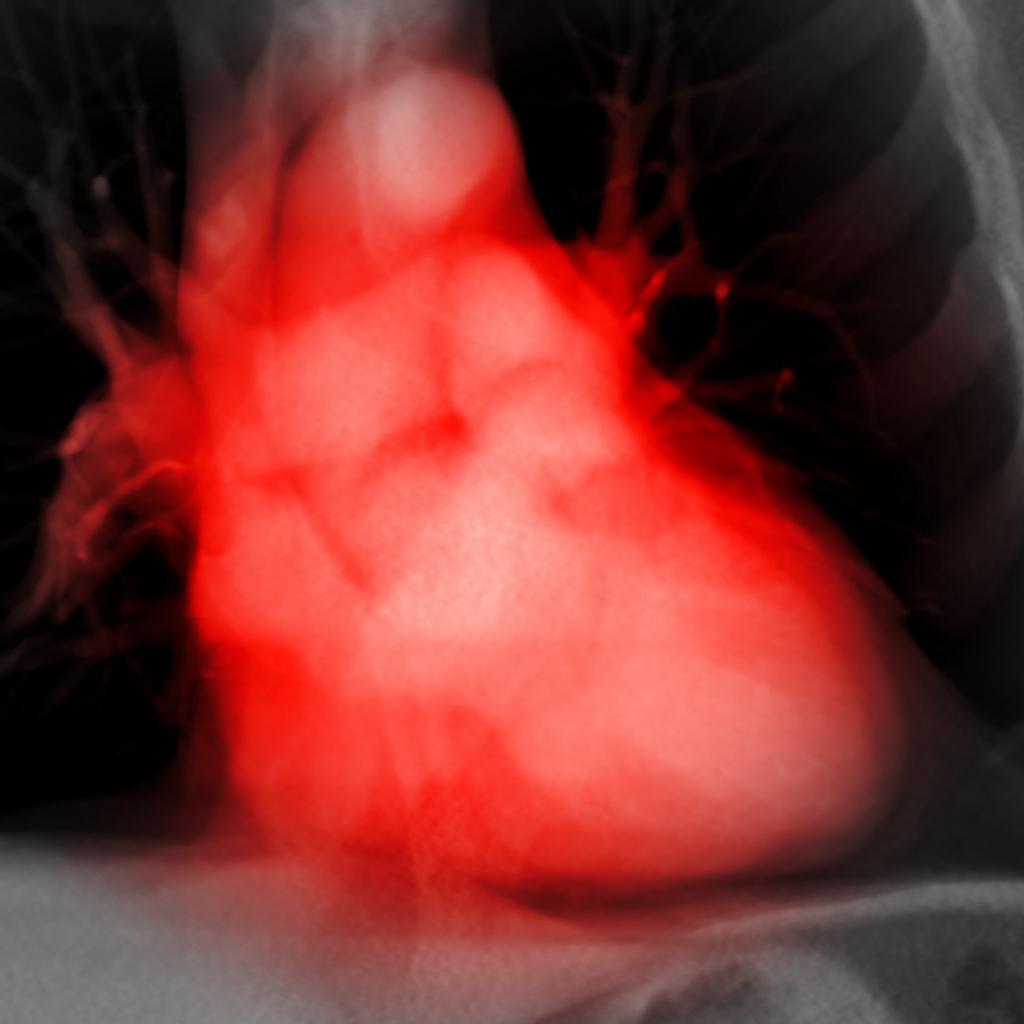Antibiorésistance
La médecine amérindienne pourrait aider à lutter contre les superbactéries
Selon une nouvelle étude, les extraits de plantes de la province canadienne Saskatchewan, comme le pissenlit, la bergamote et la gaillarde, peuvent aider à arrêter le développement des infections liées aux superbactéries résistantes.

- Par Sophie Raffin
- Commenting
- Stephen Viszlai/istock
En 2019, on déplorait 1,27 million de décès dans le monde résultaient de la résistance des superbactéries aux antibiotiques et 4,95 millions y étaient associés. L'antibiorésistance devient ainsi une problématique de plus en plus inquiétante, et les solutions restent assez limitées.
Face au manque de nouveaux antibiotiques en développement, des scientifiques de l'université de Regina et de l'université des Premières Nations du Canada ont eu l’idée de se tourner vers le savoir traditionnel des peuples autochtones canadiens. Dans un article paru dans la revue Microbiology Spectrum cet été, ils révèlent que plusieurs plantes médicinales utilisées par les premiers habitants des plaines de la Saskatchewan sont efficaces contre le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM).
Antibiorésistance : plusieurs plantes de la médecine amérindienne sont efficaces contre les infections
En collaboration avec les anciens et membres des peuples autochtones de la province de Saskatchewan, les chercheurs ont collecté les plantes présentes dans les plaines de cette région qui sont des ingrédients des remèdes traditionnels. Elles ont ensuite été testées en laboratoire dans des conditions reproduisant fidèlement une infection à Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM).
Les données montrent que des extraits de plantes – comme la bergamote, l’oseille, la gaillarde et le pissenlit – inhibaient la croissance du SARM. D'autres, comme les grindélias, contribuaient à décomposer les biofilms bactériens. C’est-à-dire les couches protectrices qui rendent les infections difficiles à traiter.
"Ces plantes sont utilisées par les peuples autochtones depuis des milliers d'années pour traiter des maladies graves et d'autres affections. Ce qui peut être choquant, c'est que ces informations sont souvent nouvelles pour d'autres membres de la communauté scientifique. Nous espérons que nos recherches – et la façon dont nous les avons menées – aideront les scientifiques conventionnels à commencer à travailler avec les gardiens de connaissances autochtones, les scientifiques et les communautés d'une bonne manière", souligne le Dr. Vincent Ziffle, professeur adjoint de connaissances et de sciences autochtones à l'Université des Premières Nations du Canada.Plantes médicinales : un travail conjoint avec les experts autochtones
Dans leur présentation, les auteurs soulignent que leur projet et sa réussite doivent beaucoup à l’approche choisie pour cette étude. Contrairement à de nombreux travaux précédents où les peuples autochtones n'étaient impliqués qu'en tant que participants. Celle-ci a été codirigée et coécrite par des scientifiques autochtones et non autochtones, “établissant ainsi une nouvelle référence en matière de partenariats de recherche respectueux et réciproques”.“Malheureusement, trois aînés ayant collaboré à ce travail sont décédés avant la publication de notre article. Nous leur sommes profondément reconnaissants de nous avoir confié leur savoir traditionnel et leurs plantes médicinales. Cette étude est une façon de rendre hommage à leurs contributions et de perpétuer leur héritage et leur sagesse”, précise Dr Omar El-Halfawy qui a dirigé la recherche dans un communiqué.
Florence Allen, une des ainées qui a participé à l’étude, ajoute : "Les plantes vous parlent ; il suffit de les écouter. Nous avons toujours nos remèdes sur nous. Une fois que vous l'avez appris, vous le savez toujours.”