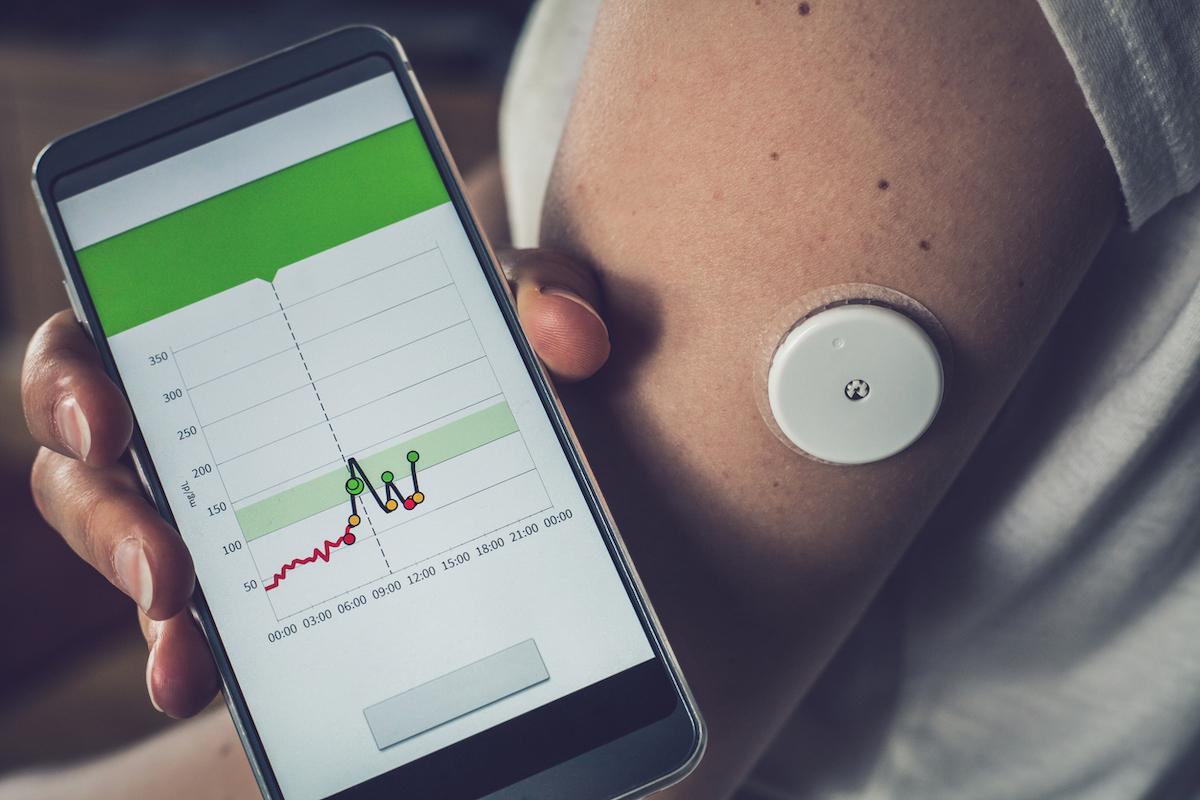Diabétologie
Obésité : le tirzepatide surclasse le sémaglutide sur la perte de poids et de tour de taille
Chez l’adulte obèse sans diabète, le double‑agonisme GIP/GLP‑1 du tirzépatide aboutit une perte pondérale moyenne de –20,2 % contre –13,7 % pour le mono‑agonisme GLP‑1 du semaglutide, sans signal de sécurité inattendu. L’intérêt de l’association de l’agonisme du GIP contre l'obésité se confirme donc dans cette étude randomisée pragmatique et ouverte.

- ADragan/istock
Les analogues du récepteur du GLP‑1 (glucagon-like peptide-1) ont changé le paradigme du traitement non chirurgical de l’obésité, mais la perte de poids plafonne souvent à 15 %. Le tirzepatide associe un agonisme GLP‑1 à un agonisme GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide), cibles non-redondantes à la fois dans le cerveau et l’adipocyte.
L’essai randomisé de phase 3b, SURMOUNT‑3, en ouvert, a inclus 751 adultes obèses sans diabète (âge moyen 45 ans, IMC médian 38 kg/m²) recevant sur 72 semaines la dose maximale tolérée de tirzepatide (10 ou 15 mg) ou de sémaglutide (1,7 ou 2,4 mg) hebdomadaires.
Selon les résultats présentés lors de l’édition 2025 de l’European Congress on Obesity et publiés dans le New England Journal of Medicine, à la semaine 72, la variation pondérale ajustée est de –20,2 % (IC à 95% –21,4 ; –19,1) sous tirzepatide contre –13,7 % (IC à 95% –14,9 ; –12,6) sous sémaglutide, soit un différentiel de 6,5 points (p < 0,001). Les circonférences abdominales diminuent respectivement de 18,4 cm et 13,0 cm (p < 0,001).
Une supériorité pour atteindre tous les seuils de perte de poids
L’atteinte de différents seuils pondéraux testés dans l’étude confirme la supériorité du double‑agoniste : perte ≥10 % : 84 % vs 66 % ; perte ≥15 % : 66 % vs 39 % ; perte ≥20 % : 46,5 % vs 26,1 % et perte ≥25 % : 30 % vs 16 % (tous p<0,001). Chez les hommes, la perte est inférieure d’environ 6 %, mais l’avantage relatif est conservé. Avec 35% d'homme inclus dans cette étude, c'est peut-être l'explication de résultats un peu inférieurs du tirzépatide par rapport à ceux d'autres études.
La pression artérielle systolique s'est améliorée sous tirzepatide (−10,2 mm Hg ; IC à 95 %, −11,4 à −8,9) et sous semaglutide (−7,7 mm Hg ; IC à 95 %, −8,9 à −6,4). La pression artérielle diastolique s'est également améliorée avec les deux traitements. L'hémoglobine glyquée, la glycémie à jeun et les taux de lipides se sont améliorés avec les deux traitements de l'essai, ce qui est conforme aux essais précédents.
Les événements indésirables, majoritairement digestifs, surviennent durant l’escalade posologique et sont le plus souvent légers. Ils entraînent l’arrêt du traitement chez 5 % des patients sous tirzepatide et 8 % sous sémaglutide. Les réactions au site d’injection, plus fréquentes avec le double‑agoniste, restent bénignes. Un cas de pancréatite a été observé dans le groupe semaglutide. Aucun signal de cancer médullaire thyroïdien n’a été observé.
Une étude randomisée avec un schéma d’escalade de dose pragmatique
Le schéma pragmatique « dose maximale tolérée » reflète la vraie vie, car la majorité des prescripteurs titrent la posologie selon la tolérance. Les 2 produits ont été débutés à dose faible et augmentés très progressivement selon les protocoles en vigueur. Bien qu’en ouvert, l’essai a eu un monitoring centralisé du poids et des évaluateurs indépendants, limitant le risque de biais. Sa cohorte inclut 35 % d’hommes, 19 % de personnes noires et 26 % d’hispaniques, groupes souvent sous‑représentés, améliorant ainsi la validité externe.
Ces résultats repositionnent la cible thérapeutique : une perte ≥15 %, seuil associé à la rémission de la NASH et à la normalisation de l’index d’apnée‑hypopnée, devient accessible chez plus d’un patient sur deux. Les recommandations devraient évoluer vers un modèle « treat‑to‑target ». Les bénéfices supplémentaires sur le tour de taille plaident pour l’emploi prioritaire du tirzepatide chez les sujets à obésité viscérale.
L’impact sur la morbi‑mortalité sera tranché par l’essai SURMOUNT‑MMO (fin 2027). Parallèlement, des combinaisons (tirzepatide + analogues de l’amyline, inhibiteurs SGLT‑2 ou agonistes du récepteur du glucagon) visent à atteindre, voire dépasser, le seuil chirurgical de –25 % de perte de poids. La durabilité de la réponse, la gestion d’une éventuelle reprise pondérale après arrêt et le coût à long terme constituent les prochains défis d’une pharmacothérapie de précision de l’obésité.