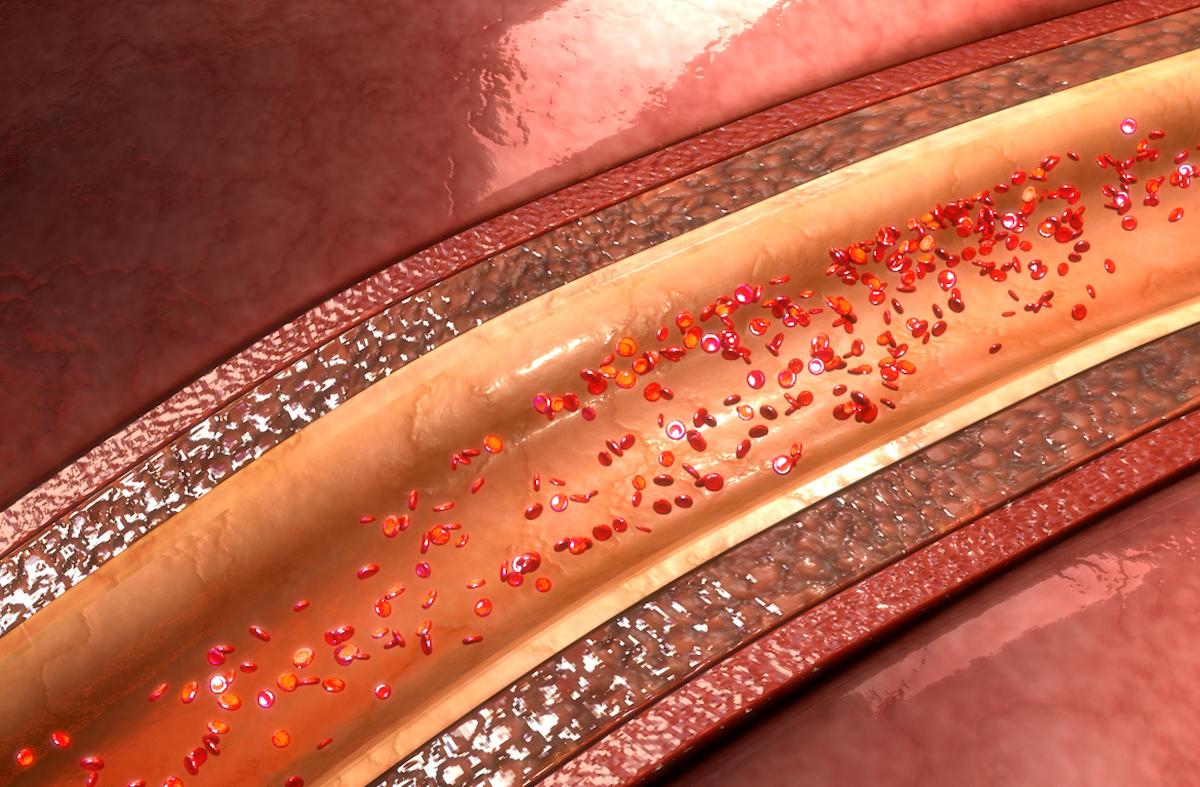Cardiologie
Infarctus du myocarde : les scores de risque manqueraient un patient sur deux
Les scores ASCVD et PREVENT, basés sur une évaluation clinico-biologique, n’identifient pas que la moitié des patients avant leur premier infarctus du myocarde. La prévention devrait être davantage centrée sur la détection des profils à risque masqué, c’est-à-dire avec athérosclérose subclinique, via l’imagerie, plutôt que sur le seul risque clinique calculé à 10 ans.

- BRO Vector/istock
Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité mondiale, alors que la prévention repose encore majoritairement sur des scores de risque (ASCVD, PREVENT) clinico-biologiques pour guider le traitement préventif et les examens complémentaires. L’étude menée au Mount Sinai Hospital a rétrospectivement évalué 474 patients de moins de 66 ans, sans maladie coronarienne connue, hospitalisés pour un premier infarctus entre 2020 et 2025. Les auteurs ont simulé ce qu’aurait été une consultation « guideline-based » deux jours avant l’événement, en calculant le risque à 10 ans selon les scores ASCVD et PREVENT.
Selon les résultats publiés le JACC:Advances, 45 % des patients ayant eu un infarctus du myocarde n’auraient pas été éligibles à un traitement préventif médicamenteux ou à un bilan complémentaire selon le score ASCVD, et cette proportion monte à 61 % avec le score PREVENT. Parallèlement, 60 % d’entre ces patients n’avaient eu aucun symptôme (douleur thoracique, dyspnée) plus de 48 heures avant l’infarctus. Ces données illustrent un « paradoxe de l’infarctus » : des outils performants au niveau populationnel échouent à sécuriser un individu qui se croit à faible risque.
Une large zone grise de patients à faible risque mais déjà athéroscléreux
Cette cohorte confirme qu’une part importante des syndromes coronaires aigus (SCA) survient chez des sujets classés à risque faible ou borderline, en particulier les plus jeunes pour lesquels l’âge sous-pondère le poids des autres facteurs. Les auteurs rappellent que jusqu’à 55 % des patients victime d’un SCA n’ont pas de symptômes préalables, et que la relation entre facteurs de risque classiques et athérosclérose est peu linéaire au niveau individuel.
La stratégie actuelle, qui réserve les explorations aux patients à risque intermédiaire ou élevé, conduit ainsi à la fois à un sous-traitement de sujets véritablement à risque et à un sur-traitement de patients à faible charge athéromateuse.
En miroir, l’imagerie centrée sur la maladie, le score calcique coronaire ou scanner coronaire, s’avère plus discriminante pour prédire les événements et la mortalité spécifique, y compris dans les catégories de risque bas ou intermédiaire. La détection précoce de la plaque, avant la phase ischémique ou symptomatique, apparaît comme un levier pour agir sur la progression athéroscléreuse et réduire le risque futur, à condition d’en préciser le bon timing, le coût et l’impact en santé publique.
De la prévention à 10 ans à une prévention “orientée maladie”
Les résultats reposent sur une étude rétrospective monocentrique élargie à deux hôpitaux d’un même système (Mount Sinai Morningside et Mount Sinai Hospital), incluant des patients de moins de 66 ans admis pour un premier infarctus du myocarde sans coronaropathie connue. Les données cliniques, biologiques et tensionnelles ont permis de calculer les scores ASCVD et PREVENT, puis de simuler une évaluation deux jours avant la survenue de l’événement cardiovasculaire, avec une classification en quatre catégories de risque et détermination des patients éligibles à une statine ou à des examens. Les auteurs ont également daté l’apparition des symptômes avant le SCA.
Les limites tiennent au caractère rétrospectif, au recrutement urbain et à l’absence de données d’imagerie systématique, ce qui restreint la généralisabilité à d’autres populations et systèmes de soins. Néanmoins, le fait que les scores ASCVD et PREVENT soient largement utilisés confère à ces résultats une forte pertinence pour la pratique.
Sur le plan clinique, ce travail invite à ne plus considérer un score bas comme un laissez-passer de sécurité, en particulier chez les sujets jeunes avec facteurs de risque ou antécédents familiaux. Il renforce l’idée d’une prévention à plus long terme, centrée sur la maladie athéroscléreuse elle-même : intégration raisonnée de l’imagerie (score calcique, scanner coronaire) dans la prévention primaire de certains profils à risque masqué, recours à de nouveaux biomarqueurs et à une estimation du risque à vie plutôt qu’à 10 ans.
Les prochaines étapes de recherche devront évaluer, dans des essais prospectifs, les stratégies combinant scores cliniques, imagerie et marqueurs émergents, en termes de coût-efficacité, d’acceptabilité et d’impact réel sur l’incidence des premiers infarctus.