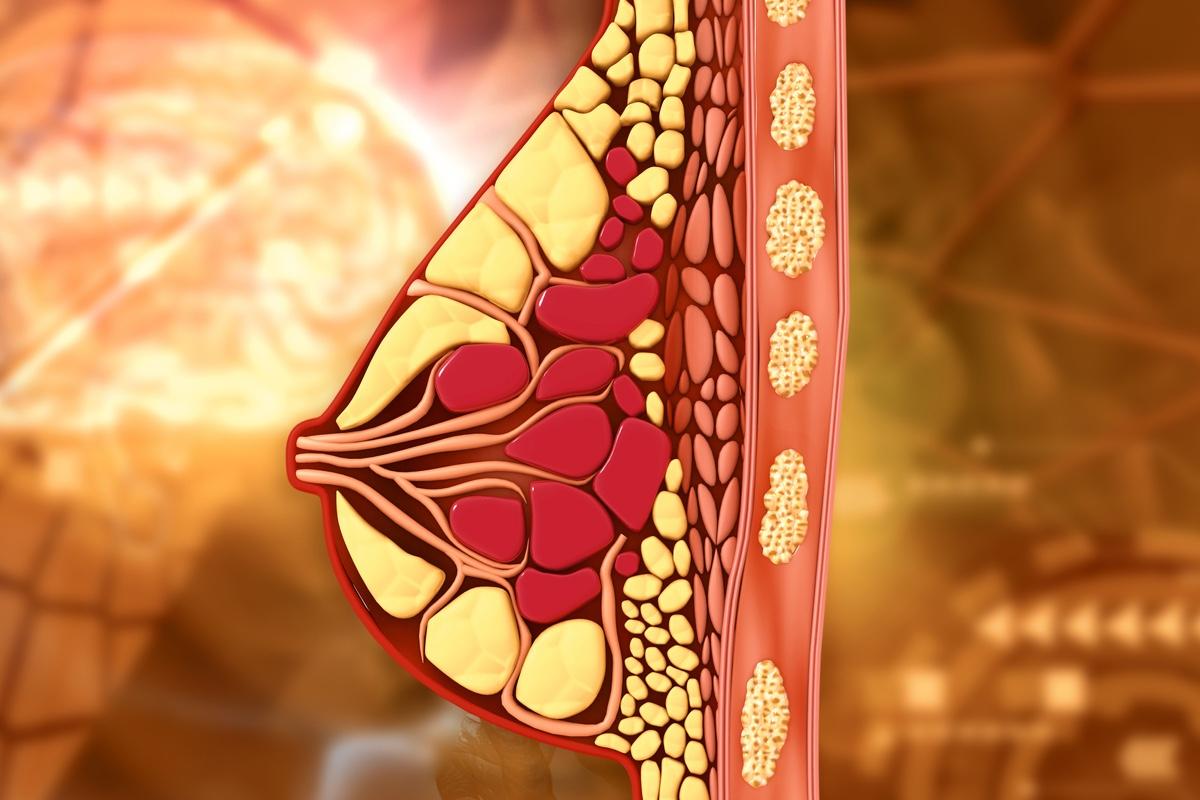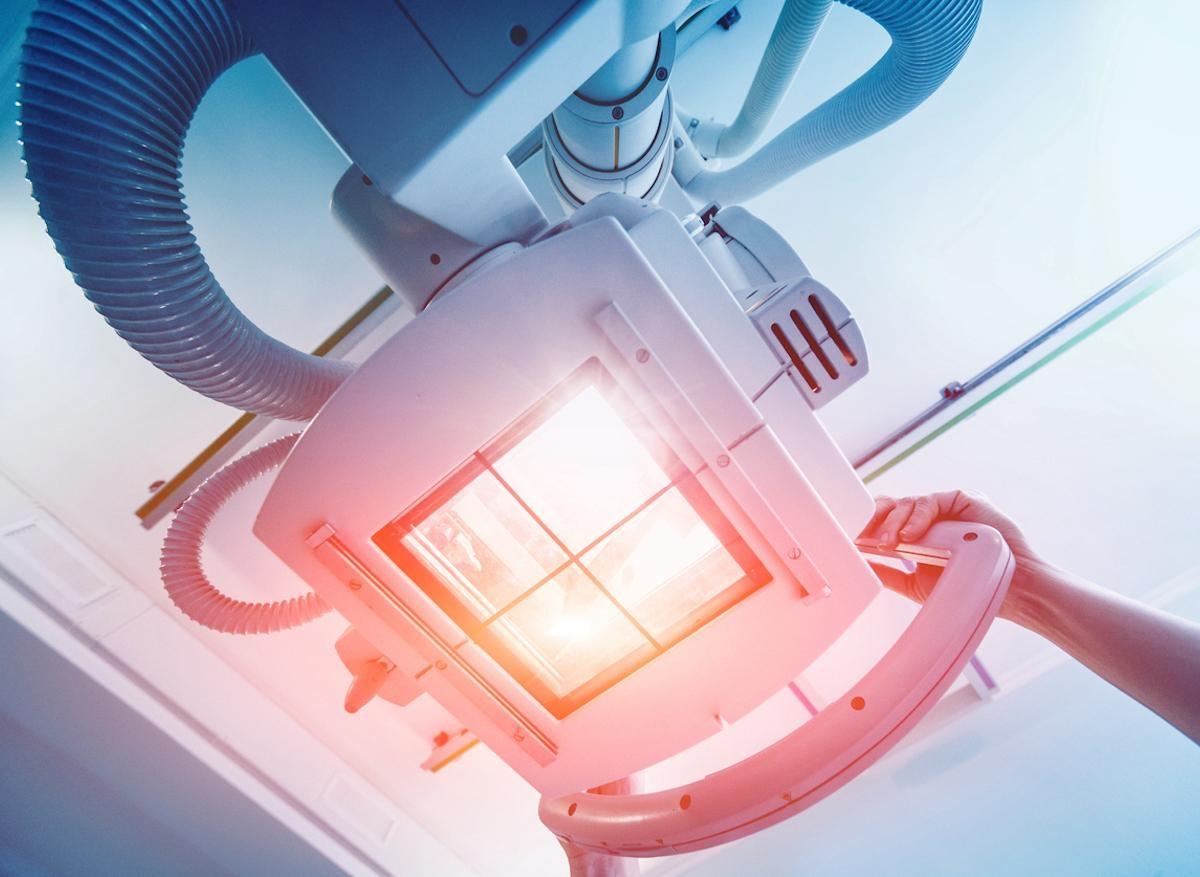Cardiologie
Cancer du sein : un score prédit le risque d’insuffisance cardiaque à 10 ans pour cibler la prévention
Chez les femmes traitées pour un cancer du sein localisé, un modèle composite de risque à 10 ans, fondé sur des données cliniques courantes et les expositions thérapeutiques (anthracycline, anti-HER2, autres), discrimine nettement les profils à faible et haut risque d’insuffisance cardiaque/cardiomyopathie améliorant la surveillance cardiaque.

- Khanchit Khirisutchalual/istock
L’insuffisance cardiaque/cardiomyopathie (HF/CM) constitue la principale toxicité cardiovasculaire après traitements du cancer du sein, alors même que la survie à 5 ans de ces malades dépasse 90 % aux stades précoces. Les recommandations prônent une évaluation cardiaque chez les patientes exposées aux anthracyclines et/ou aux thérapies ciblant HER2 (ERBB2), mais manquent d’outils validés pour estimer le risque individuel à long terme.
Dans une cohorte de 26 044 femmes (âge médian 61 ans) suivies au sein d’un système intégré (2008–2020), un modèle de Cox adapté prédit le risque de HF/CM à 10 ans en combinant âge, comorbidités, stade tumoral et schémas thérapeutiques (chimiothérapies, HER2, hormonothérapies, radiothérapie).
Selon les résultats publiés dans le JAMA Oncology, la discrimination est bonne avec une aire sous la courbe dépendante du temps à 10 ans de 0,79 dans la validation ; la calibration est satisfaisante, avec des risques observés concordants : 1,7 % (IC à 95 % 1,1–2,4) dans le tertile « bas risque » et 19,4 % (17,3–21,5) dans le tertile « haut risque ».
L’âge et les facteurs de risque CV dominent, les anthracyclines amplifient
Au-delà de la performance globale (C-index 0,76 en dérivation confirmé en validation), la hiérarchie des prédicteurs rejoint la physiopathologie : l’âge avancé au diagnostic (65–79 ans) accroît le risque (HR 3,49), de même que l’hypertension (HR 2,02) et les antécédents d’ischémie ou d’AVC (HR 1,74).
Côté traitements, les anthracyclines contribuent substantiellement (HR 1,95) et les schémas HER2 sans anthracycline restent associés (HR 1,66), tandis que la chimiothérapie non anthracycline n’apporte qu’un signal modeste (HR 1,21). À l’inverse, la radiothérapie mammaire (gauche/droite) et l’endocrinothérapie ne majorent pas le risque dans ce cadre. La stratification en tertiles (seuils issus du score pondéré) distingue nettement des groupes à 10 ans ≈ bas 1–2 %, intermédiaire ≈ 6 %, haut ≈ 19 %.
Fait saillant, la majorité des femmes de 65 ans et plus basculent dans la catégorie « haut risque » indépendamment de l’exposition oncologique, alors que peu de patientes de moins de 40 ans y accèdent ; entre 40–64 ans, le passage au haut risque requiert l’association de facteurs CV et d’expositions cardiotoxiques.
De la cardio-oncologie empirique à la stratification de risque : une surveillance adaptée
L’étude, longitudinale, exploite des dossiers électroniques complets d’un système intégré de Californie du Sud. Les femmes de 18 à 79 ans avec cancer du sein invasif local/régional nouvellement diagnostiqué ont été incluses, puis aléatoirement réparties en cohorte de dérivation (60 %) et de validation (40 %).
Les prédicteurs retenus combinent facteurs démographiques et socio-économiques, comorbidités CV (hypertension, diabète, dyslipidémie, tabagisme, obésité), antécédents CV, stade tumoral et expositions systémiques et locorégionales, avec un suivi médian de 5,2 ans et une projection des risques à 10 ans. La construction sur variables disponibles en routine vise l’adoption « monde réel ». Les auteurs reconnaissent toutefois des limites : population assurée (sélectionnée), région à risque d’HF plutôt bas, et possible sous-estimation du risque dans d’autres contextes ; la validation externe reste indispensable.
Selon un éditorial associé, ce calculateur soutient une médecine de précision pragmatique : réserver les échocardiographies sériées et/ou les biomarqueurs aux profils à risque intermédiaire et élevé, organiser un partage de soins cardio-oncologie/médecine générale, et agir prioritairement sur les déterminants modifiables (pression artérielle, diabète, dyslipidémie, tabac, poids). Chez les patientes exposées aux anthracyclines et/ou à HER2, l’information éclairée peut s’appuyer sur un risque quantifié, sans généraliser une surveillance imagée prolongée à faible rendement.
Les perspectives de recherche incluent la validation multicentrique internationale, l’intégration de la fraction d’éjection et des phénotypes d’insuffisance cardiaque à FE préservée, l’ajout de biomarqueurs (BNP/NT-proBNP, troponines) et, à terme, des approches d’apprentissage automatique incorporant doses cumulatives, paramètres d’imagerie et trajectoires métaboliques.
En résumé, chez les survivantes du cancer du sein, l’âge et le profil cardio-métabolique commandent le risque ; les expositions oncologiques l’amplifient. Un outil simple, validé, permet désormais d’ajuster la prévention et la surveillance au risque réel.