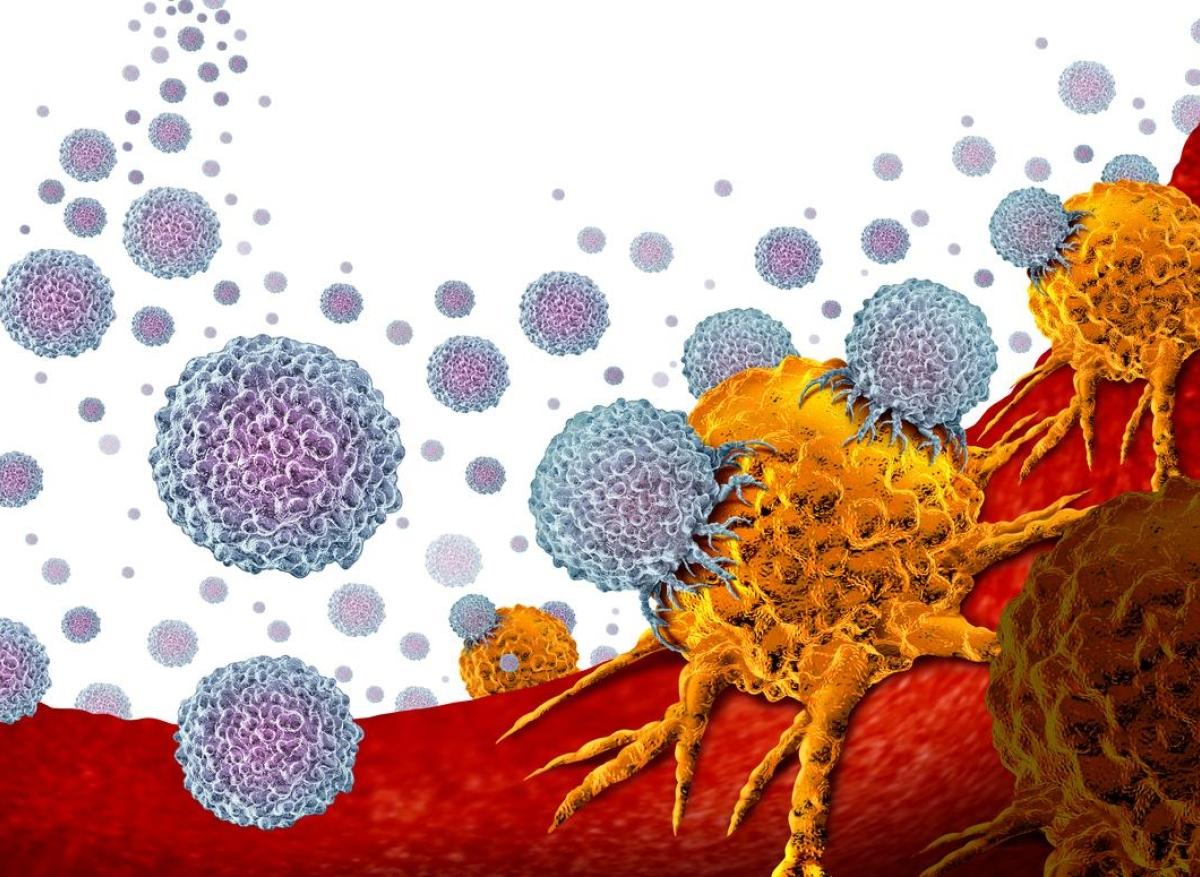Onco-digestif
CHC : corrélation entre efficacité & toxicité dans l'immunothérapie
Le traitement des carcinomes hépato-cellulaires (CHC) avancés non éligibles à un traitement locorégional repose sur les combinaisons immunothérapie plus anti-angiogénique ou double immunothérapie (1)(2). L’essai de phase III HIMALAYA a démontré l’efficacité et d’une double immunothérapie, anti-PD-L1 (durvalumab) et anti-CTLA-4 (trémélimumab). Cette nouvelle analyse présentée à l’ASCO 2023 démontre une forte corrélation entre les toxicités auto-immunes et l’efficacité de la double immunothérapie.
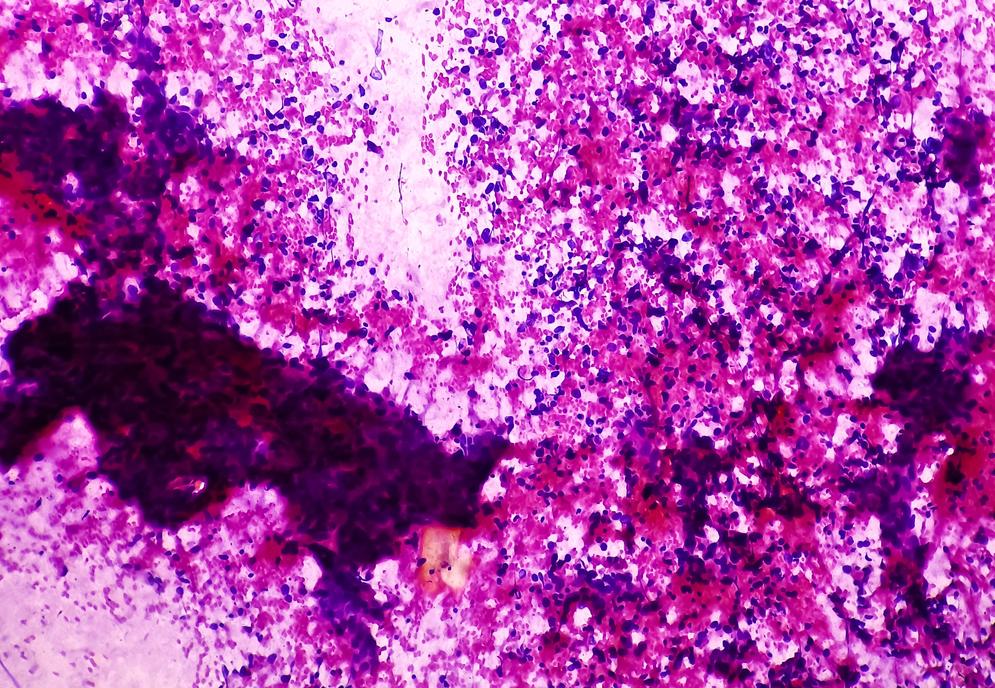
- Md Babul Hosen/iStock
L’essai IMbrave 150 a montré la supériorité de l’association immunothérapie (atézolizumab, anti-PDL-1) et anti-angiogénique (bévacizumab), en améliorant la survie globale (SG) et la survie sans progression (SSP) par rapport au sorafénib, avec un profil de tolérance acceptable dans les CHC CHILD A avancés non éligibles à un traitement locorégional (1).
L’essai HIMALAYA a plus récemment montré la supériorité de l’association de deux immunothérapies (durvalumab plus trémélimumab) versus le sorafénib (2). Les patients du groupe durvalumab trémélimumab recevaient du durvalumab 1500 mg toutes les 4 semaines en association avec le trémélimumab 300 mg une dose, appelé schéma STRIDE. Le critère de jugement principal était positif, avec une amélioration significative de la SG dans le bras STRIDE versus sorafénib (16,43 vs 13,77 mois, HR=0,78 (IC 96,02 % : 0,65–0,93)). Ce schéma est récemment disponible en France sous forme d’accès précoce.
Toxicité de la double immunothérapie et efficacité
Au total, 35,8 % des patients dans le bras STRIDE ont eu des effets indésirables immuno-médiés reliés au traitement dont 12,6 % de grade 3-4. Les principaux EI immuno-induits étaient une toxicité hépatique (2,3 % d’hépatite), endocrine (10,1 % d’hypothyroïdie), digestive (4,4 % de diarrhée et 1,5 % de colite) et cutané (3,6 %). La plupart de ces effets secondaires surviennent dans les 3 premiers mois de traitements. Cela a conduit à un arrêt de traitement dans 5,7 % des cas et 20,1 % des toxicités ont nécessité la prise de corticoïdes.
Il a été suggéré dans plusieurs tumeurs que la survenue de ces effets immuno-médiés pourrait être associée à une meilleure survie. La survie des patients dans la bras STRIDE était significativement meilleure en cas de toxicité auto-immune avec une médiane de SG de 23,2 mois versus 14,1 mois, respectivement en présence ou absence d’effets secondaires auto-immuns (HHR=0,73). Le taux de SG à 36 mois était aussi meilleur, de 36,2 % versus 27,7 %.
Perspectives
Ces résultats confirment la bonne tolérance du schéma STRIDE dans les CHC avec des effets secondaires auto-immuns graves rares. Comme dans les autres tumeurs on retrouve une corrélation entre la toxicité de l’immunothérapie et son efficacité. Ces résultats confirment qu’en cas d’effets secondaires graves il n’est pas délétère d’arrêter l’immunothérapie et d’introduire des corticoïdes puisque la maladie tumorale est en général très bien contrôlée. La reprise de l’immunothérapie se discute ensuite au cas par cas en fonction de la gravité de la toxicité, de son évolution et du contrôle de la maladie tumorale après discussion en RCP dédiée.
On notera aussi que même en l’absence d’effet auto-immun les patients du bras STRIDE avaient une SG meilleure que ceux du groupe sorafénib suggérant ainsi l’intérêt de poursuivre le traitement même en l’absence de toxicité.
En conclusion, la toxicité de l’immunothérapie dans les CHC est corrélée à son efficacité, ce qui permet de suspendre le traitement en cas d’effet secondaire auto-immun grave sans craindre une progression rapide de la maladie qui est en générale bien contrôlée dans cette situation.